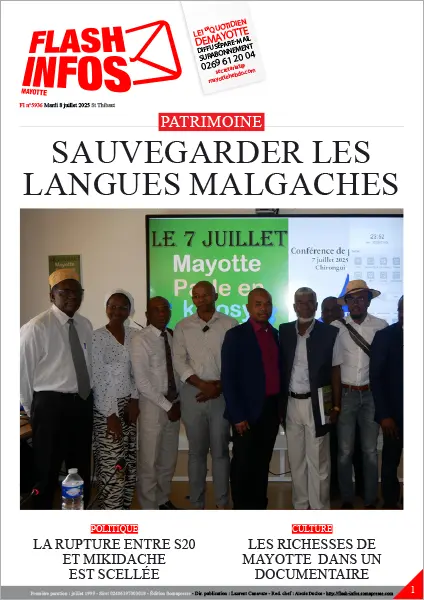Vainqueur en Coupe de France face au Vautour de Labattoir, puis contre les Réunionnais du BC Dyonisien, le BCM s’était qualifié pour les seizièmes de finale du Trophée Coupe de France. Et ce samedi, sera l’heure de vérité. Les Mahorais affrontent le Gennevilliers Basket club à 20h (22h à Mayotte). Leurs adversaires évoluent en Nationale 2 (quatrième échelon français) et surtout dans la même poule que l’US Alfortville qui avait battu le BCM l’an dernier au même stade (106-71). Le match à suivre chez nos confrères de Mayotte la 1ère à partir de 21h50.
La saison culturelle du Département est lancée !
Les événements ont subi deux années difficiles liées à la crise sanitaire. Peu à peu et depuis quelques mois, ils reprennent progressivement leurs droits. La nouvelle saison culturelle, proposée par le Département de Mayotte a été présentée, ce jeudi matin, avec la sortie de l’agenda culturel 2023, qui « marque, comme dit dans le monde du spectacle, la fin de l’entracte », confie Zouhourya Mouayad Ben, vice-présidente du conseil départemental de Mayotte.

La culture est un réel lien social et « l’accès à la connaissance, l’ouverture au monde, sont des enjeux considérables dans une société en perte de repères », affirme Zouhourya Mouayad Ben. Pour cela, l’agenda culturel a été pensé afin de toucher des plus petits jusqu’aux plus grands. « Notre saison s’ouvre dès le mois de février, avec la magie du chant lyrique », ajoute-t-elle. En effet, la saison culturelle débutera avec la finale nationale du concours « Voix des outre-mer » où deux finalistes mahorais représenteront le territoire de Mayotte à l’Opéra de Paris.
Célébrer et partager le patrimoine local
Le chant traditionnel sera aussi mis en avant, avec, le 25 février à Chiconi, la célébration de l’inscription du maoulida shengué au patrimoine culturel immatériel national. C’est le premier élément du patrimoine de Mayotte à figurer dans cette liste du ministère de la Culture. Les traditions locales sont à nouveau mises en avant lors du Festival des arts traditionnels de Mayotte (FATMA), qui met en lumières les danses, chants, pratiques et savoir-faire locaux afin de leur faire découvrir au plus grand nombre.
En vue de mieux faire connaître le patrimoine historique du 101e département, le musée de Mayotte organise, en avril, une exposition nommée « La route du sucre ». Cette dernière permettra aux visiteurs de découvrir l’histoire des usines sucrières, en récupérant « des objets qui faisaient partie de la maison sucrière de Longoni », explique Abdoul-Karime Ben Saïd, directeur du MuMa. L’objectif de cette exposition est de créer un projet pédagogique pour, à terme, « aboutir à un parcours de visite afin de comprendre la chaîne d’opération de la fabrication du sucre », complète-t-il. En plus de ce projet pédagogique, le directeur du musée caresse « l’espoir de la réouverture du musée en 2023 ». Afin de patienter avant la réouverture du musée, un projet est en cours, celui du musée virtuel. « Nous serons en mesure d’ici quelques semaines de mettre à disposition le musée virtuel, qui permettra à tout un chacun de pouvoir accéder aux expositions », fait observer le directeur.
Le salon du livre devient le Festival du livre
Les scènes ouvertes continueront d’être présentes au calendrier de l’agenda culturel encore cette année. Cette action « donne l’accès et la possibilité aux jeunes de venir s’exprimer sur scène », explique Mohamed Bin El Kabir, directeur de l’office culturel départemental. En première partie d’année, aura lieu la finale de la première phase de l’édition 2023, en février sur le parvis du cinéma à Mamoudzou. Dans un deuxième temps, les artistes auront de nouveau l’occasion de participer aux Scènes Ouvertes pour déployer leurs talents, avec un rendez-vous aura en septembre, à Bouéni.
Aux côtés des autres arts, la littérature mahoraise, en vue de se développer, a besoin d’aller à la découverte de nouveaux auteurs. Pour cela, le Département lance dès le 1e avril, un concours littéraire. Ce dernier fera l’objet d’un prix attribué en novembre, « qui signifie la reconnaissance du monde professionnel littéraire », note Abdoul-Karime Bamana, directeur de la direction de la cohésion sociale, de la jeunesse et des sports (DCSJS).
En clôture de la saison culturelle, le Département organise en novembre le Festival du livre de Mayotte (FELIMA), anciennement dénommé Salon du livre de Mayotte (SALIMA). Cet événement permet de faire la promotion de la lecture et favorisant le contact du public avec les écrivains.
Le calendrier 2023 des manifestations du Département
- Finale du concours « Voix des outre-mer », samedi 4 février à l’Opéra de Paris et en direct sur la page Facebook du concours.
- Finale des « scènes ouvertes », samedi 25 février sur le parvis du cinéma Alpa Joe à Mamoudzou.
- Célébration de l’inscription du Maoulida Shengué au patrimoine culturel immatériel national, samedi 25 février à Chiconi.
- « Trésors de l’oralité », du samedi 18 au dimanche 26 mars sur le site internet et réseaux sociaux du Département.
- « L’indigo ou la 7e couleur de l’arc-en-ciel », vendredi 24 et samedi 25 mars dans le jardin de la résidence des gouverneurs à Dzaoudi.
- Festival des arts traditionnels de Mayotte (FATMA), du lundi 24 au samedi 29 avril sur le parking du marché couvert à Mamoudzou.
- Commémoration de l’abolition de l’esclavage, jeudi 27 avril à l’hôtel du Département à Mamoudzou.
- Exposition « La Route du sucre », samedi 29 avril au MuMA à Dzaoudzi.
- La nuit européenne des musées, samedi 13 mai dans le jardin de la résidence des gouverneurs à Dzaoudzi.
- Séminaire « Le Boutre dans la zone Swahilie », mercredi 24 et jeudi 25 mai, à l’hémicycle Bamana à Mamoudzou.
- Semaine internationale des archives, vendredi 9 et samedi 10 juin, aux archives départementales de Mayotte.
- Journées européennes de l’archéologie, du vendredi 16 dimanche 18 juin, dans le jardin de la résidence des gouverneurs à Dzaoudzi.
- Séminaire sur le shioni, apprentissage et vivre ensemble, jeudi 22 et vendredi 23 juin, à l’hémicycle Bamana à Mamoudzou.
- La fête de la musique, samedi 24 juin sur le parvis de la salle de cinéma Alpa Joe à Mamoudzou.
- Exposition « Tschiéga, Segas, musiques et danses de l’océan Indien », du lundi 19 au samedi 24 juin dans le Hall du conseil départemental à Mamoudzou.
- Inauguration de l’exposition « La musique, corps et âme », samedi 24 juin au MuMa à Dzaoudzi.
- La semaine de l’excellence sportive, du lundi 3 au dimanche 9 juillet au stade de Cavani, à Mamoudzou.
- Scènes ouvertes 2, samedi 2 septembre à Bouéni.
- « Levez les yeux », vendredi 15 septembre au MuMa, à Dzaoudzi.
- Journées européennes du patrimoine, samedi 16 et dimanche 17 septembre, à travers le département.
- Journées nationales de l’architecture, du vendredi 13 au dimanche 15 octobre, au MuMa et dans le hall du conseil départemental.
- Festival des musiques urbaines, vendredi 20 et samedi 21 octobre, à Bouéni.
- Journée mondiale du patrimoine audiovisuel, vendredi 27 et samedi 28 octobre, aux archives départementales.
- « Voix des outre-mer », la finale territoriale, le samedi 18 novembre au parvis du cinéma Alpa Joe à Mamoudzou.
- Vernissage des œuvres de masterclass de peinture, septembre à décembre dans les établissements scolaires.
- Remise du prix littéraire du Département, vendredi 17 novembre à la direction du livre et de la lecture publique à Cavani, Mamoudzou.
- Festival du livre de Mayotte (FELIMA), du jeudi 23 au dimanche 26 novembre, à la direction du livre et de la lecture publique à Cavani, Mamoudzou.
- Finale 2023 des scènes ouvertes, samedi 23 décembre au parvis du cinéma Alpa Joe à Mamoudzou.
Des actes de violence en marge du décasage de Doujani

Le village de Doujani connaît une flambée de violence chaque nuit, depuis le début du décasage du quartier Doujani 3, ce mardi 17 janvier. Des agressions, des incendies, dont celui d’une voiture devant la permanence du député Mansour Kamardine, ont eu lieu.
Alors que les ouvriers continuent de dégager les gravats et les tôles de Doujani 3, un quartier informel qui regroupait presque 500 personnes, l’atmosphère est plutôt calme dans la journée. C’est la nuit, quand les gendarmes mobiles et les camions sont partis, que les choses se gâtent depuis que l’opération de décasage à commencer ce mardi matin. Des affrontements ont eu lieu entre bandes de jeunes et policiers. Pire, des habitants de Passamaïnty, le village étant limitrophe, ont été pris pour cible. Selon nos informations, un homme a été agressé chez lui, dans son salon, à coups d’arme blanche, dans la nuit de mardi à mercredi. L’unité de Raid, pérennisée à Mayotte « pour quelques mois », serait intervenue pour ramener le calme.
Des incendies dans la nuit de mercredi
Plusieurs incidents ont été aussi à déplorer dans la nuit suivante, dans la ville de Mamoudzou. En effet, des véhicules ont été incendiés à Passamaïnty. L’un d’eux était de surcroît situé devant la permanence du député Mansour Kamardine. Une fois en flammes, le feu du véhicule s’est alors propagé au bâtiment adjacent, jusqu’à dégrader fortement sa permanence et les maisons voisines. Pour le parlementaire, « des lâches ont déclenché un incendie en vue de détruire ma permanence parlementaire », déplore-t-il dans un communiqué.
Merci monsieur le ministre https://t.co/jauXoWXWct
— Mansour KAMARDINE – Officiel (@Kamardine_M) January 19, 2023
Ces actes de vandalismes, malgré le renforcement des forces de l’ordre qui donne suite à l’opération de construction de l’habitat illégal à Doujani, sont « loin de m’intimider », répond le député. Il ajoute que « cet acte me conforte dans mes convictions et ma détermination ».
La Fage au chevet des droits des étudiants mahorais

L’AEJM (Association des étudiants et jeunes de Mayotte) accueille la première vice-présidente de la Fage (Fédération des associations générales étudiantes), Émilie Deville, du 18 au 20 janvier. Celle-ci fait la tournée des associations adhérentes de son mouvement.
Le déplacement d’Émilie Deville cette semaine a pour objectif de permettre à la Fage (première association étudiante de France) de prendre en compte de la situation des étudiants mahorais. Elle compte grâce à cela porter leur voix auprès des instances nationales et aussi pouvoir mettre en œuvre les bonnes solutions. L’association a très peu de vision sur l’outre-mer étant donné qu’elle est située en métropole, donc son intention cette année est de s’impliquer sur les territoires ultramarins. Mais cette visite a aussi pour but d’accompagner l’AEJM sur ses différentes actions et de rencontrer les acteurs de la vie étudiante ainsi que les étudiants pouvoir prendre note de leurs revendications. La fédération des associations générales étudiantes compte également mettre en place des solutions pour la problématique de des bourses et des logements.« On va se servir des différentes actions que nous allons mettre en place pour faire évoluer les choses », la représentante de la Fage. Concernant la problématique du Crous (Centre régional des œuvres universitaires et scolaires), en fin d’année 2022 Mayotte a été affilié au Crous de La Réunion, qui est par la suite devenu « Crous La Réunion et Mayotte » après plusieurs réclamations de la part des collectifs d’étudiants mahorais. La Fage va donc observer les actions du Crous, voir s’il exerce ses missions sur le territoire et faire en sorte qu’il les réalise si ce n’est pas le cas. Dans son programme réparti sur deux jours, la visite du centre universitaire de Mayotte servira à comprendre son fonctionnement, qui diffère de celui des autres établissements car le site mahorais est conventionné avec d’autres universités telles que Nîmes, Montpellier ou encore Aix-Marseille. Pour rappel, depuis sa création en 2012, c’est la première fois qu’une responsable d’association étudiante nationale se déplace à Mayotte. Après son passage sur l’île, Émilie Deville se rendra à La Réunion, puis en Guyane.
Lutter contre l’écart entre Mayotte et les autres
Le CUFR de Mayotte a énormément de retard par rapport aux autres facultés françaises. Niveau services, le centre universitaire est loin derrière et ce manque se fait sentir sur la vie de certains étudiants mahorais. En effet, l’absence de Crous pénalise les étudiants du CUFR (Centre universitaire de Formation et de Recherche) qui ne bénéficient pas des services comme ceux de la métropole, de La Réunion et des Antilles ont. D’ailleurs, à Mayotte, il n’y a pas de logements étudiants ni de transports. Par conséquent, certains élèves doivent se lever à 5H30 pour faire le trajet jusqu’à leur établissement et reviennent chez eux à 19 heures, voire 20 heures après la fin des cours. La question des transports est l’une des revendications menées par l’AEJM qui pourra aussi compter sur l’appui de la Fage et de sa vice-présidente. Et pas que, car là où les étudiants réunionnais se dirigent vers les restaurants universitaires à l’heure de la pause, ceux du CUFR n’ont pas ce choix-là.
Pour y remédier, « l’association locale en collaboration avec la Fage ouvrira une épicerie Agroaé fin décembre 2023 », informe Émilie Deville. Celle-ci permettra aux étudiants de se nourrir et de se procurer des denrées alimentaires à des prix dix fois moins chers qu’en magasin. 38 épiceries de ce genre sont déjà présentes en métropole et d’autres verront le jour à La Réunion et dans les Antilles.
Concernant l’éducation, le centre universitaire connaît un retard comparé aux autres, le nombre des filières y est restreint. De ce fait, il est souvent compliqué de pouvoir se réorienter sans avoir à quitter pour la métropole ou La Réunion.
Ida Nel, femme d’affaires
Retrouvez l’intégralité du classement des 30 personnalités les plus influentes de Mayotte dans le Mayotte Hebdo n°1026, paru le vendredi 13 janvier. Ce vendredi, c’est au tour de notre numéro une d’être présentée. Il s’agit de la femme d’affaires aujourd’hui à la tête du port de Longoni via sa société Mayotte Channel Gataway, Ida Nel.
Mayotte Hebdo : Comment êtes-vous arrivée au port de Longoni ?
Ida Nel : Quand on a démarré en 1980 et qu’on a décidé d’ouvrir un magasin alimentaire, on était à Dzaoudzi, et c’est nous qui avons emmené la première cargaison venue d’Afrique du Sud. La première chose que nous avons importée, c’étaient des oignons, et c’est comme ça que je suis arrivée au port. J’ai toujours travaillé avec le port depuis le début.
Découvrez nos 30 personnalités les influentes de Mayotte en cliquant sur ce lien
M.H. : Que retenez-vous de ces 44 ans de vie et de travail à Mayotte ?
I.N. : Il y a encore beaucoup de choses à faire. J’espère que les Mahorais vont se retrousser les manches et bosser. Ce qui m’a marquée dans le passé c’est qu’il y avait un énorme besoin. Récemment je regardais quelques-unes de mes archives datant d’il y a trente ans et ce qui me choque c’est qu’aujourd’hui on a toujours les mêmes problèmes, c’est-à-dire l’immigration, le manque d’eau, l’aménagement du territoire. C’est hallucinant que l’on parle toujours de la même chose. Il faut qu’il y ait plus un esprit d’entreprendre à Mayotte et ne pas juste attendre que le gouvernement fasse tout. Et puis de l’autre côté, si on veut que les choses évoluent, il faut faire les infrastructures nécessaires, construire des routes, mais cela nécessite une bonne volonté de la part de tous…
M.H. : Tout au long de votre carrière, vous avez fait face à quels types de difficultés ?
I.N. : Il y a beaucoup de jalousie, beaucoup ne veulent pas que Mayotte avance, ni que les autres évoluent. Mon fils et mes petits-enfants ne vivent pas ici donc si je fais tout cela c’est pour la population mahoraise. Je pense que certaines personnes essayent de me bloquer sans raison, c’est juste parce que je suis Ida Nel et que j’ai fait beaucoup de choses. Il faut laisser les gens qui veulent entreprendre le faire tranquillement. Je ne veux pas que dans trente ans on parle encore des mêmes problèmes. Cependant, quand je pense à l’avenir, je reste positive.
Deux dates importantes pour Ida Nel
1988 : « C’est l’année où le ministre des Outre-mer de l‘époque, Bernard Pons, a dit que Mayotte va se développer. Je pense que tout s’est accéléré à ce moment-là, à partir de cette date Mayotte avançait à grand pas. »
2013 : « C’est quand j’ai repris le port, au mois de novembre. On était un peu naïfs car on ne pensait pas que ça aurait été aussi compliqué, qu’il y aurait autant de freins. »
Une femme d’affaires qui a su mener sa barque
Elle est surnommée « la patronne », ou parfois tout simplement « Madame ». Un quartier tout entier de Kawéni porte son nom, la zone Nel. Il s’agit bien évidemment d’Ida Nel. Si elle arrive à la première place des personnalités les plus influentes à Mayotte ce n’est pas par hasard. Cette Sud-africaine installée sur l’île depuis 44 ans est considérée comme la femme la plus puissante et la plus riche du département, même si elle ne communique jamais sur le montant exacte de sa fortune.
Ida Nel arrive sur le territoire en 1979, en bateau, avec son mari et son fils. Mayotte n’est qu’une étape dans leur idée du tour du monde. Mais une fois sur place, « on était tellement bien reçus qu’on a décidé de rester plus longtemps », indique-t-elle. Très vite, ils se rendent compte qu’il y a tout à faire. Les besoins sont criants notamment dans le domaine de l’alimentation. Le couple voit là une opportunité d’ouvrir une épicerie. Et c’est ainsi que naît la SNIE en 1980. Le besoin est tel que la petite boutique grandit rapidement, et la famille en ouvre d’autres sur le territoire.
À la mort de son époux, Ida Nel continue à faire prospérer leurs entreprises, mais elle finit par vendre la SNIE en 2003. Elle n’en reste pas moins une femme d’affaires redoutable et se renouvelle à chaque occasion.
Aujourd’hui, elle est principalement connue en tant que présidente directrice générale de Mayotte Channel Gateway, la société qui gère le port de Longoni depuis dix ans. Une fonction qui n’a pas été de tout repos pour la sexagénaire, mais elle n’a pas l’intention de lâcher prise. MCG est délégataire du port jusqu’en 2028. À presque 69 ans, Ida Nel a encore de grandes ambitions. Elle estime être une visionnaire et elle souhaite que l’île aux parfums se développe davantage. Pour cela, « il faut réunir tous les acteurs afin qu’ils travaillent ensemble, qu’il s’agisse des politiques, du monde économique, de l’administration… », insiste-t-elle. Et si la femme d’affaires s’investit autant pour faire avancer le département c’est parce qu’elle considère être chez elle à Mayotte et elle est persuadée qu’elle y mourra.
Une nouvelle collaboration entre AKTO et Ladom pour renforcer l’insertion professionnelle
Partenariat entre AKTO (opérateur de compétences) et Ladom pour renforcer l’insertion professionnelle des actifs en outre-mer, les deux ont signés une convention-cadre de partenariat pour soutenir le développement des compétences dans les DROM (Département et Région d’Outre-Mer) au sein des 27 branches professionnelles d’AKTO. Afin d’améliorer l’insertion dans l’emploi durable dans les territoires ultramarins, les deux enseignes souhaitent favoriser l’accessibilité à la mobilité aux actifs pendant leur formation. La convention répond aux objectifs suivants : optimiser les financements mobilisables, mieux articuler leurs expertises en matière de mobilité, dans le cadre de la formation professionnelle et rapprocher les besoins de recrutement des entreprises et la montée en compétences des demandeurs d’emploi ultramarins. D’après Laurent Barthélémy, vice-président d’AKTO : « tout l’enjeu est d’identifier les besoins des entreprises en outre-mer, afin que Ladom puisse accompagner les demandeurs d’emploi vers les formations qui leur correspondent. À travers ce partenariat, nous réaffirmons notre volonté de mettre en relation les demandeurs d’emploi et les entreprises et promouvoir l’alternance ».
L’ancien député Saïd Ahamada devient le nouveau directeur général de Ladom
L’ancien député de la septième circonscription des Bouches du Rhône, Said Ahamada, a été nommé nouveau directeur général de Ladom (Agence de l’Outre-mer pour la mobilité), le 16 janvier. D’origine comorienne par son père et réunionnaise par sa mère, il succède au Guadeloupéen Flores Nestar qui a dirigé Ladom pendant six ans avant son départ, le 22 février 2022. En attente de la nomination officielle d’un nouveau directeur général, les missions de la direction générale étaient assurées par intérim par Florence Svetecz, secrétaire générale de l’agence. Dans le cadre de la fusion de la délégation pour la visibilité des outre-mer avec Ladom, le Guadeloupéen Maël Disa avait été désigné président de Ladom en novembre. Pour rappel, l’instance a pour objectifs entre autres, de garantir l’égalité de l’accessibilité des Français d’outre-mer à l’ensemble des dispositifs de formation et de favoriser l’accès de chacun au marché du travail, et aussi accompagner les jeunes dans leurs parcours de formation lorsque les cursus ne sont pas disponibles sur le territoire.
Indemnité carburant de 100 euros : les formulaires sont disponibles en ligne
Après la remise à la pompe qui a pris fin le 31 décembre, une indemnité carburant d’un montant de 100 euros sera versée aux dix millions de travailleurs les plus modestes. Cette aide a été définie dans un décret publié au Journal officiel du 4 janvier dernier. Les personnes éligibles à cette assistance peuvent en faire la demande depuis ce lundi 16 janvier et jusqu’au 28 février 2023 sur un formulaire mis en ligne sur le site impôts.gouv.fr. Contrairement à la remise sur les carburants qui a pris fin en fin d’année 2022, celle de 2023 cible plus les Français les plus modestes qui utilisent leur véhicule pour aller au travail. Cette compensation sera versée par personne et non par foyer, chaque membre d’un couple modeste éligible pourra donc en bénéficier. Pour obtenir l’indemnisation il faut obligatoirement en faire la demande, vous devrez alors indiquer votre numéro fiscal, votre numéro d’immatriculation ou votre numéro de formule de votre carte grise ainsi que remplir une attestation sur l’honneur indiquant que vous utilisez votre véhicule pour aller au travail. L’aide sera ensuite directement versée sur le compte bancaire que vous avez communiqué à l’administration fiscale, sans démarche supplémentaire de votre part.
Éducation : une semaine des Cordées de la réussite à Mayotte
À l’occasion de la semaine nationale des Cordées de la réussite et de l’ouverture de Parcoursup, le recteur sera présent, ce jeudi 19 janvier, au lycée des Lumières, accompagné du délégué du préfet à la politique de la ville dans le cadre de la valorisation des classes préparatoires aux grandes écoles. Le dispositif des Cordées de la réussite s’inscrit dans la politique d’égalité des chances et de développement des parcours d’excellence de l’académie. Il a pour objectif de lutter contre les déterminismes socio-culturels et territoriaux et de susciter l’ambition scolaire des élèves. Les Cordées de la réussite mettent en réseau des établissements d’enseignement supérieur avec des collèges et lycées. Lors de la rentrée 2022, l’académie de Mayotte comptait 23 cordées au bénéfice de 1.500 élèves issus des lycées et collèges publics. Pour la semaine des Cordées à Mayotte, la délégation DAC (Direction des Admissions des Concours), BCE (Banque Communes d’Épreuves) et l’ISC de Paris (Institut Supérieur du Commerce) est donc présente sur l’île dans divers lycées.
La venue de la délégation est due au partenariat développé avec le rectorat dans le cadre de la Cordée de la réussite « Com’Mayotte » au profit des lycées de Sada et des Lumières. Quatre autres lycées de l’île au lagon bénéficieront aussi d’une présentation des CPGE économique (classes préparatoires aux grandes écoles) et commerciales et des écoles de management. Le statut militaire offert aux étudiants du cycle polytechnicien de l’école polytechnique de Paris est représenté par un étudiant à Mayotte, il participe à développer les actions dans le cadre cordée de la réussite « X-Mayotte ». Sa présentation des classes préparatoires et des écoles d’ingénieurs profitera également aux six lycées du territoire.
Nuit de la lecture à Pamandzi le 21 janvier
Dans le cadre de la septième édition nationale des Nuits de la Lecture, la bibliothèque municipale de Pamandzi organise un évènement, ce samedi 21 janvier, dès 16h, à la place des Congrès. Au programme de la soirée : narration de contes, spectacle de contes musicaux, danses et activités diverses.
Département : l’agenda culturel 2023 présenté ce jeudi matin
Ce jeudi 19 janvier, à 10 h, une conférence de presse va permettre la présentation de l’agenda culturel 2023 du Département. Celle-ci se tiendra, dans la salle de cinéma de l’Alpa Joe, en présence de la vice-présidente de la Culture, Zouhourya Mouayad Ben, et des principaux responsables culturels départementaux.
Attaque du bus à Majicavo : trois personnes en détention
La violente attaque du bus, à Majicavo-Koropa, le mercredi 16 novembre 2022, avait entraîné un déchainement de violences sur la commune de Mamoudzou, le week-end suivant. Selon le Parquet, trois individus liés au guet-apens du 16 novembre, ont été interpellés, dont deux à la fin du mois de novembre. Placés en détention provisoire, ils seraient les auteurs des coups sur les quatre élèves de Kawéni blessés (un autre en état de choc a été pris en charge par les pompiers) et le chauffeur du bus, qui assurait la liaison ce jour-là avec Dzoumogné-Mamoudzou. L’enquête est toujours ouverte, la gendarmerie étant toujours à la recherche de participants à cet acte qui a profondément choqué l’île et fait la Une des journaux en métropole.
Jean-François Carenco dévoile sa feuille de route pour l’outre-mer
Ministre délégué aux Outre-mer du gouvernement Borne, Jean-François Carenco (en photo avec le général Olivier Capelle, le commandant de la gendarmerie à Mayotte) a présenté sa feuille de route pour les territoires ultramarins, ce mardi 17 janvier. Dans les faits, beaucoup de choses ont déjà été annoncées ou mises en œuvre dans ce document d’une vingtaine de pages. Le ministre rappelle, en effet, que le budget du ministère établi à presque trois milliards d’euros en 2023 n’a jamais été aussi important et représente une hausse de 13% par rapport à 2022. Sur le plan du financement, des nouveaux contrats de convergence seront à élaborer pour la période 2024-2027. A Mayotte justement, le dernier a été signé à la fin du mois d’août 2022 avec le syndicat des Eaux de Mayotte et « prévoit des investissements de près de 411 millions d’euros ». Le ministère prévient qu’« il appartient désormais à la société des Eaux de Mayotte (sic) de lancer les appels d’offres », en faisant la confusion entre le syndicat et son délégataire, la société mahoraise des eaux (SMAE). Toujours sur l’environnement, il annonce qu’« une planification pluriannuelle de l’énergie (PPE) va suivre rapidement » à Mayotte celles de Guyane et Saint-Pierre-et-Miquelon. Dans les faits, celui-ci devrait « assurer rapidement la sécurité énergétique du territoire ».
Pour le reste, on peut retenir que le ministère compte « donner la priorité à l’économie à l’horizon 2030 ». Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur de l’Outre-mer, disait également, à Kani-Kéli, le 1er janvier, qu’il veut insister sur « la création de valeur ». Un terme qu’on retrouve dans la feuille de route de son ministre délégué. Toujours sur l’économie, le ministre Carenco répète que l’Oudinot du pouvoir d’achat conclu le 8 décembre 2022 avait permis « de parvenir à des effets sensibles sur les prix pour les produits de grande consommation ».
En projet de territoire, l’Éducation nationale tient forcément une place importante. « Pour mémoire, 83 millions d’euros seront dépensés par le ministère de l’Éducation nationale en 2023 pour les constructions scolaires à Mayotte », poursuit le ministre. Le service militaire adapté en outre-mer n’est pas non plus oublié avec des moyens augmentés de trente millions d’euros « pour la poursuite des projets initiés en 2022, l’augmentation de l’offre de formations, et la prise en compte des besoins des publics spécifiques ».
L’Auberge du Rond-point a « la tête dans le mur »
Un différend oppose l’Auberge du Rond-point, restaurant emblématique de l’île, à la municipalité de Mamoudzou et aux propriétaires d’un bâtiment en construction adjacent au leur. L’affaire a été portée devant le tribunal administratif de Mamoudzou en fin d’année dernière. Les protagonistes attendent désormais le jugement du Conseil d’État, saisi par la défense.
A peine une heure avant le début du service, à 11h, les employés finissent de préparer les tables ; ils ajustent les nappes, alignent soigneusement les couverts, vérifient la propreté des verres. Dehors, ciel bleu et grand soleil, mais dans la salle règne davantage une atmosphère de début de soirée. « On est dans l’obscurité ! », constate amèrement Michel Dal Piaz, cuisinier et associé dans l’exploitation de l’Auberge du Rond-Point à Mamoudzou. Juché au-dessus de la route nationale, au croisement entre la rue du Commerce et la rue Mahabou, le restaurant était connu pour son panorama imprenable sur l’embarcadère de la barge, le lagon et la Petite-Terre. Désormais, à quelques dizaines de centimètres des tables placées en façade, un mur de parpaings gris – le troisième étage d’une construction nichée en contrebas – fait écran, entrave la vue et bloque une bonne partie de la lumière extérieure.
« Quand on a vu qu’ils démarraient les travaux, on n’a rien dit. Un étage, deux étages… on n’était pas surpris. Ici, les travaux d’agrandissement sont courants », raconte le cuisinier. « Mais quand ils ont attaqué le troisième étage, et que c’est arrivé à notre niveau, on a pris peur ! » Décontenancés, les restaurateurs se renseignent alors auprès de la mairie : un permis de construire a bien été délivré par l’ancienne municipalité en 2015, modifié en 2016 et prorogé en 2019. Par une requête du 29 septembre 2022, Anne-Marie Vautrin, gérante de l’Auberge du Rond-point, en demande la suspension. Elle soutient que ledit permis n’a jamais été affiché sur le terrain correctement. « Avec le panneau, on aurait pu voir le permis et être alertés par la hauteur prévue », déplore son associé. Au tribunal administratif de Mamoudzou, la défense avance que ce recours ne respecte pas le délai raisonnable prescrit par la loi et intervient trop tard. Le propriétaire* soutient que l’affichage a été continu et lisible pendant de nombreuses années.
Un mur à soixante-dix centimètres des tables
Le tribunal écarte les fins de non-recevoir opposés en défense, et par son ordonnance du 26 octobre 2022, somme l’arrêt des travaux sous 48 heures. Le chantier est au point mort, mais le mur est bel et bien là, à 70 centimètres des tables de l’auberge. Grâce à une clientèle fidèle, les restaurateurs ont su garder la tête hors de l’eau. « C’est surtout au niveau du standing qu’on a pris un coup. Les gens sont mécontents en voyant ça, et quelques-uns s’en vont… », regrette Michel Dal Piaz, qui a par exemple vu un banquet de 80 personnes annulé par cette vue gâchée.
Contestant la décision du tribunal administratif, « la ville de Mamoudzou a saisi un cabinet d’avocat pour faire appel devant le Conseil d’État de l’ordonnance décidant de la suspension de l’arrêté municipal accordant permis de construire. Le mémoire a été transmis le 10 novembre 2022. La Ville est en attente de la décision du Conseil d’État », rapporte la municipalité, précisant qu’elle « prendra les dispositions nécessaires pour répondre [de] la légalité de l’arrêté municipal accordant permis de construire ». De son côté, le propriétaire du bâtiment en construction aurait également formé un pourvoi en cassation. « On attend le résultat. S’il est en notre défaveur, on reportera plainte et on demandera la destruction de ce troisième étage », prévoit le restaurateur. « On ne peut pas nous emprisonner dans notre commerce comme ça ! »
*Contactée, la famille propriétaire du bâtiment n’a pas souhaité donner suite à notre sollicitation.
« Il est important que les habitants de Bouéni accèdent facilement aux soins »

Une journée de sensibilisation à la santé s’est déroulée, ce mercredi 18 janvier, à la MJC de Bouéni. Axée autour du diabète, elle a réuni différents acteurs de la santé intervenant sur cette maladie. Chacun pouvait, à son rythme, découvrir les différents stands d’informations, de dépistages et les ateliers présents.
Faire venir des spécialistes dans le désert médical mahorais n’est jamais une chose aisée. L’événement de ce mercredi accueillait, en complément à l’action de dépistage du diabète et de l’hypertension artérielle, des médecins spécialisés venus de La Réunion. Les patients ont donc pu être reçus par un endocrinologue, un dermatologue et un podologue pour des consultations médicales. La commune de Bouéni, de par sa situation géographique est éloignée du chef-lieu de Mayotte, là où sont regroupés la plupart des professionnels de santé. « Il est important de permettre aux habitants de notre commune d’accéder plus facilement aux soins », ajoute Roukaya Fadul, la directrice du centre social. La finalité de cette opération serait de la rendre cyclique et la mettre en place « tous les trois mois », espère-t-elle.
Lors de cette journée de sensibilisation, les visiteurs ont pu découvrir différents stands d’informations, comme celui notamment du comité régional olympique et sportif (CROS) de Mayotte, qui présentait son dispositif de Maison du Sport Santé, implanté sur la commune. « C’est un dispositif de prise en charge en activité physique et en diététique », explique Manon Darcel-Droguet, cheffe de service au CROS. L’hôpital à domicile, les aides aux soins à domicile, les soins infirmiers étaient autant de sujets autour desquels les visiteurs pouvaient échanger et découvrir avec les différents stands, le but étant de pouvoir « sensibiliser le plus grand nombre et accompagner au mieux les habitants », affirme la directrice. Le réseau diabète, Rédiab’Ylang sensibilisait quant à lui, la population à l’alimentation saine et équilibrée. Pour le réseau, il est important de se dépister, « car beaucoup de gens s’ignorent, c’est une maladie silencieuse, mais une fois que les symptômes sont là, souvent les complications aussi ».
Un « pirate de la cuisine » en démonstration
En continuité du sujet de l’alimentation, un atelier était proposé par Nacer Bedja, alias « Le pirate de la cuisine » et permettait de présenter ce qu’est l’équilibre alimentaire. Au programme de son atelier, des jeux sur l’alimentation saine et malsaine, d’autres portant sur la comparaison entre les aliments transformés et les produits frais ou encore le grammage réel de sucres dans les boissons sucrées. En milieu de journée, le chef a proposé la réalisation d’une assiette équilibrée, avec des produits frais et locaux.
Cette action était donc l’occasion pour toutes et tous d’en découvrir davantage sur la santé et plus particulièrement le diabète et comment l’accompagner. Afin de toucher le plus grand nombre de personnes, elle était ouverte à toute la population de la commune de Bouéni, « pas seulement aux personnes âgées, ni aux personnes inscrites à des rendez-vous médicaux, mais aussi et surtout, à leurs accompagnants », confirme Roukaya Fadul.
A Mayotte, selon l’étude « Unono Wa Maoré », réalisée en 2019, 12 % des plus de 18 ans sont diabétiques et 17% des 30-69 ans sont atteints de cette maladie, ce qui représente une personne sur six.
Thani Mohamed Soilihi, sénateur mahorais

Retrouvez l’intégralité du classement des 30 personnalités les plus influentes de Mayotte dans le Mayotte Hebdo n°1026, paru ce vendredi 13 janvier. Ce jeudi, vous pouvez lire l’interview et le portrait du deuxième du classement, le sénateur Thani Mohamed Soilihi.
https://www.mayottehebdo.com/mayotte_hebdo/
Flash Infos : Centre éducatif fermé, augmentation des forces de l’ordre sur l’île, les idées que vous défendez semblent faire mouche cette année ?
Thani Mohamed Soilihi : C’est une année qui ressemble aux autres, on est enfin revenu à une année normale après la crise du coronavirus. J’ai continué à me consacrer à mes travaux parlementaires et avancé sur des sujets qui me tiennent à cœur. Ça peut sembler parfois long, car je sais que les citoyens mahorais veulent des résultats tout de suite.

F.I. : Vous avez été l’un des acteurs de la loi Mayotte. Mise au placard en 2022, elle pourrait revenir sur la table, comme l’a laissé entendre Gérald Darmanin. Est-ce que ce sera pour cette année ?
T.M.S. : Je vais d’abord revenir sur l’échec de la première tentative. C’est la faute de tout le monde si on n’a pas réussi à y aboutir. Mais comme je le disais en novembre, il y a déjà des mesures qui sont prises sans cette loi. Tout n’est pas réductible à un texte. Les quatre nouvelles unités de gendarmerie, les forces de l’ordre supplémentaires, il n’y a pas eu besoin de loi. Ce que j’espère cependant, c’est qu’avec cette loi, on avance sur les volets social, sanitaire, économique et institutionnel. Sur ce dernier point, on doit passer à un mode de scrutin régional et avoir des élus en quantité suffisante pour assurer toutes les compétences nécessaires.
F.I. : Vous venez d’intervenir au cours d’un colloque consacré au foncier en outre-mer. Le sujet est-il toujours un cheval de bataille ?
T.M.S. : C’était très intéressant puisque ce sont les notaires de métropole qui étaient amenés à s’exprimer sur les indivisions en outre-mer. J’étais triplement réjoui, puisque je travaille sur ce sujet depuis que j’ai intégré la délégation d’outre-mer. C’est une bonne chose que le notariat de France se préoccupe de la question, même si ce n’est pas la première fois. Enfin, la présidente du la commission d’urgence foncière (CUF) est intervenue et celle-ci commence devenir un modèle pour les autres départements. Tous ces échanges pourraient se traduire ensuite en texte de loi.
F.I. : Justement, seriez-vous prêts à rédiger une nouvelle loi sur le sujet ?
T.M.S. : J’attends d’abord l’état des lieux. Mais oui, je suis prêt à dégainer si besoin. Cependant, j’ai toujours privilégié le véhicule le plus rapide. Je ne cherche pas forcément à voir une loi à mon nom. On peut très bien avancer par des amendements.
F.I. : Année des sénatoriales oblige, confirmez-vous votre candidature ?
T.M.S. : Je serai candidat. J’ai même commencé ma campagne. Je n’ai pas pour habitude de m’y prendre au dernier moment.
F.I. : Étant du même bord politique que le gouvernement, vous semblez être l’interlocuteur privilégié sur l’île.
T.M.S. : J’assume de soutenir le président de la République. Je ne fais pas forcément sa campagne à Paris, mais plutôt à Mayotte. J’ai connu deux présidents de la République avant lui [N.D.L.R. Nicolas Sarkozy et François Hollande] et je pense sincèrement qu’Emmanuel Macron met les moyens sur la table pour donner une chance au développement de Mayotte. Ça ne veut pas dire qu’il faut se satisfaire de tout. Mais pour moi, les violences que connaît le territoire sont une conséquence de l’inaction précédente. Je n’oublie pas non plus des problèmes de l’eau et de l’éducation. Mais quand une bombe explose, est-ce que le responsable est celui présent à ce moment-là ou celui qui a allumé la mèche ? Pour ce qui est du rôle d’interlocuteur privilégié, ça me va très bien. J’assume pleinement.
F.I. : Du fait de cette proximité, est-ce que vous pourriez devenir ministre des Outre-mer ?
T.M.S. : Je ne pourrais pas vous répondre, je fais le boulot. Quand j’ai commencé mon premier mandat, et même mon second, je ne pensais pas devenir vice-président du Sénat (de 2017 à 2020). Je suis dorénavant vice-président de la commission des lois et les collègues m’ont fait l’honneur d’intégrer le comité de déontologie du Sénat.
F.I. : Que souhaitez-vous aux Mahorais pour la nouvelle année ?
T.M.S. : Au-delà des vœux classiques de santé et de prospérité, il y a une chose qui exaspère la population mahoraise, c’est le yoyo des violences. C’est-à-dire qu’elles reviennent de façon incessante. Ça joue sur le moral des autres. Ça serait un soulagement qu’il n’y ait plus d’actes de violence. On sait très bien que qu’elles réapparaissent quand les chefs de bandes sortent de prison, alors que je pense qu’on a les moyens d’anticiper.
Cinquante ans de Sada et onze ans de Sénat
À Sada, la politique n’est jamais loin. Thani Mohamed Soilihi en est l’exemple même. Voilà onze ans que l’avocat originaire du sud est sénateur du territoire mahorais. D’abord socialiste, il a rejoint La République en marche au moment où Emmanuel Macron arrive au pouvoir. Un choix payant puisque, apprécié par le pouvoir en place, il a gravi les échelons et a pu prendre, de 2017 à 2020, un poste de vice-président du Sénat dévolu à son parti. Apprécié du gouvernement, il est souvent loué pour son travail quand les ministres se déplacent sur l’île aux parfums.
L’homme toujours prompt à défendre son île n’a eu de cesse de travailler pour elle. En 2019, il est à l’origine du décret portant sur la limitation du droit du sol aux enfants dont au moins un parent est en situation régulière depuis trois mois sur le territoire. Il a également œuvré pour la loi Mayotte (qui comportait des mesures sur l’immigration, la santé, le social, la sécurité et les institutions) finalement mise au placard, avant l’élection présidentielle de 2022. Regrettant « un manque de communication », il espère que son travail sera repris cette année, comme l’a laissé entendre Gérald Darmanin, lors de sa dernière visite à Mayotte. Autre proposition à mettre à son actif, celle annoncée par Éric Dupond-Moretti sur un centre éducatif fermé en 2024. « Un outil nécessaire pour juguler la flambée de violences sur l’île », défend le Sadois.
À 50 ans, le parlementaire ne compte pas s’arrêter là et envisage de se représenter aux sénatoriales en septembre. « Si elles étaient aujourd’hui, je dirais que je suis candidat », nous a-t-il confié le 3 novembre, au cours de son dernier bilan annuel.
« Espérer suivre la croissance démographique, c’est effectuer les douze travaux d’Hercule »
En amont de l’atelier international sur la résilience et l’équilibrage du département de Mayotte, du 29 janvier au 7 février, une réunion préparatoire a eu lieu ce mercredi 18 janvier sur le thème de la pression démographique. Totalement en visio-conférence, la réunion a permis à quelques élus locaux de donner leurs avis sur le sujet.
Dans une dizaine de jours, le travail préparatoire d’un an va déboucher sur l’atelier international sur la résilience et l’équilibrage du département (voir encadré), un événement très attendu par les élus pour les aider à construire le Mayotte de demain. Et sur l’île, il est difficile de penser à l’avenir sans aborder la question de la pression démographique, la population ayant doublé en vingt ans. Piloté par l’architecte-urbaniste Ning Liu et l’urbaniste Céline Rouy, le projet a donc intégré une table ronde sur le sujet, ce mercredi midi. La première explique que quatre thématiques ont été retenues. « La première est la jeunesse de la population. Elle représente l’avenir de Mayotte. La seconde est le besoin de logements neufs, sans oublier qu’il y a encore un très grand nombre de quartiers informels. La troisième est un enjeu plus récent puisqu’il s’agit du changement climatique. La dernière concerne l’économie et la création de l’emplois. On a déjà parlé de l’économie bleue et de l’économie digitale », rappelle-t-elle.
Mais sur la pression démographique, c’est davantage la parole des élus mahorais qui étaient attendus. Ancien député, Ibrahim Aboubacar a eu le privilège d’être le premier intervenant. « Espérer suivre la croissance démographique, c’est effectuer les douze travaux d’Hercule », clame celui qui dit « avoir une liberté de ton » depuis qu’il n’a plus de mandat. Il reprend le chiffre de l’Insee qui estime à 300.000 habitants la population vivant sur le territoire, sans oublier toutefois que des élus préfèrent celui de « 400.000 ». Parmi les grands défis, il évoque la natalité, les ressources naturelles et insiste : « la bataille de l’éducation et de la formation sont les clés pour tout le reste ».
Un rééquilibrage nécessaire
Tous ont relevé le besoin d’un rééquilibrage du territoire. Un tiers de la population et une très grande partie de l’activité économique de l’île se concentrent sur Mamoudzou, « sur le nord-est de Mayotte », précise Salime Mdéré. Le premier vice-président du Département a présidé la majeure partie de la table ronde avant de s’absenter pour une autre réunion. Ambdiwahedou Soumaïla, le maire de Mamoudzou, a défendu sa commune, faisant remarquer qu’il était « toujours heureux d’accueillir les 2/3 de Mayotte la semaine ou le week-end ». Il l’a également fait quand Ning Liu a demandé « comment faire face à ce problème d’insécurité ? ». L’élu a rappelé, comme lors des vœux de la ville, la semaine précédente, le renforcement de sa police municipale et l’éclairage public sur les grands axes.
Le maire de la plus grande ville du département est allé même plus loin sur la question de la démographie en invitant les participants à « ne plus se projeter » sur une hausse du nombre d’habitants (évalué entre 440.000 et 760.000 en 2050). Celui-ci prône davantage « une décroissance démographique », sans toutefois donner les moyens d’y arriver. « Notre territoire n’est pas extensible. Nous devons savoir comment contenir la croissance démographique », fait-il observer aux urbanistes et architectes plutôt à même de chercher des solutions d’aménagement que de se pencher sur la politique nataliste de l’île.
Des stratégies élaborées pour Mayotte
Cette table ronde, ainsi que celle de ce lundi prochain sur le changement climatique, est un travail préparatoire de l’atelier qui commencera le dimanche 29 janvier. Pendant dix jours, une douzaine de professionnels de l’urbanisme (architectes, urbanistes,…). vont plancher (en deux équipes) sur des stratégies à adopter sur le territoire pour lui garantir un avenir plus serein. Le 7 février, jour de clôture, un jury international sera amené à donner son avis sur les propositions. Organisé par l’association des Ateliers de Cergy, avec l’aide du conseil départemental pour cette édition, ce type d’événement a déjà eu lieu partout à travers le monde et accueille des professionnels du monde entier dorénavant.
Comores : Le président Azali Assoumani dit assumer l’exclusion des binationaux
A une année des élections présidentielles et gubernatoriales, le parlement monocolore comorien a adopté une série de lois qualifiées de liberticides par une grande partie des opposants, notamment ceux qui détiennent d’autres nationalités étrangères, désormais interdits de briguer la magistrature suprême. Le président Azali entretient lui toujours le mystère sur sa candidature en 2024.
Le président Azali Assoumani a tenu sa toute première conférence de presse de l’année 2023, ce mardi, à Beit-Salam. L’occasion pour le chef de l’État comorien de revenir sur l’actualité nationale et internationale marquée surtout par la présidence de l’Union Africaine, poste que les Comores vont occuper pour une durée d’un an, à partir du mois de février prochain. Une consécration qui coïncide avec la tenue d’ici un an, de deux scrutins importants, à savoir l’élection du président de la République et celle des gouverneurs des îles. Azali Assoumani, qui tient encore le suspense quant à sa candidature de 2024, a émis le vœu de vouloir tirer les leçons du passé pour organiser des élections dans des meilleures conditions, invitant au passage ses opposants à venir y prendre part. Toutefois, cette main tendue suscite l’incompréhension. Depuis le mois décembre dernier, on assiste à l’adoption de plusieurs lois qui risquent de mettre des bâtons dans les roues aux potentiels candidats. Le texte qui est sur toutes les lèvres est celui qui interdit aux binationaux de se présenter à la course présidentielle. Pour briguer la magistrature suprême, il faut désormais être comorien de souche, selon une loi votée par les députés majoritairement acquis au parti présidentiel. Une disposition qu’Azali Assoumani assume, citant l’exemple des États Unis qui n’autorisent pas les binationaux à accéder à la Maison blanche. La même loi sur les modalités d’élection du président de la République instaure un système de parrainages. Ces changements des règles du jeu à l’approche des échéances électorales de 2024 serviront à assurer à l’actuel président sa réélection accusent les opposants. La plupart d’entre eux installés en France se sentent visés par ces batteries de lois.
Sur ce volet diplomatique, le prochain président de l’UA, reste convaincu que l’archipel dispose des épaules pour diriger l’institution panafricaine. « Je me suis déjà entretenu avec mon homologue sénégalais, Macky Sall. J’appelle donc à l’unité de tous les Comoriens car tout le monde aura son rôle à jouer y compris les médias comoriens », a déclaré, le président du pays, ce mardi. Il n’a en revanche pas souhaité décliner son agenda ni dévoiler les points du programme qu’il comptait mettre en œuvre une fois à la tête de l’Union Africaine. Il dit attendre d’abord son investiture.
Attouchements à l’ORTC
Lors de ce point de presse, les journalistes ont saisi cette opportunité pour interpeller leur conférencier en lui posant certaines questions relatives à la vie quotidienne des Comoriens. Ces derniers subissent depuis plusieurs mois de plein fouet une inflation extraordinaire. Aucun produit de consommation n’est épargné, surtout les produits carnés à l’instar des ailes de poulet très consommées. Pire, les notes et arrêtés signés par les autorités pour encadrer les prix ne sont pas respectés. Le consommateur n’a d’autre choix que de se soumettre pour éviter de mourir de faim. En réponse à ces doléances, le locataire de Beit-Salam a promis d’apporter des solutions. Les fonctionnaires ont déjà obtenu une augmentation de leurs salaires a-t-il fait valoir. Un déploiement des forces publiques pour veiller au respect des prix a également été annoncée. Le bémol souvent de ces genres d’opérations, c’est qu’elles ne durent que quelques jours au grand dam de la population qui se retrouve livrée à elle-même. Présent à Beit-salam, le syndicat des journalistes comoriens (SNJC) n’a pas oublié d’énumérer les difficultés auxquelles les médias sont confrontés. Dans son discours de vœux, la vice-présidente du SNJC, Adjouza Abouheir, est revenue par exemple sur les cas d’harcèlements et attouchements dont sont victimes certaines journalistes de l’office de radio et télévision des Comores (ORTC). Un responsable de la télévision nationale userait de son pouvoir pour exiger certaines faveurs sexuelles en échange de promotions.
Des révélations qui ont fait réagir le président Azali Assoumani, lequel a souligné que l’endroit n’était pas le lieu approprié pour faire part de telles revendications avant d’appeler les victimes à porter plainte. Reste à savoir si une enquête sera ouverte ou pas. L’affaire risque en tout cas de faire grand brui
Préfecture et Mamoudzou en « reconquête foncière » à Doujani 3
Le quartier Doujani 3 a commencé à être décasé, ce mardi. L’opération, qui concerne 160 maisons en tôle et en dur, s’effectue sur deux jours. Presque 500 personnes vivaient dans ce secteur situé entre les villages de Doujani et Passamaïnty.
Les derniers matelas émergent des cases en tôle, les sacs sont portés à la va-vite devant les gendarmes mobiles qui attendent les ordres. Les familles avaient été prévenues ces dernières semaines du décasage, mais beaucoup étaient encore présentes, ce mardi matin, dans les baraques étalées sur la colline entre Doujani et Passamaïnty. Selon l’enquête sociale réalisée par l’Acfav, 467 habitants composeraient ce quartier informel qui couvre une cinquantaine d’hectares. Quelques-uns ont déjà quitté les lieux. Les autres ramassent leurs affaires, puis suivent à distance l’opération commencée à 6h15. Les premières pelleteuses arrivent, elles, une demi-heure plus tard et abbatent les premiers murs pour se frayer un chemin vers le haut. Gendarmes et policiers (voir encadré) suivent de très près les machines, ainsi que les agents d’Électricité de Mayotte venus enlever les raccordements.
Le décasage de #Doujani 3 a commencé par le haut du quartier, ce mardi matin. Le maire de #Mamoudzou, #Ambdilwahed ouSoumaila, et le @Prefet976 sont sur place. pic.twitter.com/eIdmMb9HSU
— Mayotte Hebdo (@MayotteHebdo) January 17, 2023
123 personnes ont accepté un relogement
Le décasage, préparé depuis un an, a été freiné par des recours, ces derniers mois. « On les a tous gagné », rappelle Daniel Gros. Le représentant de la Ligue des droits de l’homme est loin de s’en satisfaire. Ce qui l’attriste ce matin, c’est que les personnes à reloger sont emmenés le matin même, au milieu des départs précipités. Le préfet de Mayotte, Thierry Suquet, ne partage le même avis. Celui-ci défend « avoir mis à l’abri 120 personnes, ce matin. On a soit proposé du logement soit de l’hébergement, ça dépend des situations ». « Il a été commencé en amont de l’opération. Mais vous savez très bien que si on fait ça trop en amont, le quartier est à nouveau occupé. » Selon l’enquête sociale, 123 personnes ont effectivement accepté un relogement. Les autres ont soit refuser de répondre soit décliner un hébergement ailleurs qui ne serait que temporaire.
Pour le préfet de Mayotte, « 160 cases sont démolies » à Doujani, ce jour-là. Un autre décasage est d’ores et déjà prévu à « Koungou ». « Depuis le mois de septembre, onze mairies de Mayotte m’ont saisi pour mettre en œuvre des décasages. On va travailler avec elles », prévient-il.
Une zone dans le viseur de la municipalité
Arrivé en même temps que le préfet, le maire de Mamoudzou est rapidement monté sur les hauteurs pour regarder le quartier jonché de tôles. Les terrains, qui appartiennent à des privés et à la collectivité, sont au cœur d’un projet municipal. « L’enjeu à Doujani, c’est que nous sommes sur une zone d’aménagement concerté (ZAC). Demain, l’ambition de la mairie est de faire de Doujani le premier quartier connecté de Mayotte. Cela nécessite de reconquérir le foncier », indique Ambdilwahedou Soumaïla. L’élu rappelle qu’une opération de 1.000 logements est prévue à Doujani, tout comme « deux salles de cinéma », « un gymnase » et « des écoles ».
Est-ce que l’opération du jour ne va pas repousser encore le problème ailleurs. Les jeunes qui regardent d’un mauvais œil les travaux de démolition ne sont pas loin de le penser. « Ce sont nos maisons. On va aller où maintenant ? », déplore l’un d’eux. « Il faut qu’on arrive à maîtriser notre foncier. Chacun à notre niveau doit le faire. […] On ne doit plus subir l’aménagement. Il convient de changer de paradigme », défend le maire, qui veut réunir les élus et les institutions au cours de prochaines « Assises de la reconquête foncière ». Celui-ci est interpellé quelques minutes plus tard par une jeune femme. « Il est où mon relogement monsieur le maire ? », lance-t-elle, alors que l’élu redescend vers le bas du quartier épargné jusque-là par les pelleteuses.
26 étrangers en situation irrégulière expulsés
Gendarmes mobiles, Raid, police aux frontières, municipale et nationale, les forces de l’ordre étaient en nombre, ce mardi matin. Quelques pierres ont volé, mais les hommes du Raid et des gendarmes mobiles ont vite investi les hauteurs. La présence de la police devrait rester importante ce mardi soir pour éviter des heurts en réaction au décasage.
Comme l’a rappelé le préfet, il reste très peu d’étrangers en situation irrégulière au moment de l’opération. Selon nos informations, « 26 étrangers en situation irrégulières ont été interpellés au cours de trois opérations ayant eu lieu dans les semaines précédentes ».
Le Département « à pied d’œuvre pour porter inlassablement la voix de Mayotte »

Ce mardi après-midi, c’était au tour du conseil départemental de Mayotte de se prêter au jeu de la cérémonie des vœux. Réalisé pendant deux années virtuellement, l’événement s’est déroulé sur le parking du cinéma Alpa Joe à Mamoudzou, « un véritable symbole du renouveau d’un équipement très attendu. Je ne pouvais manquer ce clin d’œil au 7e art », note le président du conseil départemental en préambule. Après un temps de retrouvailles, Ben Issa Ousseni a recensé les projets passés et futurs du territoire.
C’est un constat, l’année écoulée a été marquée par un haut niveau de violence. « Avec cette violence quotidienne, l’attractivité du territoire s’en trouve affectée », se désole le président. Face à cela, le Département continue d’agir notamment sur la question des transports scolaires, avec un budget de 43 millions d’euros annuels consacrés à ce dossier. « Parce que nul ne peut accepter de laisser quelques fauteurs de troubles terroriser les élèves, les chauffeurs ou endommager les matériels de transports », déclare l’élu.
La question des déplacements et de la mobilité sur le territoire est également au cœur des préoccupations. « On ne peut pas accepter que les habitants mettent trois à quatre heures pour se rendre au travail quotidiennement », souffle le chef de la majorité départementale, qui a lutté un bon moment sans ses lunettes pour lire son discours. Les projets pour résoudre cette problématique sont nombreux. En effet, les dossiers évoqués portent sur les gares maritimes, le contournement de Mamoudzou par le haut ou encore le déploiement du Caribus à l’échelle du territoire de la Cadéma (Communauté d’agglomération Dembéni-Mamoudzou). En plus de ces projets, vient s’ajouter le sujet de la déconcentration du lieu de travail dans le chef-lieu, toutes ces perspectives « sont autant de pistes qui doivent avancer de façon très concrètes », confirme le président.
Pouvoir d’achat et Jeux des Iles
En 2022, le pouvoir d’achat des Mahorais(e)s a été l’une des thématiques travaillées par le conseil départemental. « Nous avons agi concrètement pour le pouvoir d’achat des habitants de l’île », explique Ben Issa Ousseni. Cela s’est traduit par notamment la réduction appliquée sur les prix de l’essence. En complément, la fiscalité départementale a été diminuée depuis le 1e décembre, pour une durée de six mois. « Cette mesure est renouvelable une fois, pour une durée de six mois supplémentaires », ajoute-t-il.
Au cours de l’année passée, Mayotte s’est également positionnée en tant que candidate à l’organisation à la douzième édition des Jeux des îles de l’océan Indien pour 2027 (Retrouvez le numéro 1023 du Mayotte Hebdo sur ce sujet). Ce grand moment sportif pour la région est, pour Ben Issa Ousseni, « un formidable accélérateur du développement de nos équipements et infrastructures ». L’accueil de ces jeux, représenterait un « véritable levier » et une mise en avant du « mouvement sportif » de l’île. Le dossier de candidature devait d’ailleurs être bouclé avant la fin de l’année.
L’année passée a vu la reprise des grands rendez-vous culturels, associatifs ou encore institutionnels au travers du territoire mahorais, mais aussi l’inscription du maoulida shengué au patrimoine immatériel national de l’Unesco. Ces différents événements ont pu faire rayonner le 101e département au-delà de ses frontières. Maintenant, « 2023 est désormais là et nous sommes à pied d’œuvre pour porter inlassablement et partout la voix de Mayotte avec celles et ceux se reconnaissent dans ce combat », lance fièrement le président de la collectivité.
Des personnalités mahoraises récompensées
Cette cérémonie des vœux a également été l’occasion pour le conseil départemental de mettre à l’honneur « des personnalités qui ont porté haut la voix de Mayotte », affirme Ben Issa Ousseni. Ce sont donc trois ambassadeurs qui ont été distingués par le président du conseil départemental. En premier lieu, Géniale Attoumani, qui est la première journaliste de Mayotte à présenter le journal dans un média national. Feyçoil Mouhoussoune est également nommé ambassadeur pour la création du premier data center. « Cet entrepreneur a mis Mayotte sur les rails de la modernité », fait remarquer le président du Département. La troisième personnalité est la chanteuse Zily. En parallèle, le docteur Martial Henry a également été honoré dans la matinée « au nom du département et de Mayotte pour tous les services qu’il a rendus et qu’il rend à notre territoire », concède Ben Issa Ousseni. Alors que les Jeux des Iles approchent, le sprinteur mahorais Kamel Zoubert a aussi été récompensé. Le récent vainqueur du 200m du meeting des Volcans (Puy-de-Dôme) a reçu des nouvelles chaussures des mains de Zouhourya Mouayad Ben, vice-présidente du Département en charge des sports.