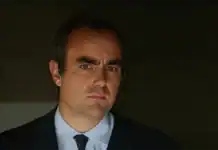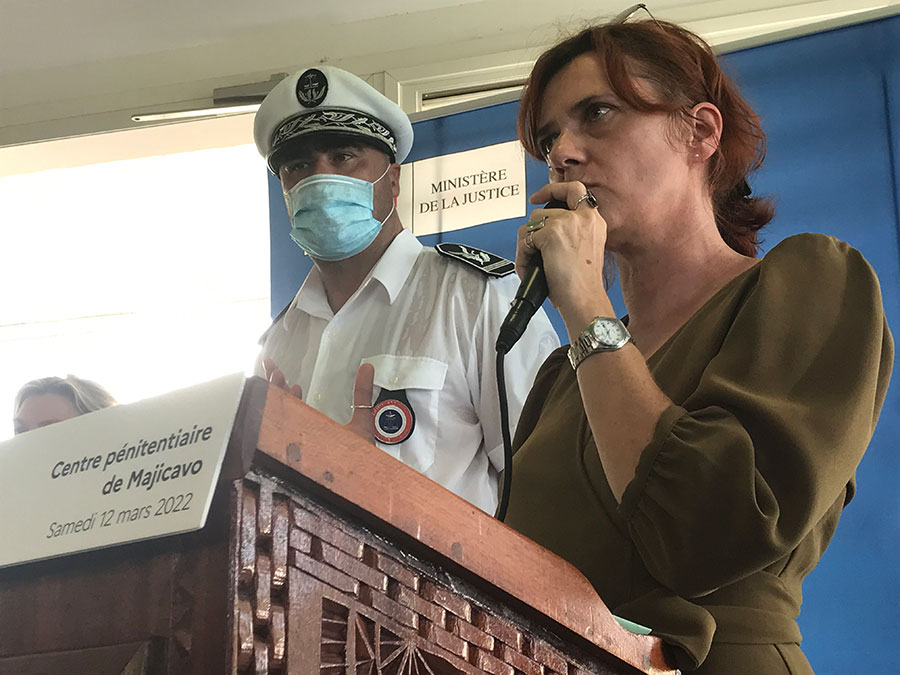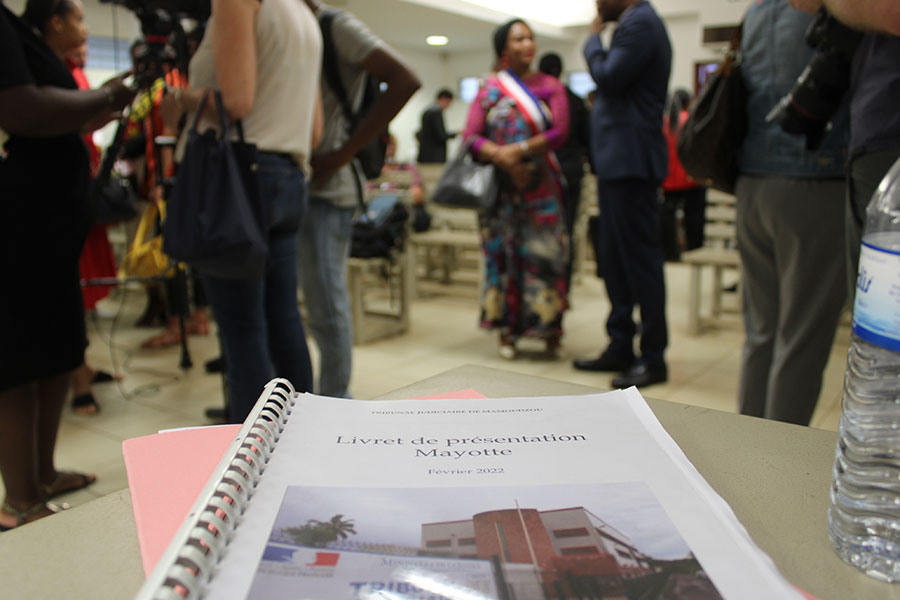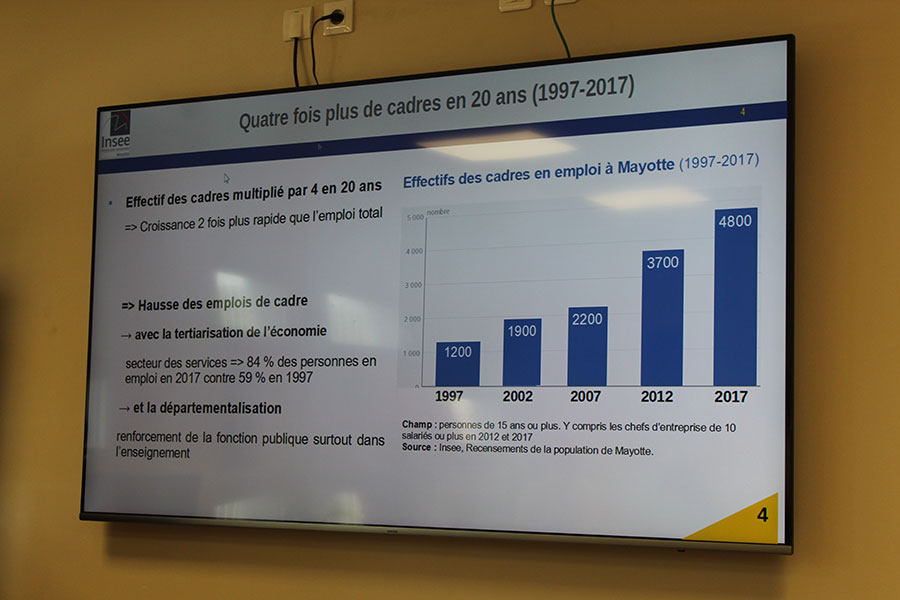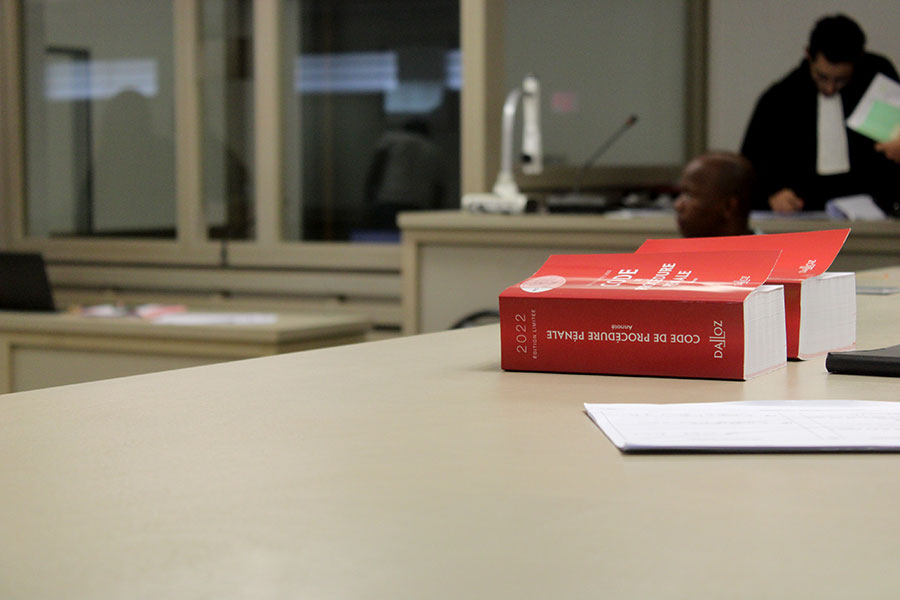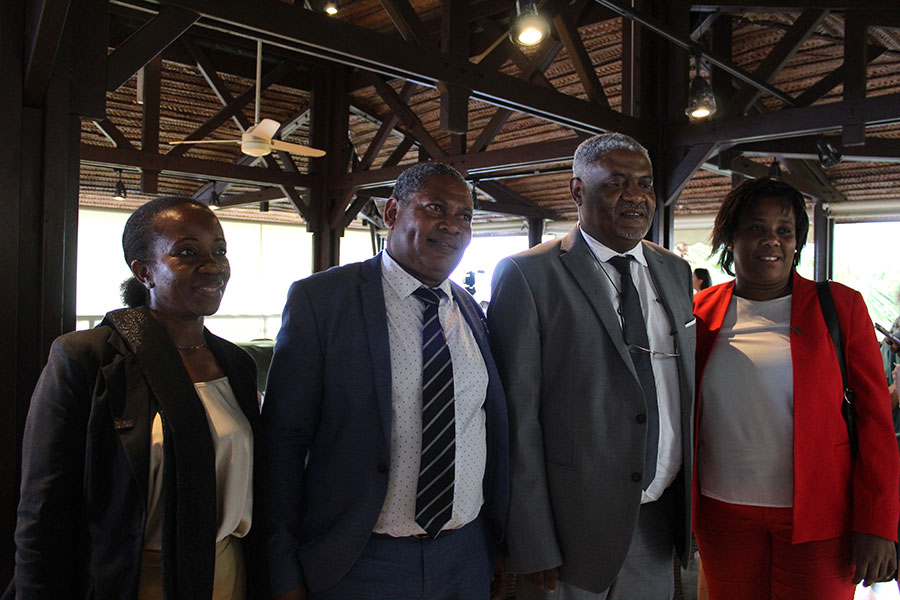? Trophée sport/santé de l’année :
Le club d’athlétisme de Mamoudzou, représenté par son président, Michel Latour :
 « Notre club organise toute l’année des activités sportives pour tous et plus particulièrement pour les jeunes, les personnes âgées et les femmes éloignées de toute activité sportive. Nous proposons des activités sportives pour les femmes durant tout le mois de mars dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes qui, pour nous, ne se limite pas à une seule journée. La prochaine manifestation sera la randonnée des marches d’Acoua le 27 mars prochain. »
« Notre club organise toute l’année des activités sportives pour tous et plus particulièrement pour les jeunes, les personnes âgées et les femmes éloignées de toute activité sportive. Nous proposons des activités sportives pour les femmes durant tout le mois de mars dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes qui, pour nous, ne se limite pas à une seule journée. La prochaine manifestation sera la randonnée des marches d’Acoua le 27 mars prochain. »
? Trophée Handisport :
L’association Handicapable de Mayotte, représentée par son président d’honneur, Miktar M’Dallah :
 « Je remercie tous les Mahorais qui ont voté pour moi ainsi que la maison départementale des personnes handicapées. C’est avec beaucoup d’émotion que notre association reçoit ce trophée ! »
« Je remercie tous les Mahorais qui ont voté pour moi ainsi que la maison départementale des personnes handicapées. C’est avec beaucoup d’émotion que notre association reçoit ce trophée ! »
? Trophée arbitre féminin/trophée arbitre masculin
Soazara Sulleman (arbitre féminine au sein de la ligue régionale de Basket de Mayotte) :
« Je suis très heureuse, je ne m’y attendais pas. Tout ce que je fais, ce n’est pas pour être récompensé. Je le fais pour moi et je suis très heureuse de le faire, mais si derrière des gens reconnaissent mon travail et décident de me récompenser, ça ne peut que me rendre encore plus heureuse. »
Robin Pieras (arbitre masculin au sein de la ligue régionale de Basket de Mayotte) :
 « Je remercie mon club, le Golden Force de Chiconi, toutes les personnes qui ont voté pour moi. Je voudrais aussi passer un message d’encouragement à mes camarades arbitres qui officient tous les week-ends dans des conditions difficiles. Nous sommes tous acteurs du jeu au même titre que les entraîneurs, les joueurs ou les dirigeants. À ce titre-là, nous sommes tous des partenaires pour faire avancer le sport. Je termine en encourageant tout jeune ou moins jeune qui souhaite se lancer dans l’arbitrage : faites-le, vous ne le regretterez pas ! Merci ! »
« Je remercie mon club, le Golden Force de Chiconi, toutes les personnes qui ont voté pour moi. Je voudrais aussi passer un message d’encouragement à mes camarades arbitres qui officient tous les week-ends dans des conditions difficiles. Nous sommes tous acteurs du jeu au même titre que les entraîneurs, les joueurs ou les dirigeants. À ce titre-là, nous sommes tous des partenaires pour faire avancer le sport. Je termine en encourageant tout jeune ou moins jeune qui souhaite se lancer dans l’arbitrage : faites-le, vous ne le regretterez pas ! Merci ! »
? Trophée de l’équipe féminine/masculine de l’année
Féminine :
Le Golden Force de Chiconi, représenté par le président du club, Ridjali Sandi :
![]() « Je suis surpris de cette récompense, mais elle montre le courage et l’envie de tout le monde. Je suis ému, merci beaucoup ! Je ne pensais vraiment pas qu’on allait recevoir ce trophée aujourd’hui. »
« Je suis surpris de cette récompense, mais elle montre le courage et l’envie de tout le monde. Je suis ému, merci beaucoup ! Je ne pensais vraiment pas qu’on allait recevoir ce trophée aujourd’hui. »
Masculine :
Association des Jumeaux de M’Zouazia, représentée par l’un des dirigeants, Darmi :
 « Ce trophée est une fierté et surtout une reconnaissance du travail fait durant toute une saison. Avant tout, je remercie tous ceux qui ont voté pour nous et surtout le village de M’Zouazia qui soutient le club. S’il n’y a pas le coach, le dirigeant et les joueurs, il n’y a pas d’équipe, mais le tout Mayotte était aussi derrière nous pour nous soutenir donc c’est une fierté. Notre travail a payé ! »
« Ce trophée est une fierté et surtout une reconnaissance du travail fait durant toute une saison. Avant tout, je remercie tous ceux qui ont voté pour nous et surtout le village de M’Zouazia qui soutient le club. S’il n’y a pas le coach, le dirigeant et les joueurs, il n’y a pas d’équipe, mais le tout Mayotte était aussi derrière nous pour nous soutenir donc c’est une fierté. Notre travail a payé ! »
? Trophée l’espoir féminin/masculin de l’année
Féminin :
Nazira Haroussi Madi (Montpellier Hérault Rugby), représentée par son père, Boinali Haroussi Madi :
 « Je suis très content pour mon enfant qui fait du rugby. Je l’ai toujours encouragée à faire du sport car le sport est une chose bien pour Mayotte. Ça n’a pas été facile de la laisser partir en métropole, mais je suis contente qu’elle représente Mayotte là-bas. »
« Je suis très content pour mon enfant qui fait du rugby. Je l’ai toujours encouragée à faire du sport car le sport est une chose bien pour Mayotte. Ça n’a pas été facile de la laisser partir en métropole, mais je suis contente qu’elle représente Mayotte là-bas. »
Masculin :
Warmed Omari (Stade rennais, football), représenté par son oncle, Chadouli Attoumani :
« Je suis très ému. Je n’ai appris la nomination de mon neveu à la cérémonie qu’aujourd’hui vers 17h. Je suis donc à la fois très surpris et très fier pour lui ! Dans notre famille, on a toujours aimé le football donc là on a au moins un garçon qui nous représente dans le domaine. Nous sommes très fiers d’avoir un footballeur professionnel dans notre village d’Handrema. Il faut que Warmed continue ! »
? Trophée de la Mahopolitaine/du Mahopolitain de l’année
Mahopolitaine :
Nasrane Bacar (SU Talence puis RC Mamoudzou), jointe par téléphone :
« Merci beaucoup, je suis très heureuse de réitérer cette victoire, je ne savais pas qu’il y avait autant de monde qui me suivait. Mon prochain objectif, c’est bien sûr les Jeux des Îles. J’ai beaucoup de fierté à appartenir au RC Mamoudzou car il y a beaucoup d’enjeux. On sent que le maillot, on ne le porte pas pour rien, donc je suis très heureuse. C’est vraiment un choix personnel que j’ai fait d’entrer dans cette équipe pour les Jeux des Îles justement ! »
Mahopolitain :
Kadri Moendadzé (Savoie Aix Maurienne Basket), joint par téléphone :
« Je remercie tous ceux qui ont voté pour moi et tous ceux qui me suivent, car cela fait un bon moment déjà que j’ai quitté Mayotte. Je suis très fier de ce titre aujourd’hui ! »
? Trophée du dirigeant de l’année :
Kami Alonzo président de l’association des Jumeaux de M’Zouazia, représenté par Darmi :
« Nous avons eu beaucoup de réussite grâce à Kami. Malgré les difficultés, il a été à l’écoute de tout le monde, a su remonter et encourager tout le monde. Il était là pour que chaque membre de l’équipe soit dans de bonnes conditions. »
? Trophée de l’entraîneur de l’année :
Djamaldine Ali, entraîneur des Jumeaux de M’Zouazia :
 « Je remercie tout d’abord Dzoumogné, mon village car c’est là que tout a commencé. Puis le village de Koungou où j’ai gagné encore et enfin M’Zouazia qui a permis à mon équipe de participer à la finale de la Coupe de France. Mon aventure va continuer aux Diables Noirs de Combani cette année. Je remercie beaucoup les Mahorais car ils étaient nombreux à nous suivre sur les ondes de Mayotte la 1ère, mais également le journaliste Aurélien Février qui nous a suivi partout. Je remercie également ma famille et ma femme, mais également les gens de M’Zouazia, car sans eux je ne serais pas là aujourd’hui. Mayotte vit des moments très difficiles et à travers ce challenge de la Coupe de France, Mayotte avait le sourire donc je suis très content ! »
« Je remercie tout d’abord Dzoumogné, mon village car c’est là que tout a commencé. Puis le village de Koungou où j’ai gagné encore et enfin M’Zouazia qui a permis à mon équipe de participer à la finale de la Coupe de France. Mon aventure va continuer aux Diables Noirs de Combani cette année. Je remercie beaucoup les Mahorais car ils étaient nombreux à nous suivre sur les ondes de Mayotte la 1ère, mais également le journaliste Aurélien Février qui nous a suivi partout. Je remercie également ma famille et ma femme, mais également les gens de M’Zouazia, car sans eux je ne serais pas là aujourd’hui. Mayotte vit des moments très difficiles et à travers ce challenge de la Coupe de France, Mayotte avait le sourire donc je suis très content ! »
? Prix spécial du jury :
Abdallah Hassani dit Coco Ratcha :
 « Mille merci aux Mahorais, aux élus notamment. J’ai contribué à l’évolution du sport en tant qu’athlète et ça me fait plaisir de voir qu’on a pensé à moi. Durant toutes ces années, Mayotte a vécu et évolué dans le sport. Aujourd’hui, grâce aux différents acteurs, le sport mahorais est connu au niveau national. Mayotte a évolué et trouvé sa place. J’espère qu’on ira encore plus loin, notamment avec l’organisation des Jeux des îles 2027 ».
« Mille merci aux Mahorais, aux élus notamment. J’ai contribué à l’évolution du sport en tant qu’athlète et ça me fait plaisir de voir qu’on a pensé à moi. Durant toutes ces années, Mayotte a vécu et évolué dans le sport. Aujourd’hui, grâce aux différents acteurs, le sport mahorais est connu au niveau national. Mayotte a évolué et trouvé sa place. J’espère qu’on ira encore plus loin, notamment avec l’organisation des Jeux des îles 2027 ».
? Trophée sportive/sportive de l’année :
Sportive de l’année :
Caroline Plust, Golden force Chiconi :
 « Je suis très fière et honorée de recevoir ce trophée ce soir. Je remercie tous les gens qui ont voté pour moi. Je suis très contente également que Golden Force ait reçu trois trophées ce soir ! J’envisage de jouer pour Mayotte l’année prochaine aux Jeux des Îles. C’est dans un coin de ma tête ! »
« Je suis très fière et honorée de recevoir ce trophée ce soir. Je remercie tous les gens qui ont voté pour moi. Je suis très contente également que Golden Force ait reçu trois trophées ce soir ! J’envisage de jouer pour Mayotte l’année prochaine aux Jeux des Îles. C’est dans un coin de ma tête ! »
Sportif de l’année :
Ben Dina Kamal, capitaine de Jumeaux de M’Zouazia :
 « Pour moi, ce trophée ne représente pas grand-chose, mais je dis merci à mon club et à mes parents qui me regardent ce soir. »
« Pour moi, ce trophée ne représente pas grand-chose, mais je dis merci à mon club et à mes parents qui me regardent ce soir. »