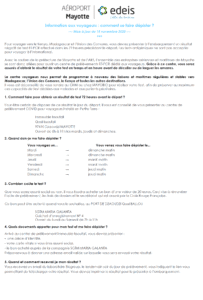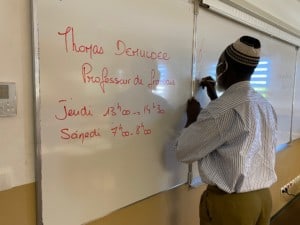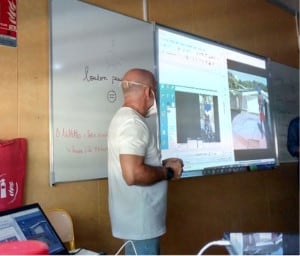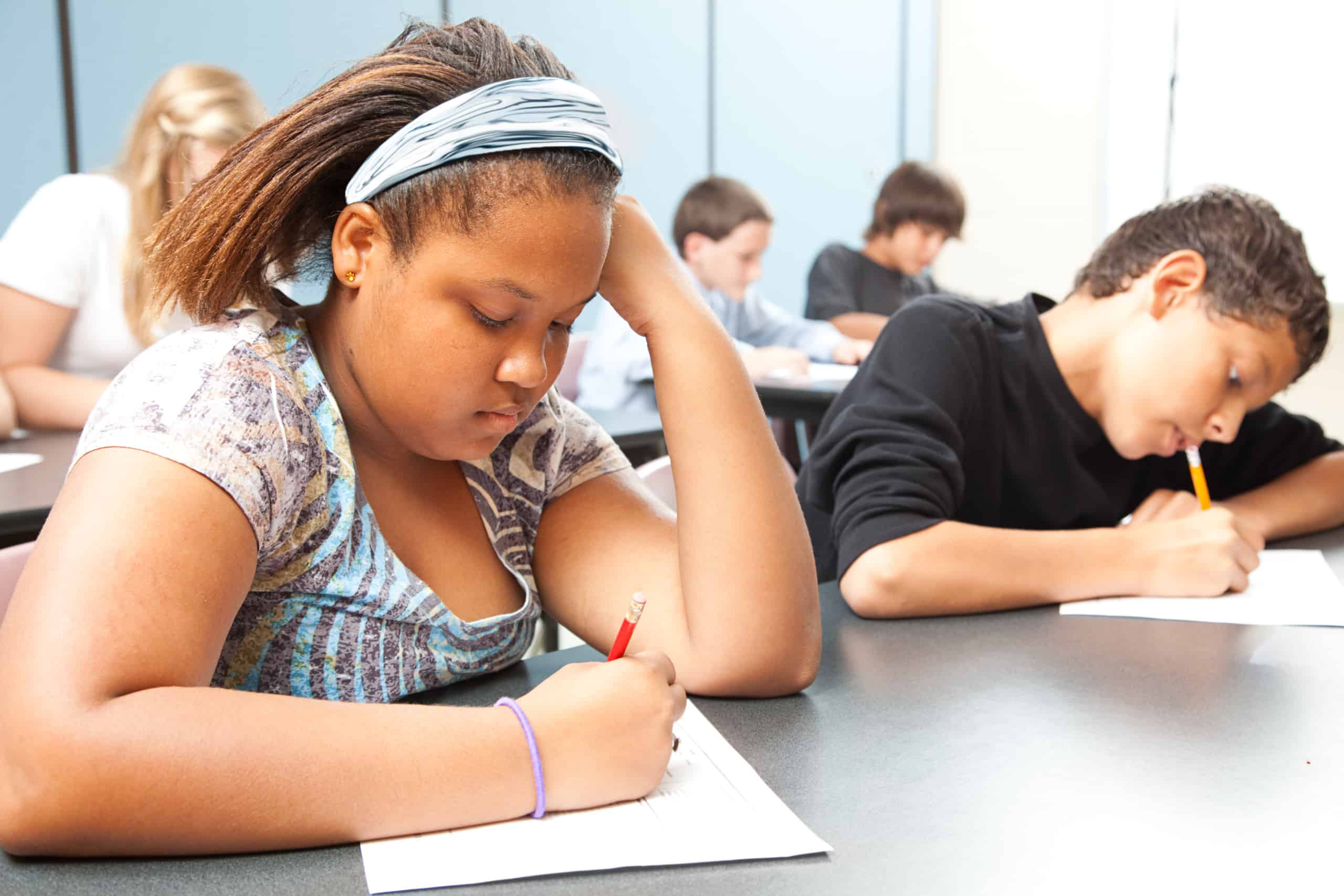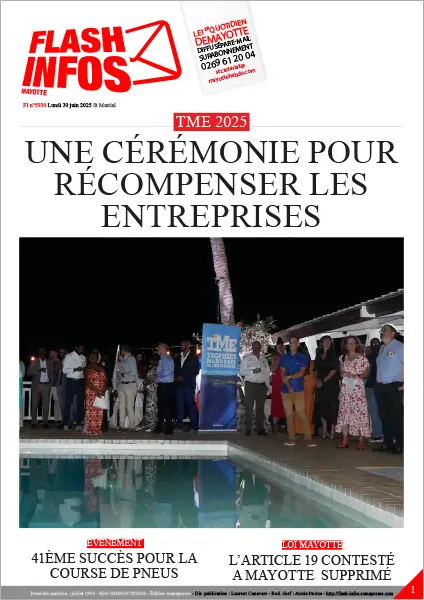L’ex-jeune ambassadeur aux droits de l’enfant était invité pour le lancement de la 31ème édition de la journée de la CIDE au collège Ouvoimoja de Passamaïnty. L’occasion de revenir sur son expérience de JADE, qui a fait naître en lui plus d’une vocation.
C’est l’heure des coudées – anciennement poignées de main – et des remerciements après cette matinée de lancement de la convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) au collège Ouvoimoja de Passamaïnty. Le groupe d’écolières qui vient d’entonner des chansons, devant le recteur Gilles Halbout et le vice-président du conseil départemental Issa Issa Abdou, souffle un coup à distance des adultes. Pendant que certains dévorent les pâtisseries et d’autres ingurgitent un café salvateur, Djounaidi rigole avec la petite troupe, derrière les étagères du CDI, recouvertes pour l’occasion de panneaux en l’honneur des droits de l’enfant. L’ex-JADE, un jeune ambassadeur pour la cause, a terminé sa mission depuis bientôt un an. Mais c’est de gaieté de cœur qu’il répond présent lorsque des institutions ou des associations comme Haki Za Wanatsa lui demandent d’intervenir auprès des jeunes. “Il m’est souvent arrivé qu’ils me disent : ‘‘mais comment on devient comme toi, comment on devient JADE ?’’ Je leur dis de se concentrer sur leurs études. Mais quand je vois leur investissement, comme aujourd’hui, ça fait chaud au coeur”, raconte le jeune homme de 23 ans.
Pour lui, tout a commencé un peu par hasard. Après un baccalauréat professionnel en commerce, suivi d’une formation d’assistant commercial, le Mahorais originaire de Kanibé dans le Sud n’a aucune idée qu’il va se dédier au social. Un jour, Moose, un vieux pote d’enfance, l’approche avec un super plan : le service civique pour devenir Jeune ambassadeur aux droits de l’enfant (JADE), une mission d’un an payée un peu plus de 500 euros. En tout, ils sont six à former l’équipe qui travaillera aux côtés de l’association CEMEA (centre d’entraînement aux méthodes d’éducation active) dans le centre de l’île, pour défendre ces droits fondamentaux. Pour Djounaidi, c’est une révélation. Le garçon qui vit à M’tsapéré avec sa mère s’implique corps et âme dans ce premier job, très formateur pour lui. “À la base, j’étais plutôt du genre timide, je n’osais pas prendre la parole en public, encore moins devant les caméras. Mais comme les autres ne voulaient pas trop, j’ai fini par y aller. J’ai même été sur la 1ère et sur Kwezi !”, se remémore le JADE avec un sourire modeste.
De JADE à éducateur spécialisé
À force, cette motivation paye, et ce service civique qu’il ne pensait jamais faire finit par lui ouvrir des portes. Remarqué pendant ses interventions, il est régulièrement approché par des porteurs de projets ou des associations. “Un des chefs des Apprentis d’Auteuil est venu me voir à la fin de mon service civique, pour que je rejoigne l’équipe !” Ni une ni deux, le gars du Sud embarque dans cette nouvelle aventure. Il devient éducateur et enchaîne les missions auprès des jeunes, parfois dans des quartiers sensibles.
À peu près au même moment, ce fan de foot embarque pour Madagascar. Ce voyage sur la Grande Île, l’un des pays les plus pauvres au monde, le marque profondément. C’est de là que lui vient l’idée de son association informelle Give a smile, qu’il met en place dès son retour avec son ami Moose. Le but est simple : donner des vêtements aux plus démunis. Mais attention ! Tout repose sur les dons des uns et des autres, et Djounaidi se refuse à mettre un quelconque statut sur la structure, ou à demander des subventions. “Dès qu’on est subventionné, les gens se disent que ça ne sert plus à rien de participer. Moi je veux que tout le monde se sente concerné, du plus modeste au plus riche, du plus jeune au plus âgé”, décrypte-t-il.
S’engager pour son île
Une façon aussi de prouver que les Mahorais peuvent porter eux-mêmes les projets structurants pour leur territoire. “Trop souvent, on se sent mis à l’écart ou chapeauté par des gens qui sont là pour un ou deux ans”, déplore l’éducateur spécialisé. S’il se refuse à considérer une carrière politique, Djounaidi a l’âme de ceux qui s’engagent pour les causes nobles. Sa présence ce vendredi, pour la Convention internationale des droits de l’enfant, en est l’une des nombreuses démonstrations. “À chaque fois qu’il faut se positionner sur un sujet, moi ce que je me dis c’est : où est l’intérêt supérieur de l’enfant ? Il faut toujours garder en tête que ce qui prime, c’est l’intérêt supérieur de l’enfant”, répète-t-il avec conviction. Mais ces engagements ne sont pas sans difficulté et le jeune actif a peu de temps pour lui… Pendant ses rares moments de répit, il file dans le Sud, pour se ressourcer autour d’un voulé avec sa famille et ses amis. Un cercle proche, sans qui celui qui a grandi au milieu des rivalités de bandes à Mtsapéré, n’en serait peut-être pas là aujourd’hui. “Ce sont eux qui m’ont fait comprendre que la vie était affaire de choix”, salue-t-il.