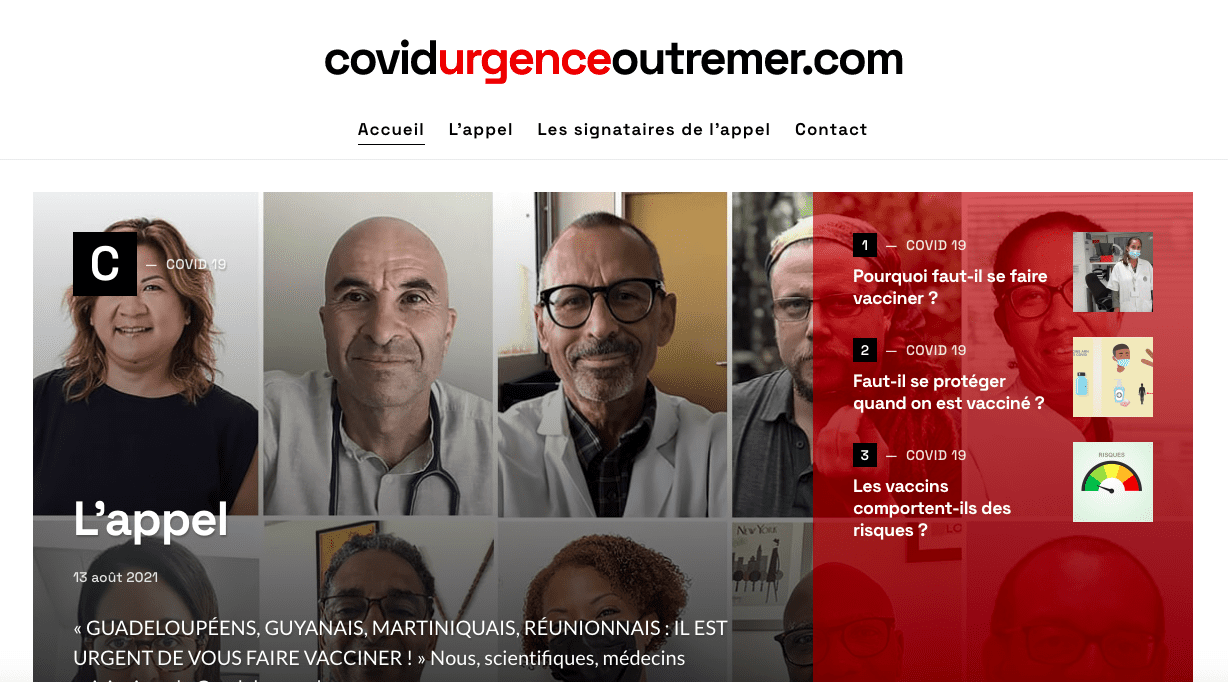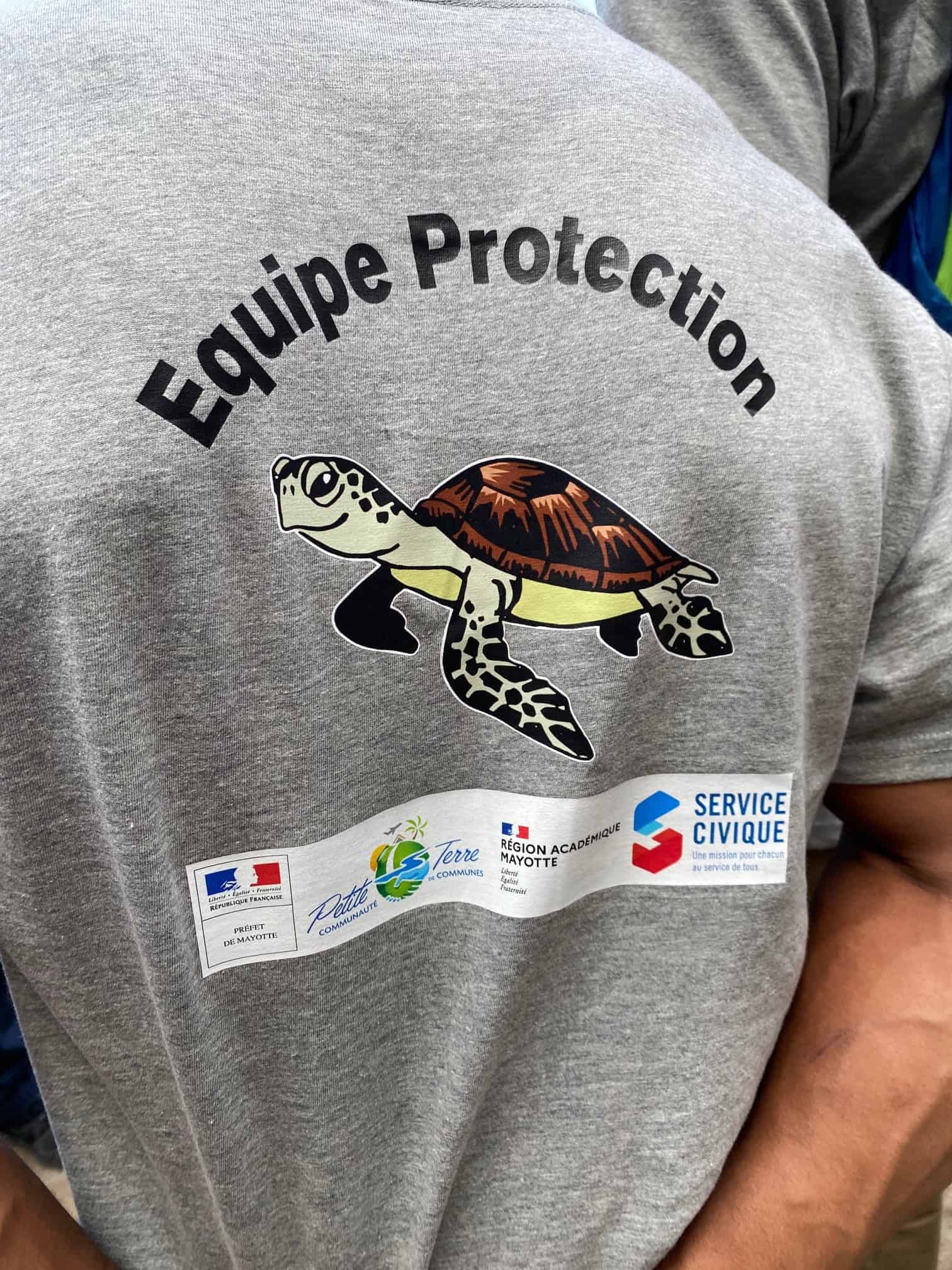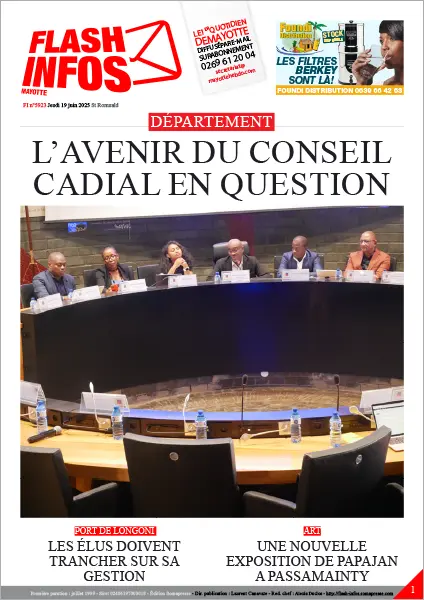Le concours Mahorais Star, lancé il y a quelques semaines, sillonnera 12 communes de l’île à la recherche des jeunes talents les plus prometteurs du département. D’ici plusieurs mois, cinq d’entre eux auront la chance de faire leurs premières armes au sein de labels étrangers pour lancer leur carrière.
Rares sont les artistes mahorais à pouvoir vivre de leur passion. Et rares, aussi, sont ceux qui rayonnent à grande échelle au-delà du territoire. Mais avec le concours de chant Mahorais Star, cela pourrait bientôt être de l’histoire ancienne. Le principe est simple : sillonner l’île de ville en ville pour y dénicher de jeunes talents et permettre aux plus prometteurs d’apprendre les bases du métier de chanteur, afin qu’il puisse lancer leur carrière, à Mayotte mais aussi à l’international.
“On s’est rendu compte que beaucoup de jeunes chantent ici”, introduit la tête pensante du projet, Elyas Said. “Mais beaucoup de choses ne se font qu’à Mamoudzou et énormément de jeunes n’ont pas les moyens d’aller en ville donc nous avons décidé de venir nous-mêmes à eux pour leur donner l’occasion de s’exprimer.” Derrière ce “nous”, une équipe de 12 personnes régies par l’association Mayotte Production, et des invités de haute voltige comme Singuila, l’un des coachs de The Voice Afrique.
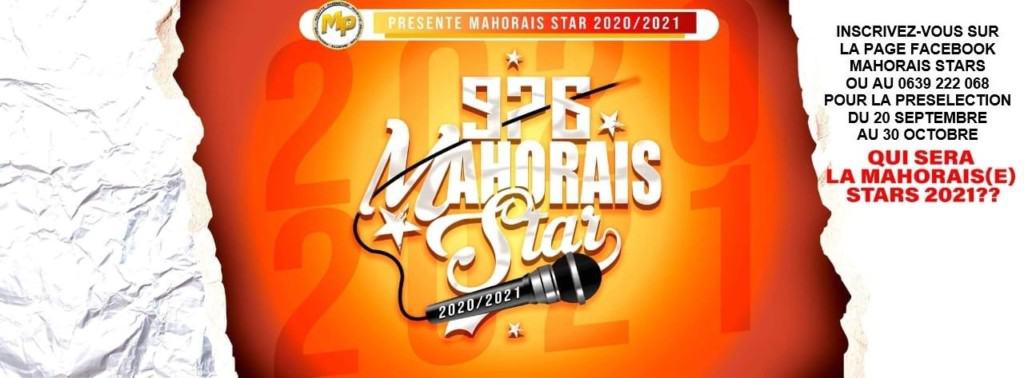 Réussir à les « programmer »
Réussir à les « programmer »
“Nous cherchons à montrer qu’il y a de la demande, mais ce n’est pas un domaine où nous pouvons tatonner”, reprend Elyas Said, par ailleurs directeur artistique du Koropa. Celui-là même qui a fait venir Aya Nakamura ou Djadju pour qu’ils performent à Mayotte. “Ici, comme les choses ne sont pas suffisamment structurées, les jeunes n’ont pas la bonne mentalité, donc notre travail sera de réussir à les “programmer” pour qu’ils puissent lancer leur carrière.”
Voilà pour la théorie. En pratique, les castings itinérants ont déjà débuté à Mamoudzou, Ouangani ou M’tsamboro et se poursuivront jusqu’à la fin septembre. Au total, 12 villes seront ainsi visitées par le jury du Mahorais Star. Puis, début octobre, la compétition à proprement parler débutera sur Mayotte La 1ère, afin que le public puisse également participer aux sélections, durant lesquelles les chanteurs amateurs seront encadrés par des coachs.
Cinq candidats seront finalement retenus, puis répartis au sein de différents labels régionaux, à Madagascar, en Afrique de l’Est ou aux Comores. “L’idée, c’est que chacun reviennent à Mayotte avec une vision différente : nous aurons, dans leurs musique, la couleur mahoraise mais avec des sonorités d’ailleurs !” Et, bonne nouvelle, il est encore possible de s’inscrire aux castings des communes dans lesquelles le jury n’est pas encore passé, à condition d’avoir entre 16 et 29 ans. Pour plus d’informations, rendez-vous sur la page Facebook Mahorais Stars.