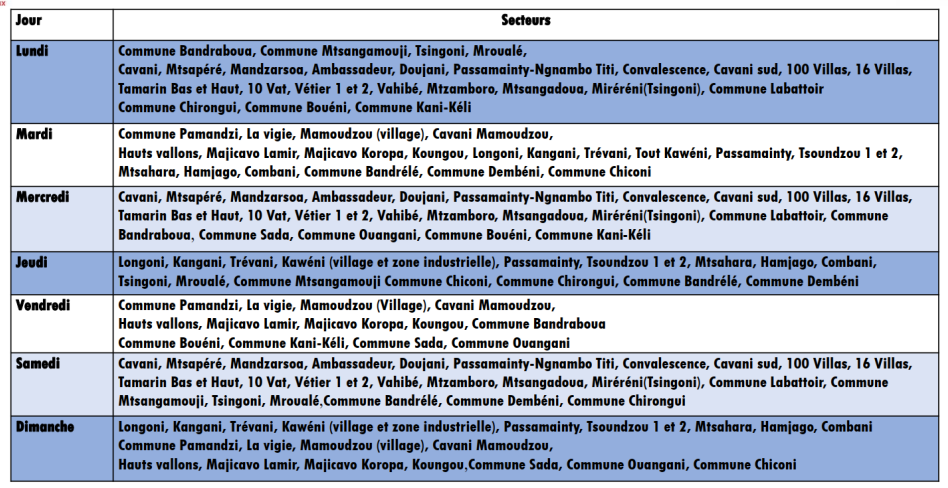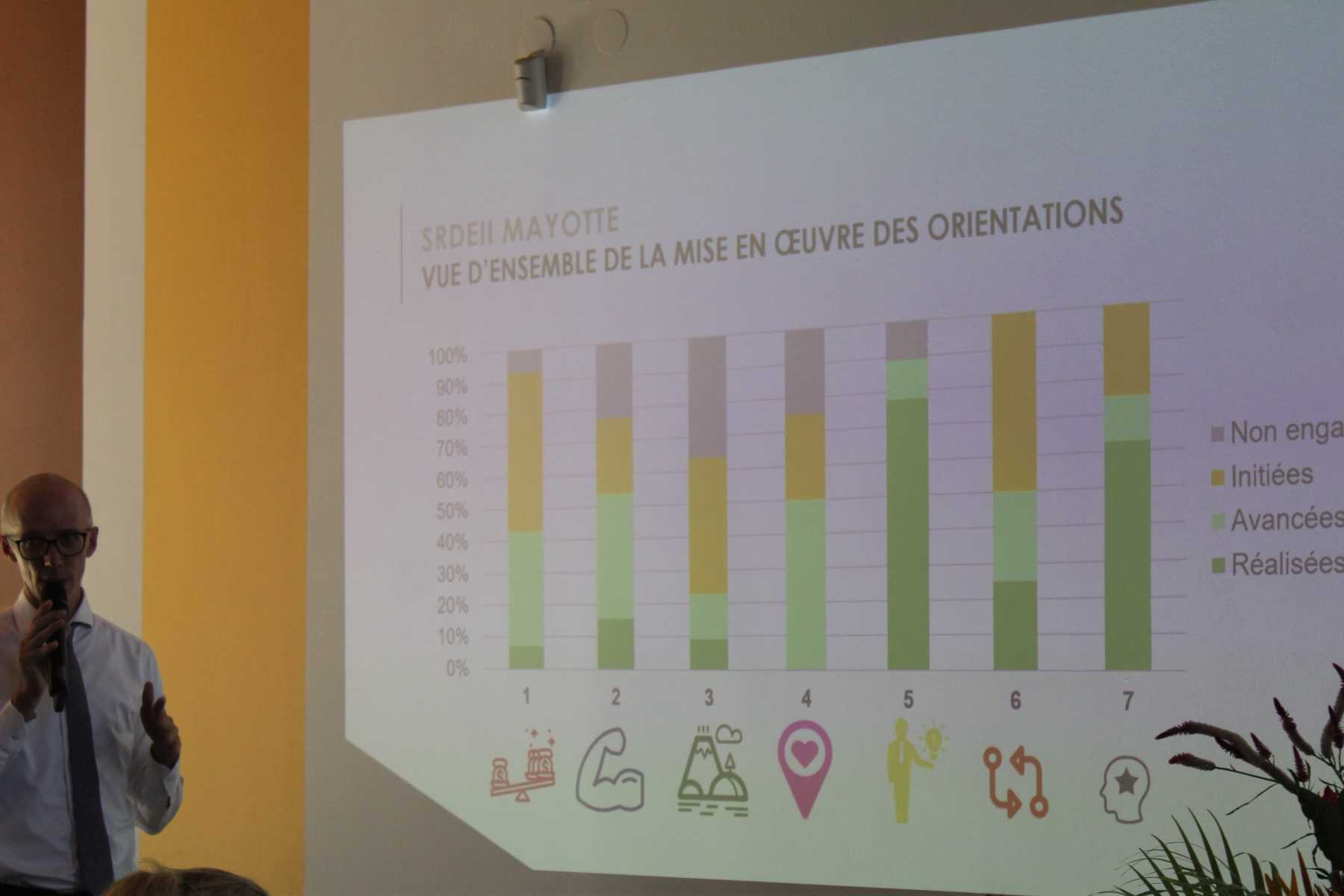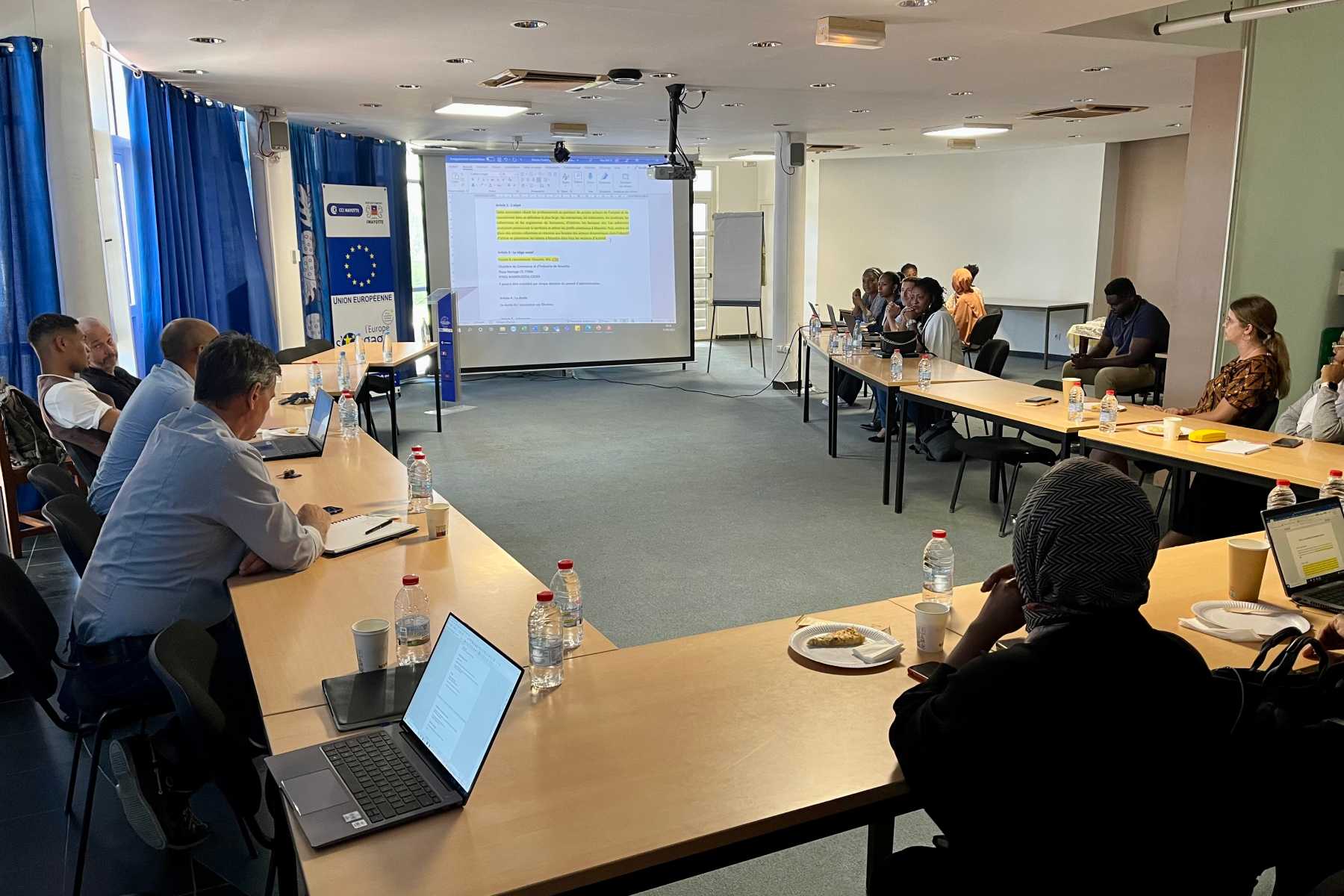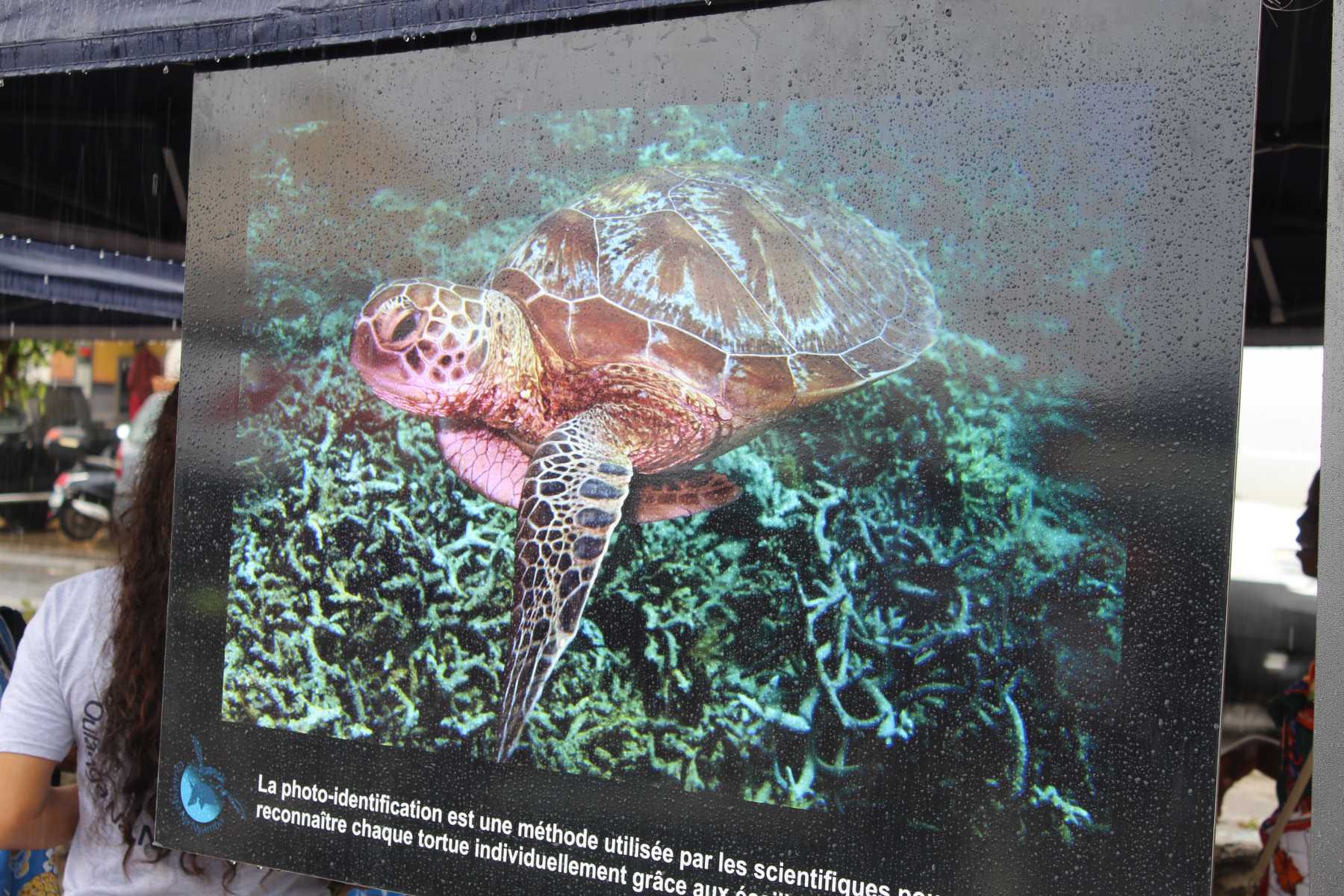Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice, a présenté son projet de loi d’orientation et de programmation, le 3 mai dernier, qui prévoit notamment le recrutement de 1.500 greffiers supplémentaires dans les juridictions d’ici 2027. Afin d’atteindre cet objectif, le ministère de la Justice lance une campagne de recrutement inédite avec deux sessions au titre de 2024. La première session proposera près de 450 postes à pourvoir ; les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 6 juillet 2023. Jusqu’à cette date, les candidats voulant rejoindre le corps des greffiers des services judiciaires peuvent s’inscrire au concours interne, au concours externe ou au troisième concours. Ces modes d’accès distincts permettent de diversifier les profils des postulants à ce métier de greffier, maillon essentiel du fonctionnement de la justice. Cette nouvelle session dont les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 6 juillet 2023 vient s’ajouter à la campagne d’inscription qui a lieu, chaque année, de novembre à janvier.
Le greffier a un rôle majeur dans le fonctionnement de la justice. Technicien de la procédure, il enregistre les affaires, prévient les parties des échéances importantes, effectue des recherches juridiques, prend note du déroulement des débats, rédige les procès-verbaux et met en forme les décisions. Spécialiste de la procédure, le greffier est garant de l’authenticité des actes juridictionnels, et tout acte accompli en son absence peut être annulé. Le greffier est aussi chargé de renseigner, d’orienter et d’accompagner les usagers dans l’accomplissement des formalités ou procédures judiciaires.
Les lauréats des concours externe et interne suivront une formation rémunérée de 18 mois alternant cours théoriques à l’Ecole nationale des greffes de Dijon et stages pratiques en juridictions. A l’issue de la formation et selon le rang de classement, les greffiers stagiaires sont appelés à choisir leur poste à partir d’une liste nationale établie par l’administration. Seuls les lauréats remplissant toutes les conditions d’accès aux concours pourront être nommés. Les lauréats du troisième concours suivront une formation rémunérée de 12 mois alternant cours théoriques à l’Ecole nationale des greffes de Dijon et stages en juridictions. Le choix des postes s’effectue en fin de formation en fonction du rang de classement des stagiaires à partir d’une liste nationale établie par l’administration.