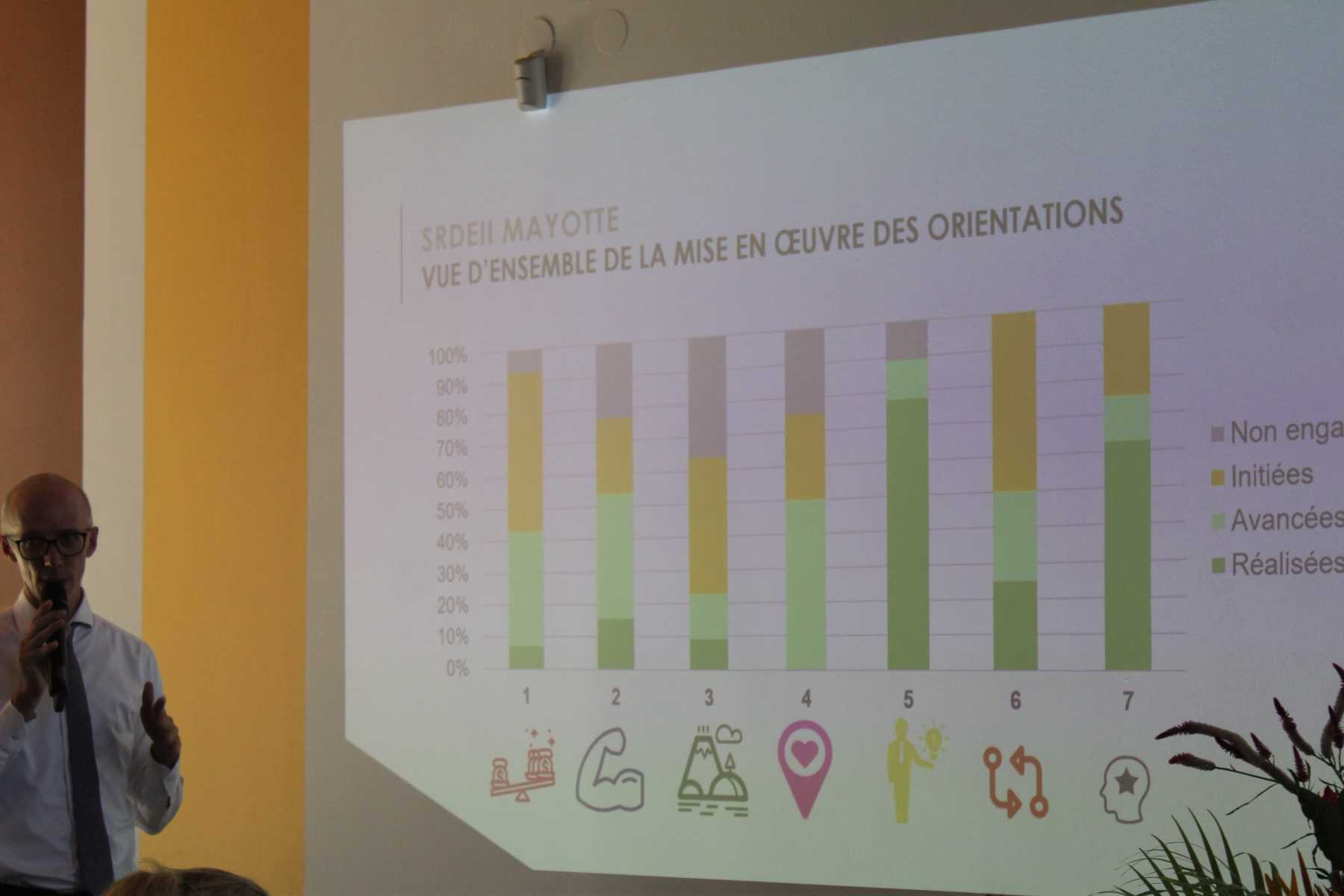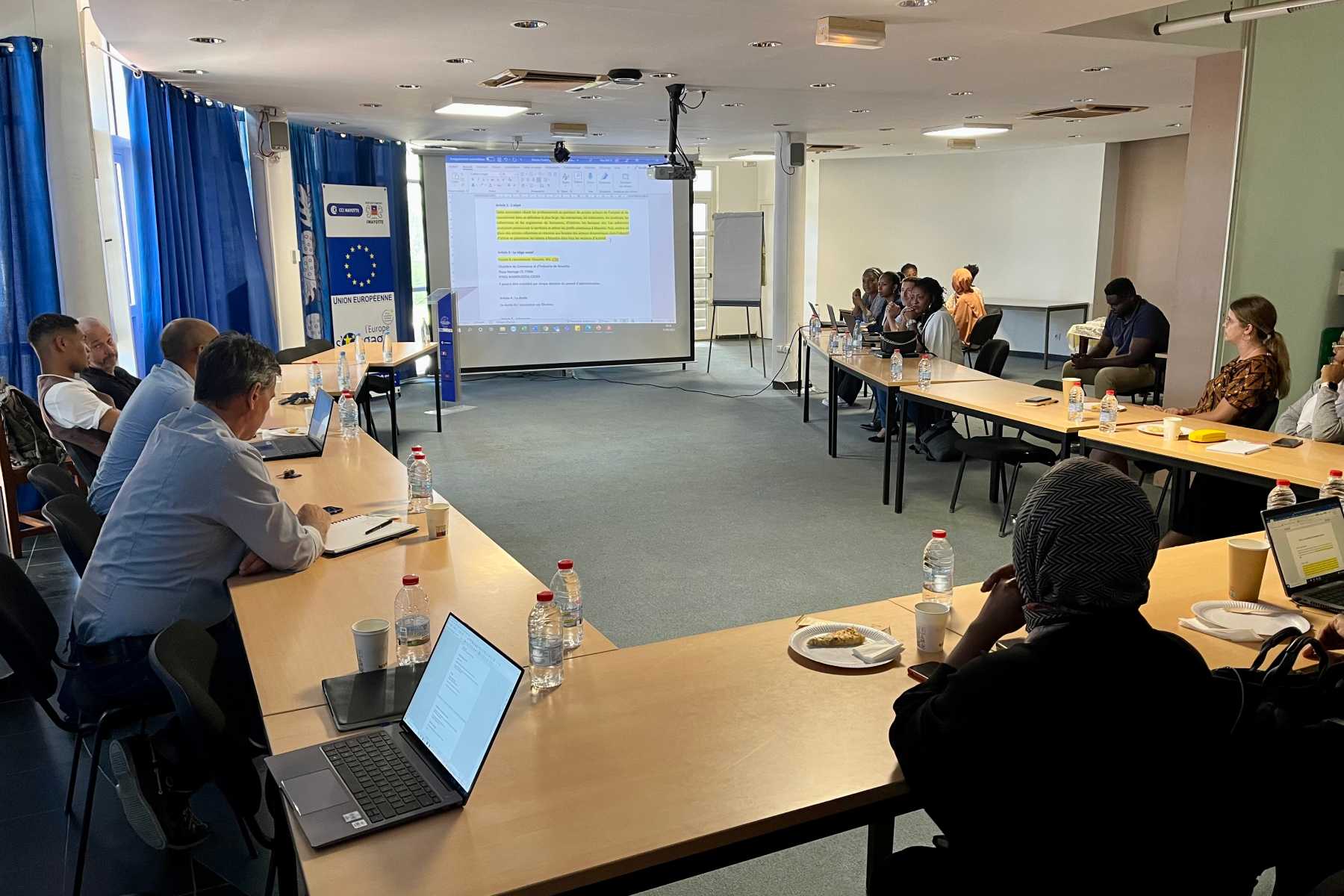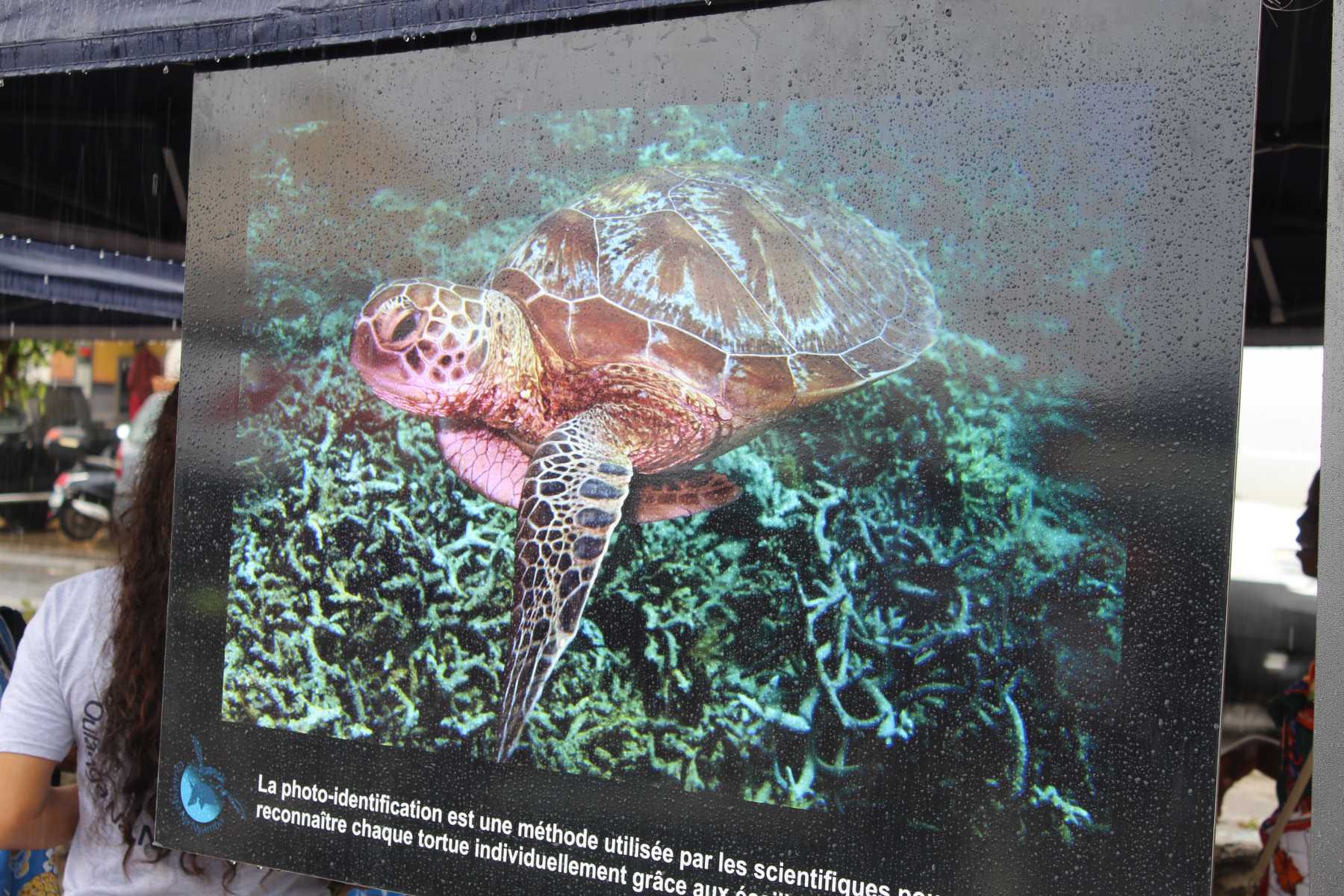Ce jeudi 11 mai, dans la matinée, avait lieu, à l’Assemblée nationale, une commission d’enquête relative au coût de la vie dans les collectivités territoriales d’outre-mer. Étaient auditionnés autour d’une table ronde, les représentants des compagnies aériennes présentes dans les outre-mer, ainsi que des représentants de la direction générale de l’aviation civile (DGAC).
« C’est à l’État de faire un effort », prévient Pascal de Izaguirre. Le président-directeur général de Corsair était l’une des personnes auditionnées par la commission d’enquête parlementaire sur le coût de la vie en outre-mer, ce jeudi matin. Il y était question des causes, des conséquences et des solutions que pouvaient mettre en place les compagnies aériennes afin de lutter contre la hausse des prix des billets d’avion. Ces dernières années, ils ont augmenté d’environ 40 %. Un coût supplémentaire pour des habitants d’outre-mer qui ne peuvent pas, pour la plupart, se le permettre. Le président de la commission et député de Martinique, Johnny Hajjar, souligne ainsi : « Les usagers subissent toutes les augmentations surtout ceux des territoires enclavés et isolés. Quand on ne peut pas voyager, on est aujourd’hui enfermé sur un territoire. Le seuil de « supportabilité » est déjà dépassé. C’est une forme de discrimination ».
Pourquoi une telle augmentation ?
Les causes de cette augmentation ont été énumérées par les différents participants. « Il est vrai que les tarifs ont évolué, la crise sanitaire a donné un sérieux choc au fonctionnement. Le prix du kérosène et le prix du dollar ont beaucoup bougé », affirme Emmanuel Vivet, sous-directeur des transports et des services aériens à la direction générale de l’aviation civile (DGAC). Il ajoute également que si « quelqu’un réserve deux semaines avant les vacances, il n’y a plus beaucoup de place et il se retrouve face à un billet très cher, le ressenti d’insupportabilité est fort. Nous observons, une augmentation [des prix] en période de pointe et une baisse en basse saison. On conçoit que ce soit cher quand on a des responsabilités familiales dans une situation inflationniste ». Pascal de Izaguirre blâme, quant à lui, l’augmentation salariale, les coûts d’entretien, « on se fait arnaquer » avoue-t-il, et bien évidemment, le prix du kérosène qui représente selon lui 35 % du prix d’un billet. Mais aussi, il avoue que sa compagnie a été « très secouée par la crise du Covid-19 ».
« Corriger les inégalités »
Le président interroge la table pour savoir si des solutions sont possibles. Le président de Corsair déclare vouloir « corriger les inégalités dont pâtissent les communautés ultra-marines. La priorité doit être pour les populations les plus défavorisées », renvoyant la responsabilité à l’État. Il est impossible, selon les dirigeants, de réduire leurs marges, qui sont de l’ordre de 1 à 2 %. Le seul moyen de baisser les prix des billets, dans la conjoncture actuelle, c’est d’obtenir des aides de l’État.
Henri de Peyrelongue, directeur général adjoint commercial passage d’Air France-KLM, assure que « s’il y a une volonté de baisser les prix, il appartient aux autorités de mettre en place une mesure qui convient ».
Pourquoi Mayotte est plus cher que La Réunion ?
Le député de la deuxième circonscription de Mayotte, Mansour Kamardine, était présent lors des auditions. Il s’est étonné de la différence de prix entre le voyage de Saint-Denis à la Réunion à Paris et le voyage de Dzaoudzi et Paris. Joseph Bréma, directeur d’Air Austral, lui notifie que la tonne de carburant à Mayotte atteint les 1.800 euros, et qu’il est plus difficile d’atterrir puisque la piste est courte. La population de Mayotte est pourtant la plus pauvre de France, mais les prix des billets sont beaucoup élevés que dans d’autres territoires d’outre-mer. Le député s’est aussi interrogé sur l’absence d’Air France sur l’île. Henri de Peyrelongue, directeur général adjoint commercial passage d’Air France-KLM, lui répond qu’à cause de la crise du Covid-19, ils n’étaient pas en mesure d’opérer, mais que « ça fait partie des destinations que l’on regarde fréquemment ».
Zena Airlines se lance sur les réseaux sociaux

La compagnie aérienne mahoraise Zena Airlines, après avoir dévoiler son logo en mars dernier, vient de se lancer sur les réseaux sociaux. Cette page Facebook permettra d’informer le plus grand nombre de l’avancée des démarches initiées dans le cadre du lancement de la compagnie, « en attendant de pouvoir vous retrouver à bord ! »
Zena Airlines « est la concrétisation d’un rêve mahorais, celui de proposer un autre choix de voyage dans la zone, en métropole ou ailleurs dans le monde. À travers cette compagnie locale, notre ambition est plus que jamais de servir les intérêts de la population grâce à des tarifs, des destinations et un confort adaptés aux besoins des mahorais », rappelle la compagnie sur la première publication de sa page Facebook.