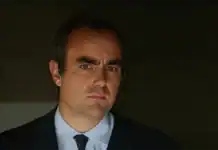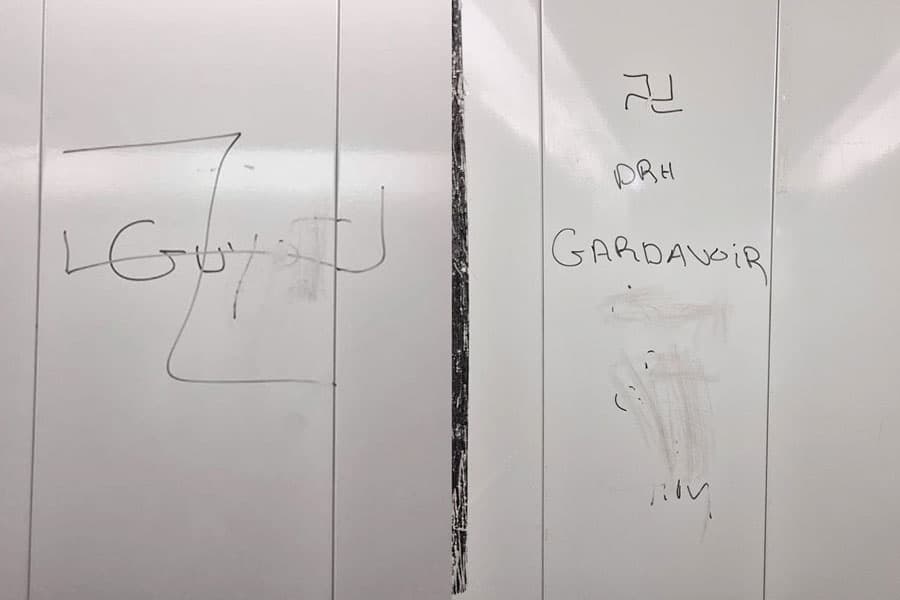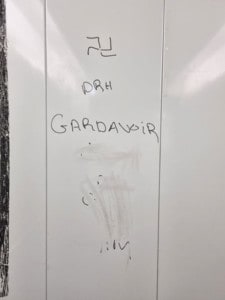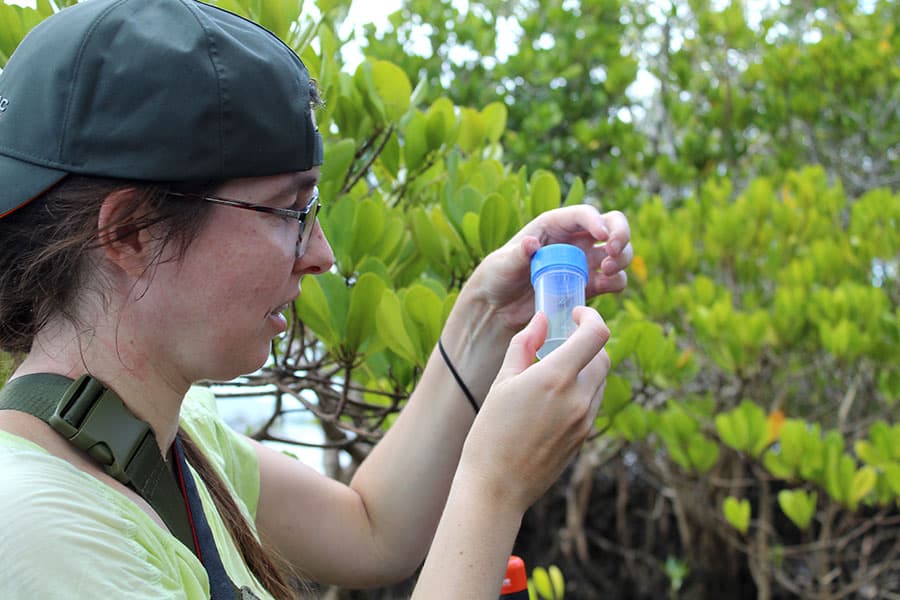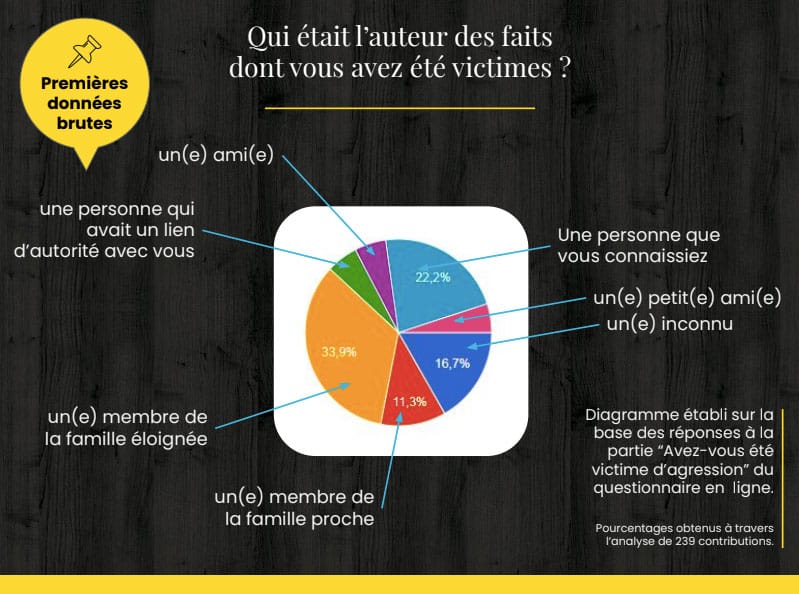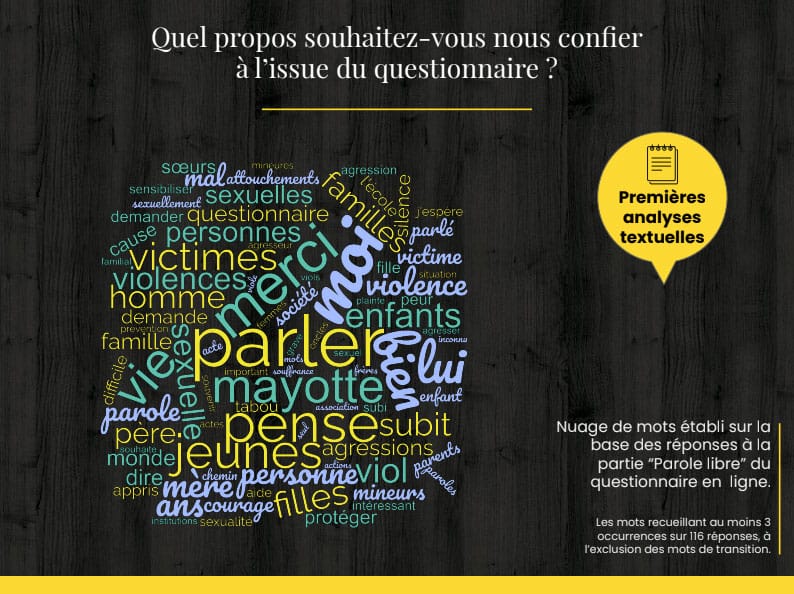Un chauffeur de poids lourd qui avait fait un malaise était tombé à bord de son camion dans la mer, en 2017. Quatre prévenus devaient comparaître devant le tribunal, dont l’entreprise délégataire du port présidée par Ida Nel. Ils étaient poursuivis non pas pour des faits d’homicide involontaire, mais pour travail dissimulé.
“Bah oui, c’est un peu magnégné tout ça, Madame !” L’expression pourrait faire sourire si les faits n’étaient pas aussi graves. En 2017, un chauffeur de poids-lourd qui transporte un container au port de Longoni fait un malaise derrière le volant, et perd le contrôle du véhicule, qui finit dans le lagon. Les secours n’arrivent pas assez vite pour empêcher le décès de la victime par noyade… Une mort accidentelle, donc. Le problème, que les enquêteurs dépêchés sur place ne tarderont pas à découvrir : le chauffeur n’était pas vraiment employé dans les règles.
En contrat chez l’un, embauché le jour même chez un tiers, qui lui-même rendait service à son frère, mais éditait ses factures directement au port… Bref, une belle pagaille qui illustre les pratiques négligentes, voire parfois irrégulières au port de Longoni. Et un fastidieux dossier qui a donc abouti à la comparution ce mercredi 27 octobre de quatre prévenus, dont trois sociétés opérant au port : la SARL Routiers Transporteurs de Mayotte (RTM), la société Transporteurs Aziz et fils et la SAS Mayotte Channel Gateway, entreprise délégataire du port dont la présidente n’est autre qu’Ida Nel. On leur reproche des faits de travail dissimulé. L’audience du jour visait à comprendre les implications des uns et des autres.
Pas de visite médicale depuis 2012
Officiellement, la victime possédait bien un contrat de travail, à durée déterminée de neuf mois, chez l’une de ces trois sociétés, RTM. En poste depuis six mois en tant que chauffeur poids lourd, Monsieur B. a déjà fait quelques malaises par le passé. Auditionné par la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi le 26 juillet 2017, soit quelques jours après le décès de son salarié, l’employeur explique lui avoir proposé un avenant à son contrat, pour le faire passer à un poste de manutentionnaire, moins dangereux. Il soupçonne de l’épilepsie. Mais le principal intéressé refuse de signer. Pour autant, le dossier ne fait état d’aucune visite médicale auprès de la médecine du travail, en ce qui concerne RTM. Par le passé, le chauffeur de camion a toutefois déjà été jugé inapte, ce qui avait d’ailleurs entraîné son licenciement de la société Colas. Sa dernière fiche d’aptitude remonte à 2012. C’est ce qui vaudra à RTM d’être poursuivie pour exécution d’un travail dissimulé et embauche d’un salarié sans déclaration préalable conforme au service de santé au travail.
L’affaire aurait pu s’arrêter là. Mais il y a un hic. Le camion que conduit la victime le jour du drame, appartient en réalité à un tiers, Monsieur F. Lui travaille souvent au port, mais ne dispose pas d’une immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Et ce jour-là, c’est en réalité son frère, qui gère pour sa part la société Aziz et fils, qui lui a proposé de récupérer une partie du boulot. Un arrangement à l’amiable auquel les deux auraient régulièrement recours quand le besoin de bras se fait sentir… mais qui pourrait aussi s’apparenter à de la sous-traitance !
Partie de ping-pong entre les prévenus
Comme si cela ne suffisait pas, MCG avait bien payé des factures, directement à Monsieur F, sans lui demander un extrait de Kbis ou une attestation de la sécurité sociale. Son intervention aurait concerné pas moins de 26 bateaux sur les cinq derniers mois ! “C’est la fille d’Aziz qui gère ces choses pour eux… Mon service n’a peut-être pas été assez vigilant”, explique Ida Nel.
Difficile de démêler les responsabilités des uns et des autres, tant chacun s’évertue à noyer le poisson, ou à se renvoyer la balle. Au point d’exaspérer quelques robes noires. “Ce n’est pas vous Madame Nel, c’est votre société MCG qui est poursuivie. Et en France, tous les employeurs sont censés respecter les règles”, grince l’un des assesseurs. “C’est un débat fastidieux dans ce que je considère comme être de la résistance de la part des prévenus, à des questions simples”, souligne quant à lui le ministère public. Lequel a requis entre 1.500 et 10.000 euros d’amende, et même six mois d’emprisonnement avec sursis pour Monsieur F. Des réquisitions âprement contestées par les avocats présents, l’un plaidant notamment l’absence de sous-traitance entre la société Aziz et fils et Monsieur F., l’autre la méconnaissance par MCG du travail dissimulé. Seul le premier sera parvenu à obtenir la relaxe pour son client. Les autres prévenus écopent d’amendes allant de 1.500 euros pour MCG, à 4.000 euros, dont 2.800 avec sursis, pour Monsieur F., et 2.000 euros pour la RTM.