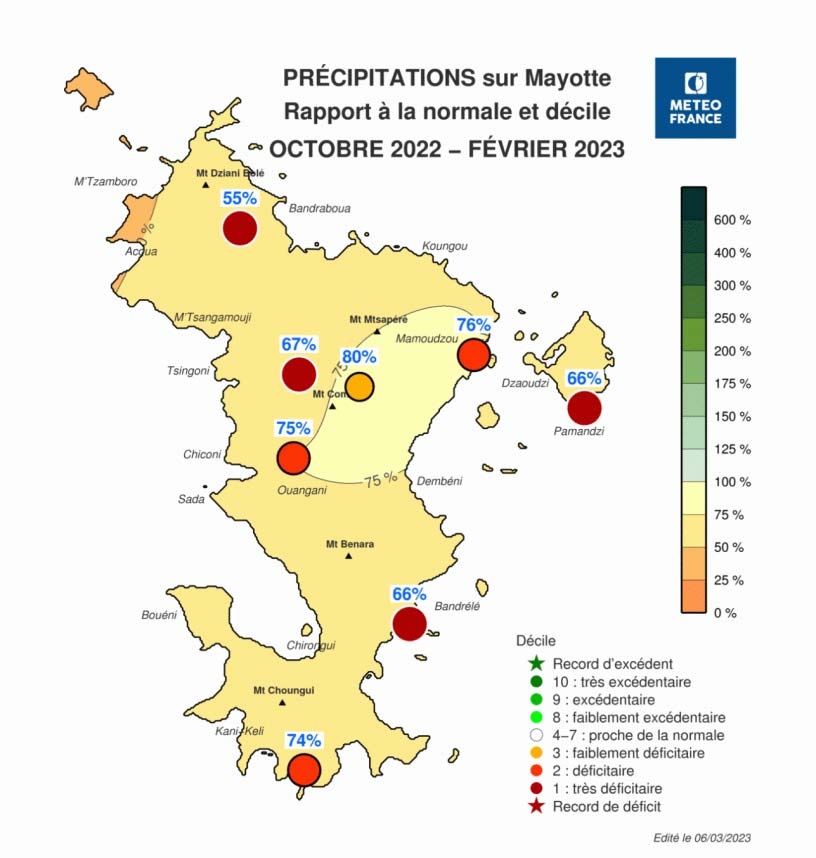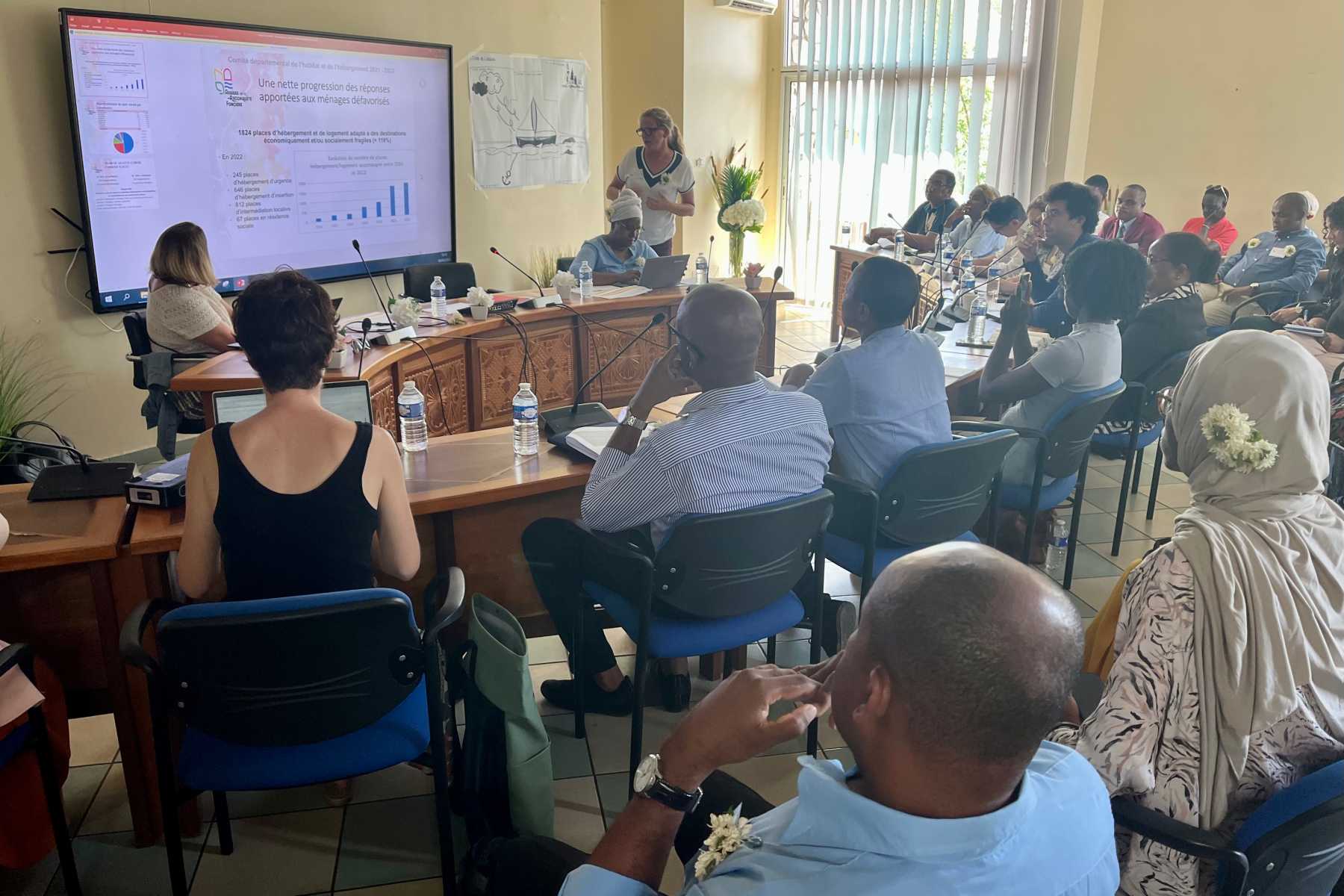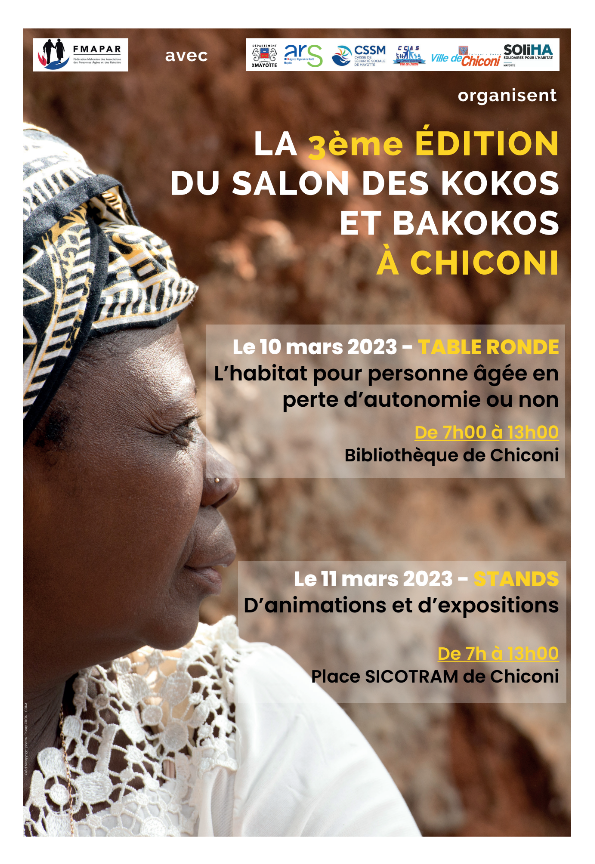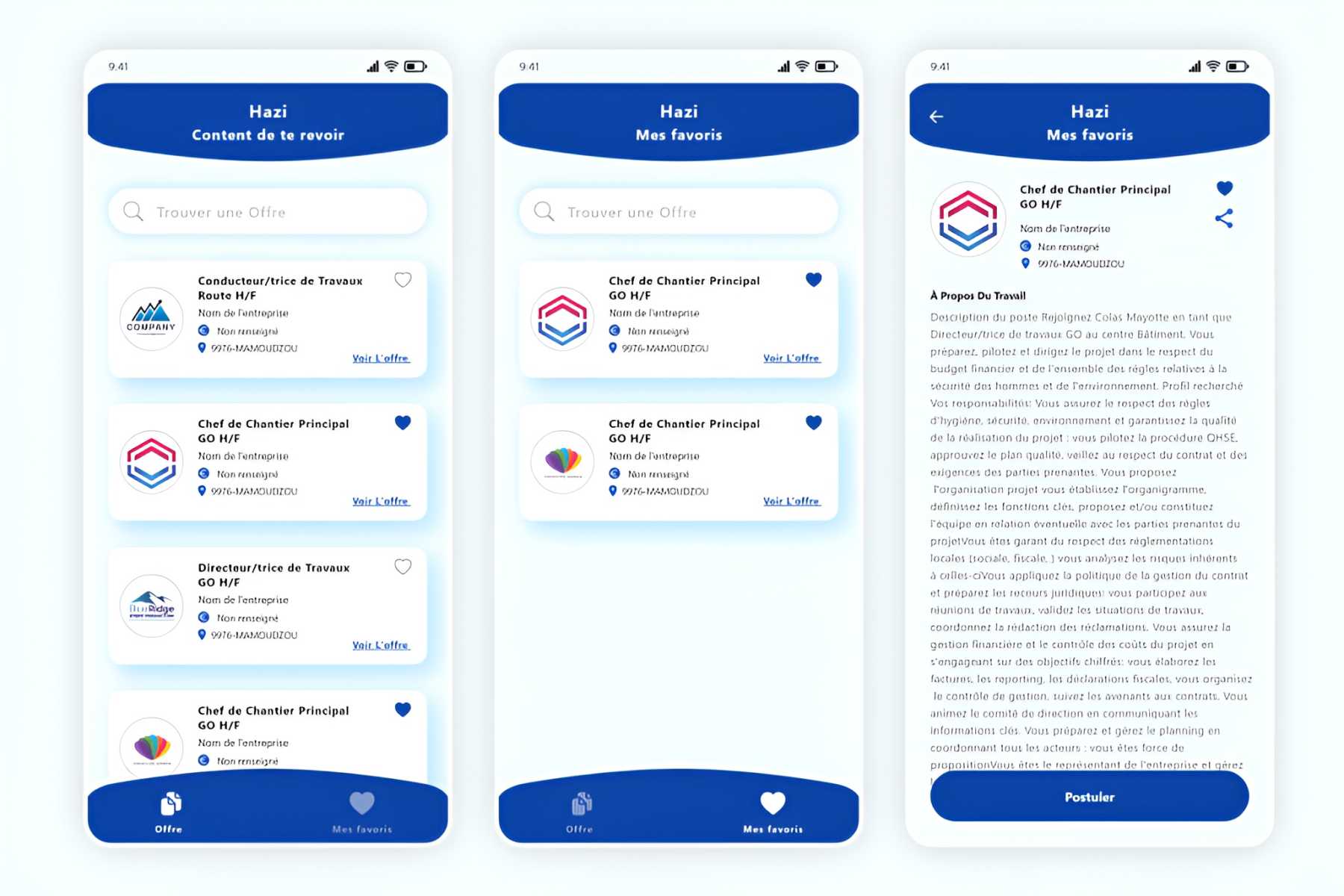Les demi-finales de play-offs du championnat pré-national masculin de basketball ont commencé ce week-end. Nous étions à Pamandzi, où le Vautour Club de Labattoir s’est imposé 60 à 57 contre les Rapides Éclairs, au terme d’un match aller intense !
Huit minutes à jouer dans le troisième quart-temps… Lens Faycol Aboudou (n°10) remonte le terrain, trouve Fahad Ben Issouffi (n°24) dans le coin droit, démarqué. Shoot à 3 points : « swiiish ! », le ballon rentre sans même toucher l’anneau. Vautour : 45, Rapides Éclairs : 29. Dans les gradins, les visiteurs exultent. Les supporters locaux, eux, tirent un peu la tronche. Il faut dire que depuis le début de cette demi-finale aller du championnat de basket, l’équipe de Pamandzi boit la tasse. Pire encore, en première mi-temps, les Rapides Éclairs n’ont pas planté un pion pendant près de dix minutes… Et pourtant : en quelques actions successives bien menées, les joueurs des Rapides Éclairs sortent la tête de l’eau, portés par Chambani Said Ali Youssouf (n°8) et Kemal Kaambi (n°10), qui inscrivent 17 points à eux seuls dans le troisième quart-temps. Le public pamandzien y croit de nouveau, et il s’en faut de peu pour que le terrain ne soit pas envahi lorsque Youssouf capte un très bon rebond offensif et marque le panier qui ramène Rapides Éclairs à une petite unité de Vautour (49-50). Les compteurs sont – presque – remis à zéro.
26 % de réussite aux lancers-francs
Le quatrième période est une bataille féroce. Pamandzi repasse devant quelques instants, mais notre Sportif de l’année 2022, Rifki Saïd, scelle la victoire pour les siens. Il calque d’abord un dunk monumental qui relance Vautour en début de quart-temps, puis en convertissant deux lancers-francs importants en toute fin de rencontre. C’est d’ailleurs sur cette ligne que s’est sans doute jouée la victoire. Les joueurs des Rapides Éclairs n’ont marqué que 5 de leurs 19 tirs de pénalité au cours de la rencontre (26,3%). Dans la dernière minute de jeu et menés 57-60, le meneur Soihiboudine Boinariziki (n°7) obtient même les trois lancers-francs qui auraient permis à son équipe de recoller au score, et d’arracher une prolongation… mais n’en convertit aucun. Score final 57-60. « Il faudra qu’on s’applique plus sur nos tirs au match retour », concède-t-il en fin de rencontre, précisant que Rapides Éclairs devra « s’appuyer sur [sa] défense » pour espérer inverser la tendance la semaine prochaine au gymnase de Labattoir.
De son côté, le coach de Vautour, Houdi Djadair, est ravi de la performance de ses joueurs. « Ce n’était pas un match facile. On a bien entamé la rencontre et respecté notre plan de jeu. On a déjoué en fin de troisième quart-temps, mais on a su garder notre calme dans les moments importants. »
Les stats des joueurs
Rapides Éclairs de Pamandzi : 57
- 6 – Kalidi Moussa Ali (0 pt)
- 7 – Soihiboudine Boinariziki (12 pts)
- 8 – Chambani Said Ali Youssouf (22 pts)
- 9 – Niasse Said Houssein (3 pts)
- 10 – Kemal Kaambi (17 pts)
- 11 – Hismann Ali (3 pts)
- 12 – Faikal Ali (0 pt)
- 13 – Amirridjal Oumar (0 pt)
- 14 – Mohamed Moindjie (0 pt)
- 15 – Hakime Miradji Abdou (0 pt)
Vautour Club de Labattoir : 60
- 5 – Omar Youssouf (2 pts)
- 6 – Soilihih Antoy-Iahi Soilihi (9 pts)
- 7 – Charafou Saïd (0 pt)
- 8 – Rifki Saïd (5 pts)
- 9 – El-Soidik Houmadi (3 pts)
- 10 – Lens Faycol Aboudou (18 pts)
- 18 – Ahamadi Hamza (6 pts)
- 23 – Faïr Amir (0 pt)
- 24 – Fahad Ben Issouffi (13 pts)
- 30 – Nayade Ahamadi (4 pts)
Les résultats du week-end
Également pour le compte des demi-finales aller des playoffs du championnat pré-national masculin, le Basket club de M’tsapéré (BCM) s’est imposé 79 à 60 contre l’Étoile bleue de Kaweni.
Les mêmes demi-finales se jouaient aussi chez les femmes : le Golden Force de Chiconi s’est lourdement incliné contre le Fuz’Ellipse de Cavani (28-89), tandis que les joueuses du BCM l’ont emporté contre le Magic de Passaimaïnty (54-63).