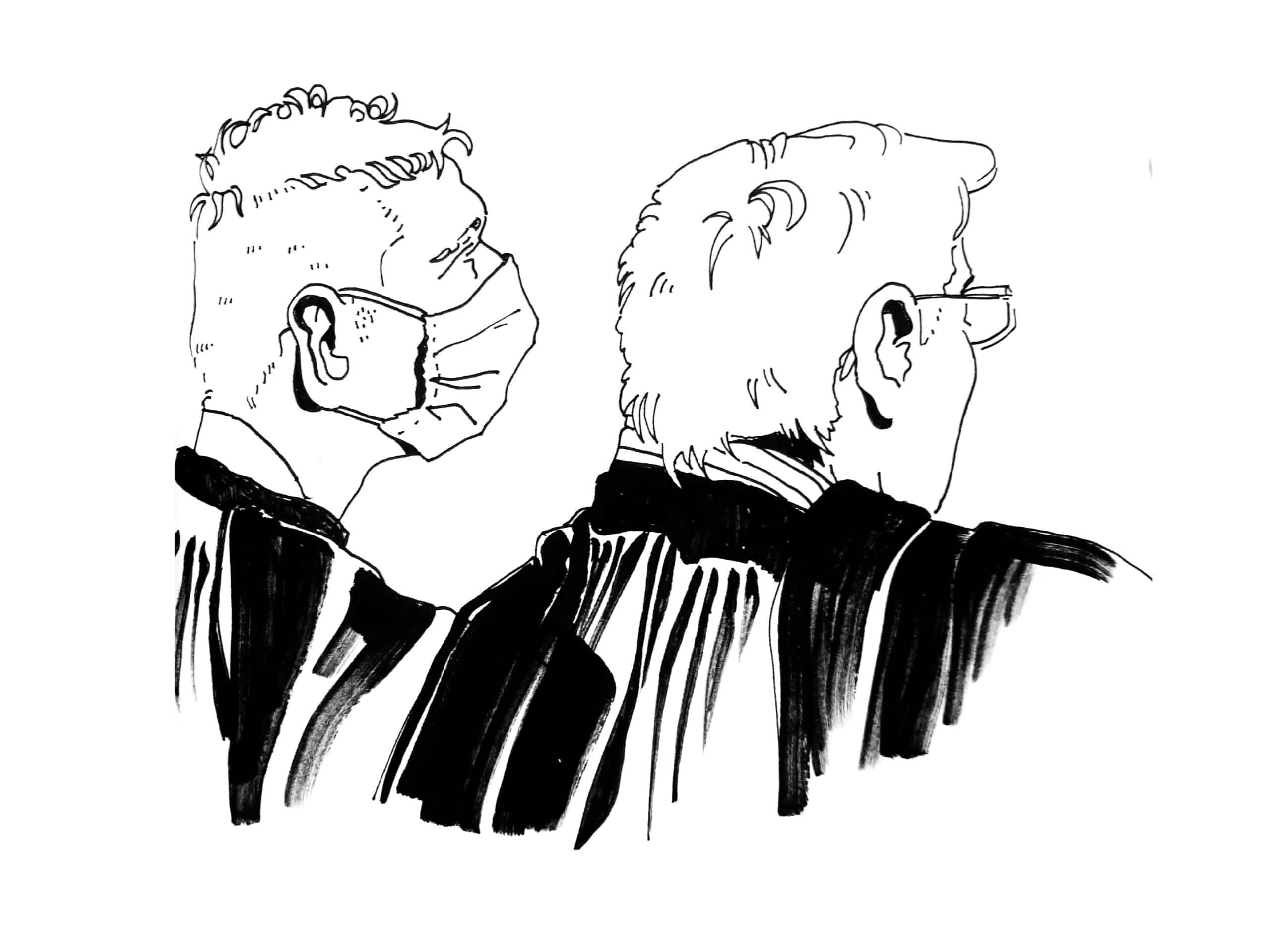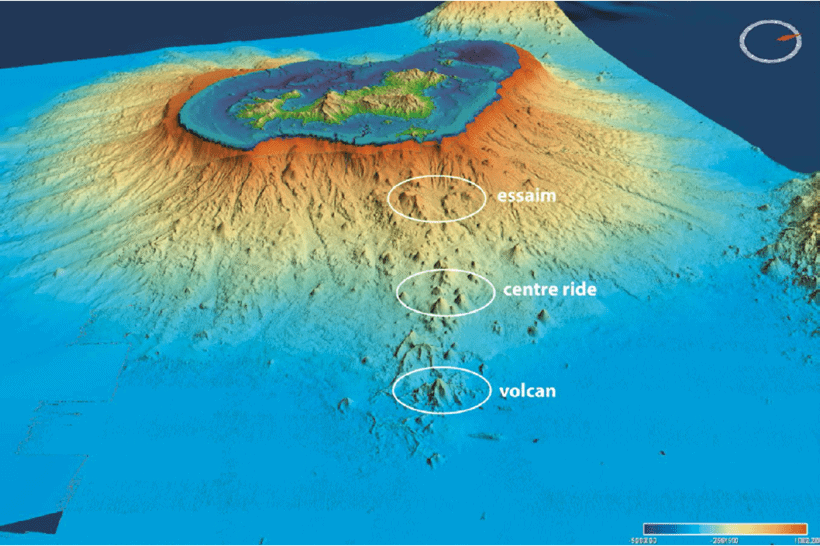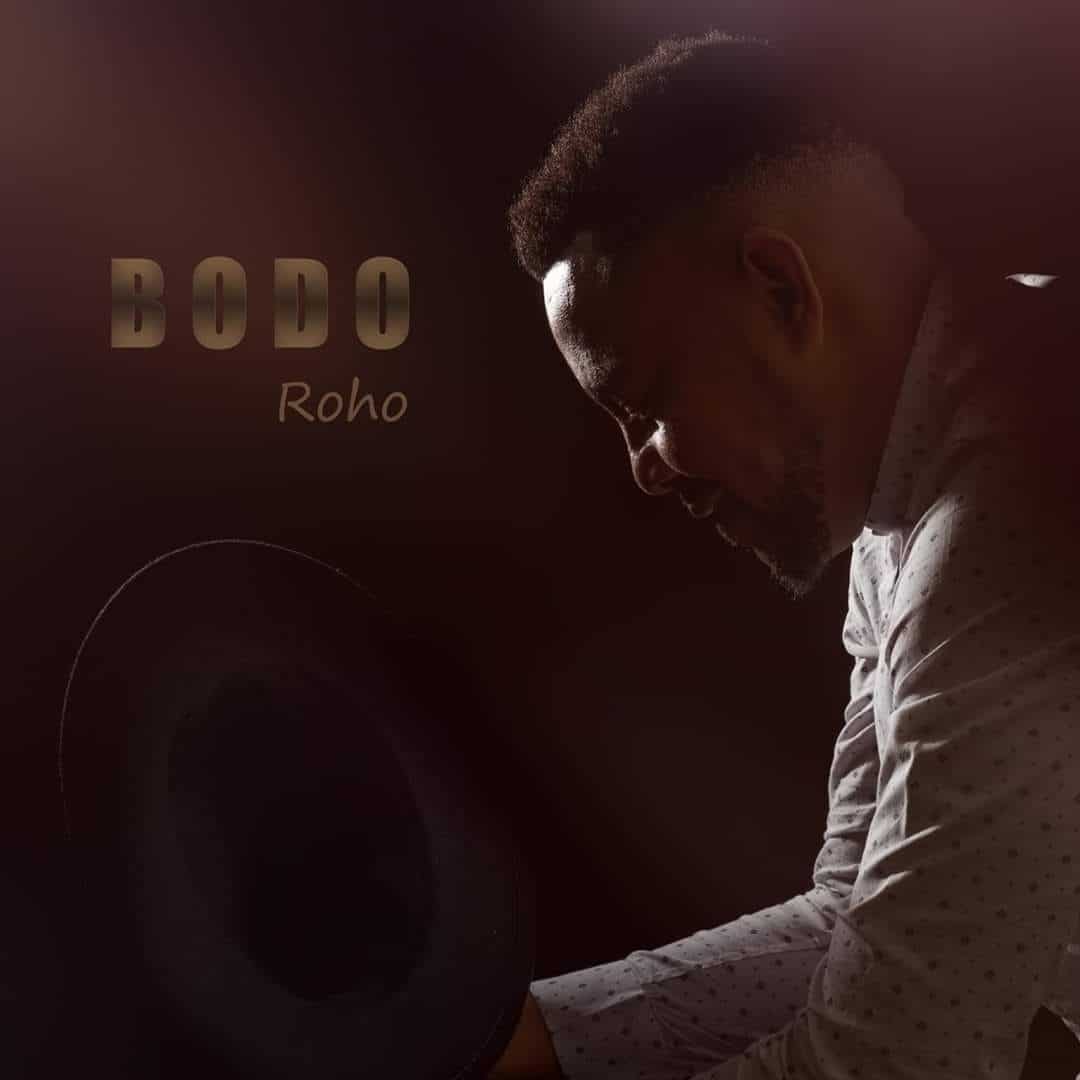Face à l’absence d’avancées significatives par rapport aux 43 points qui avaient fait l’objet d’une négociation en septembre, les agents de terrain du Département ont reconduit leur grève. Avec peu ou prou les mêmes revendications.
Forte déconvenue pour les passagers de la barge, en ce début de semaine déjà pluvieux. Amassés sur les quais, les centaines d’usagers ont dû faire preuve de patience : une seule barge assurait la traversée ce lundi jusqu’à la mi-journée. La cause de ce service minimum ? Une grève des agents du STM (service des transports maritimes de Mayotte), que beaucoup n’avaient pas vu venir. Sur les réseaux sociaux, ils étaient d’ailleurs plusieurs commentateurs à s’interroger sur l’absence d’un préavis qui aurait pu leur permettre d’anticiper le coup…
En réalité, c’est à l’appel du syndicat Force ouvrière, qui avait déposé un préavis ce vendredi 6 novembre, que plusieurs agents du conseil départemental ont décidé d’entamer une grève illimitée. Parmi eux figurent notamment les personnels en charge du ménage, les gardiens et agents de sécurité, les agents de surveillance des tortues, les jardiniers et les agents de la brigade rivière. Et il semblerait donc que ceux du STM se soient eux aussi greffés au mouvement. Selon le syndicat, le non-respect du dernier protocole d’accord, signé le 1er octobre après un premier mouvement entamé le 28 septembre, a motivé cette nouvelle mobilisation pour enfin faire entendre leurs revendications. “Nous avons le sentiment que la signature du protocole n’a pas de valeur”, déplore Ichaan Madi, secrétaire générale du groupement départemental FO services publics.
43 revendications sur liste d’attente
En tout, 43 points avaient été soulevés pendant les dernières négociations, des conditions de travail des femmes de ménage et agents de sécurité, à l’attribution des primes Covid, en passant par le local des agents de surveillance des tortues à Moya ou la vétusté des locaux au jardin botanique de Coconi. “Sur la cabane de Moya qui est en cours de réhabilitation, il avait été convenu que les agents conservent un abri, or dès la première semaine d’octobre, tout a été cassé”, signale par exemple la représentante syndicale. Des réunions de travail devaient aussi être fixées à l’agenda pour mieux prendre en compte les demandes des femmes de ménage, ainsi qu’une réunion du CHSCT. Sans effet. “Le jour où nous leur annonçons la nouvelle grève, ils trouvent tout à coup des disponibilités, alors qu’une réunion devait avoir lieu la semaine du 14 octobre !”, poursuit-elle, sidérée.
Autre sujet de discorde, commun à tous les agents : la question de la prime Covid. Les grévistes pointent du doigt le manque de transparence dans l’attribution de ce petit bonus destiné à ceux qui avaient continué à charbonner pendant le confinement. “Ils devaient nous transmettre le fichier faisant état de la présence des agents”, rappelle Ichaan Madi. Or, un mois plus tard, force est de constater que leur vœu n’a pas été exaucé. “Toujours à l’heure actuelle seuls les directeurs ont obtenu la liste, et personnellement, je ne l’ai pas en ma possession”, s’agace Mouslimou Ma-Ouard, secrétaire général du syndicat FO conseil départemental.
Des retenues de salaire pour des agents du STM
Le hic, c’est que cette liste est déterminante, car elle permet aussi de savoir quels agents étaient en “autorisation spéciale d’absence” pendant le confinement. À savoir ceux dont l’activité n’était pas indispensable au maintien des services essentiels du Département, comme des assistants techniques du STM par exemple. Or, certains d’entre eux s’estiment aujourd’hui lésés, car ils ont subi des retenues de salaire. “C’était le confinement, et l’administration s’est permis de dire qu’elle avait rappelé des agents, qui ne sont pas revenus. Pour nous au syndicat, la reprise du travail n’était pas claire, j’ai donc demandé des justificatifs”, abonde le gréviste. Interrogés sur la relative discrétion des employés des barges lors de la première grève, les syndicalistes assurent que le sujet était bien sur la table. “Mais les retenues sur leur salaire sont devenues une réalité entre-temps, puisque rien n’a été fait pour interrompre cette décision”, répond Mouslimou Ma-Ouard.
Résultat, la situation ne risque pas de s’améliorer cette semaine pour les habitués de la barge. Sur sa page Facebook, le STM a d’ores et déjà communiqué sur les perturbations à prévoir ce mardi matin, avec un service interrompu de 8h à 12h. Un seul navire pour assurer le service minimum. De son côté, le syndicat Force ouvrière attend une première réunion de concertation pour décider des suites du mouvement. Avec un message clair : “cette grève sera plus dure que la précédente. Sans retour favorable, nous n’hésiterons pas à resserrer les vis”, met en garde Mouslimou Ma-Ouard.