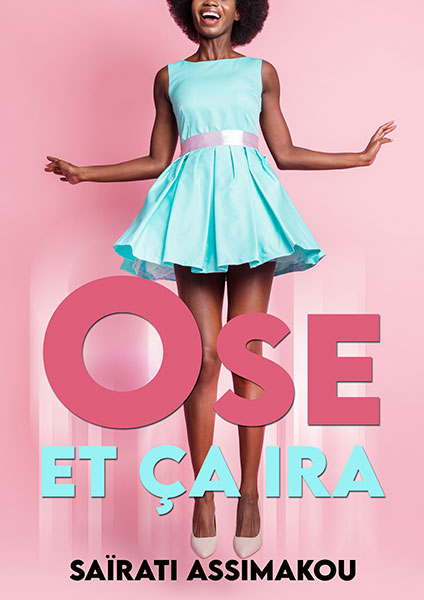Coutumier de ces bilans annuels pour expliquer son action au Sénat, Thani Mohamed-Soilihi a évoqué plusieurs sujets avec la presse, ce jeudi 3 novembre, à Cavani. Il est revenu notamment sur ses travaux sur le foncier, la sécurité, le loi Mayotte et ses relations avec les autres élus du territoire.
Sur sa candidature
A un an des élections sénatoriales, Thani Mohamed-Soilihi ne dément pas sa volonté de continuer son travail au Sénat. « Si elles étaient aujourd’hui, je dirais que je suis candidat », confirme-t-il, ce jeudi, dans sa permanence de Cavani. « Je ne peux pas être catégorique puisqu’il reste un an de travaux. »
Sur le foncier
Rapporteur de plusieurs travaux sur ce sujet, il insiste sur le fait que ceux-ci « doivent continuer ». « C’est sur la base de ces trois rapports que le foncier outre-mer a été réformé ces trois dernières années et que la commission d’urgence foncière a été créée », rappelle-t-il, avec fierté.
Sur la sécurité
Pour « cette préoccupation majeure », il est satisfait qu’une commission soit venue à Mayotte afin de se rendre compte de la situation locale. « Nos appels, nos alertes ont fini par être entendus », estime-t-il, en faisant référence aux rendez-vous passés avec le président de l’association des maires (David Lisnard), la présidente de l’Assemblée nationale (Yaël Braun-Pivet) et le ministre délégué aux Outre-mer (Jean-François Carenco). Un autre est déjà prévu avec le cabinet de la Première ministre, Élisabeth Borne, le 24 novembre. « On ne parlera pas que de sécurité », fait-il cependant remarquer.
Il ajoute qu’il milite toujours pour un renforcement des forces de l’ordre sur le territoire et un passage « nécessaire » en zone police de Koungou et Petite-Terre. Mais pourquoi se satisfaire de nouveaux gendarmes alors ? « C’est ça qui était en discussion. On n’allait pas cracher dessus », dit-il rigolant.
Sur le centre éducatif fermé
Cette demande régulière du sénateur a fini par porter ses fruits. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a annoncé sa construction prochaine en 2024 (voir Flash Infos du 22 août). S’il ne connaît pas encore les détails et admet que ça ne fera pas tout, il revendique « cet outil nécessaire pour juguler la flambée de violences sur l’île ». D’une capacité d’une quinzaine de pensionnaires, il permet « à la fois de faire de la répression et de la prévention auprès des mineurs ».
Sur ses relations au Sénat
Le sénateur argue qu’il entretient de bonnes relations avec ses collègues sénateurs, même quand ils ne sont pas de son bord politique (La République en Marche). « Je me suis toujours débrouillé pour discuter avec mes collègues qui ne sont pas de la famille politique », fait-il valoir. « Le rendez-vous avec Gérard Larcher (N.D.L.R. Les Républicains, président du Sénat), c’est moi qui l’aie obtenu. » Ou quand il évoque la visite de la sénatrice Laurence Cohen (Parti communiste) dans le cadre d’une mission sur la question des soins (voir FI du 7 mars 2022). « Madame Cohen est ressortie d’ici en disant qu’elle va être une grande défenseure de Mayotte à chaque fois qu’il en sera question au Sénat ».
Sur la loi Mayotte
Même s’il souhaite montrer un visage d’unité avec les élus locaux et ses collègues parlementaires, il concède que la loi Mayotte n’a été pas le meilleur exemple. Il met davantage cela sur « un manque de communication ». Il ne cache pas qu’il aurait préféré que le conseil départemental émette « un avis réservé » et laisse le texte prendre la direction du Parlement (voir FI du 14 janvier). Mise au placard, la loi comportait plusieurs domaines différents (immigration, santé, social, sécurité, institutions).
Se déclarant favorable à l’instauration d’un scrutin de liste pour les élections départementales, il espère d’ailleurs que « le toilettage institutionnel » sera plus facile à mettre en place hors « d’un texte fourre-tout ».
Sur l’histoire des billets de banques
La Banque centrale européenne va mettre en circulation de nouveaux billets représentant l’Union européenne et ses territoires ultramarins. Sauf que Mayotte n’y figure pas. Un oubli que le sénateur essaye de faire corriger avant qu’il ne soit trop tard. « J’ai envoyé un courrier à Christine Lagarde, la présidente de la BCE, en mettant en copie le président de la République Emmanuel Macron, le président de la cour des comptes Pierre Moscovici et celle de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Ils m’ont tous accusé réception », défend-il, optimiste quant à l’issue de sa demande.