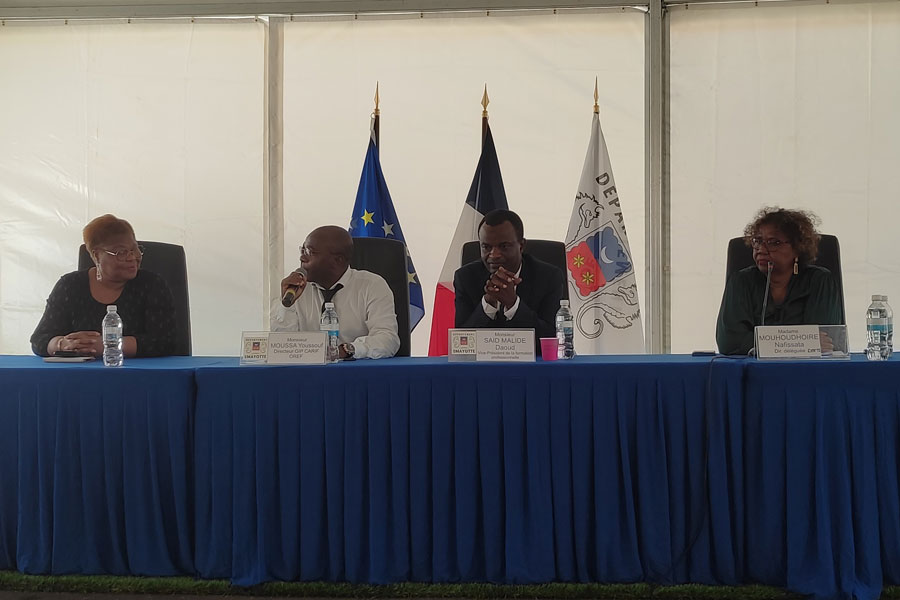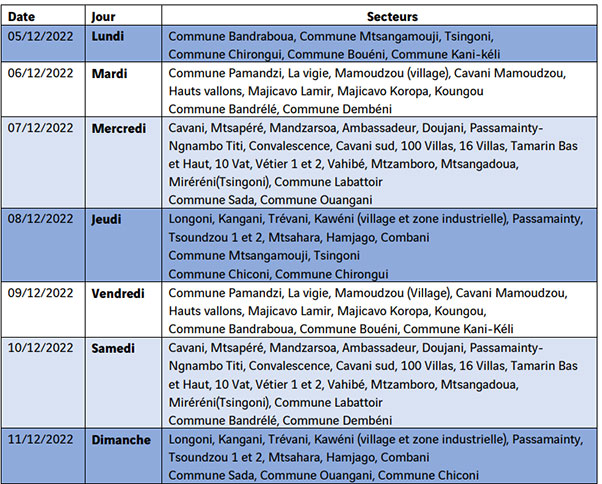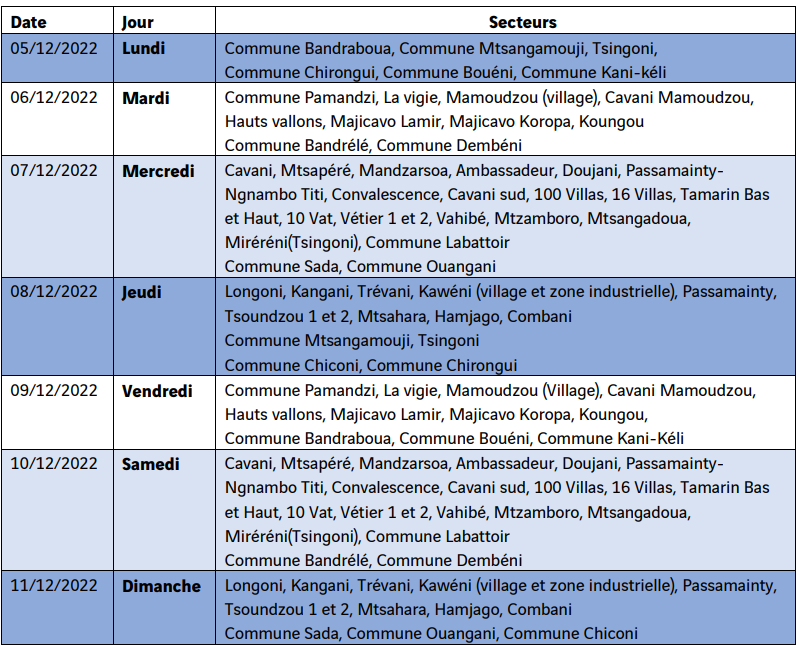Le produit intérieur brut (PIB) à Mayotte augmente de 4.1 % en 2020. La consommation des administrations publiques reste en effet soutenue, indique une étude de l’Insee La Réunion-Mayotte. Cette année-là, la crise sanitaire pèse sur l’économie mahoraise en raison des mesures de restrictions mises en œuvre, pour autant, le PIB de Mayotte progresse donc de 4.1 % pour s’établir à 2.7 milliards d’euros. Cette résistance de l’activité économique s’explique, en premier temps, par le poids important des administrations publiques, qui ont moins subit la crise sanitaire que les entreprises privées. En outre la forte croissance de la population a aussi eu un effet favorable sur l’activité économique, par son effet sur la consommation des ménages et les besoins en services non marchands.
Du fait de la croissance démographique, le pouvoir d’achat individuel moyen des ménages ne progresse que de 0.2 % en un an et le PIB par habitant ne progresse, quant à lui, que de 0,5 % en valeur et atteint 9.900 euros en 2020. Le niveau national est 3.5 fois plus élevé. La consommation finale des administrations publiques est le premier moteur de la croissance, suivi par le solde des échanges avec l’extérieur qui induit un recul des exportations et importations. A contrario, la crise sanitaire a affecté la production des entreprises mahoraises, en augmentant que de 1%. La consommation totale des ménages à Mayotte, qui inclut celle des ménages résidents et des ménages non-résidents, baisse de 0.6 %.