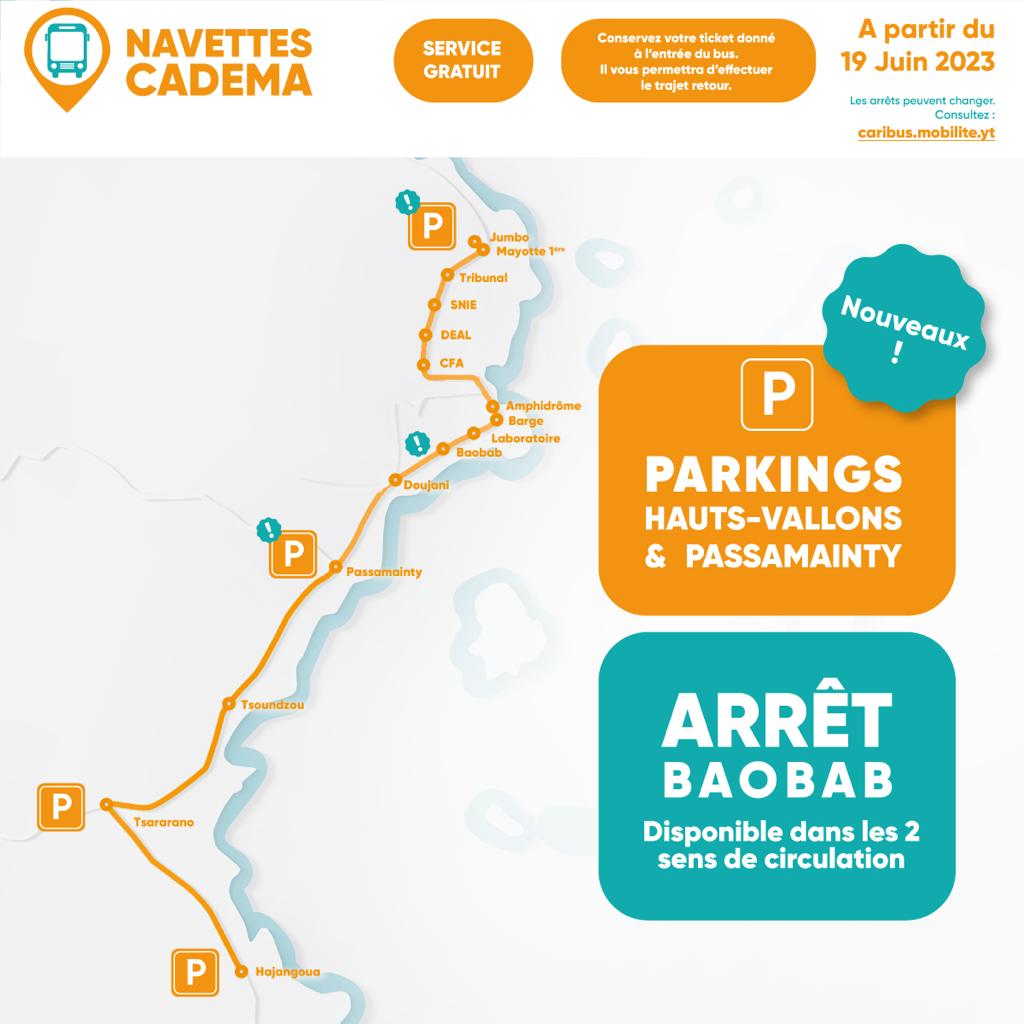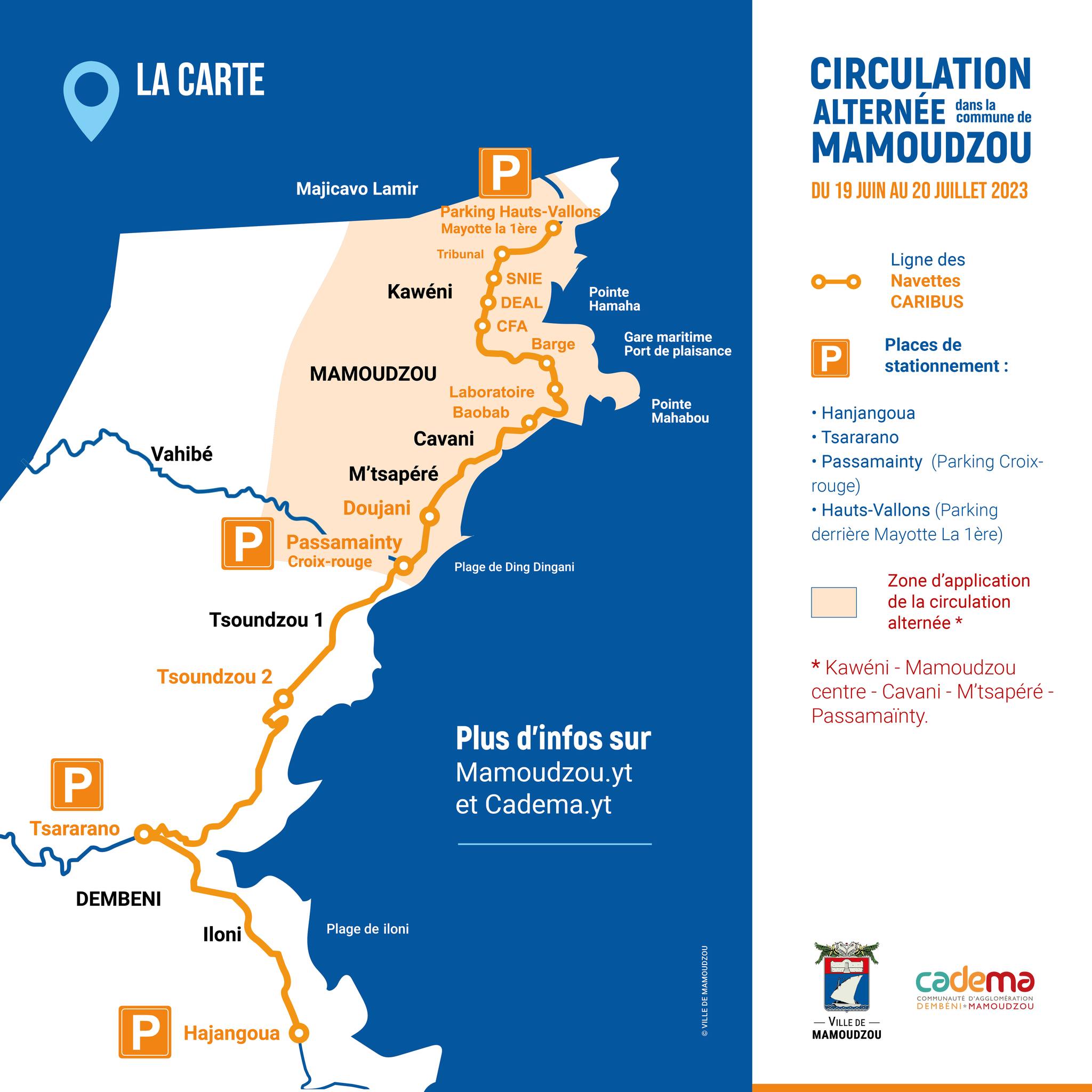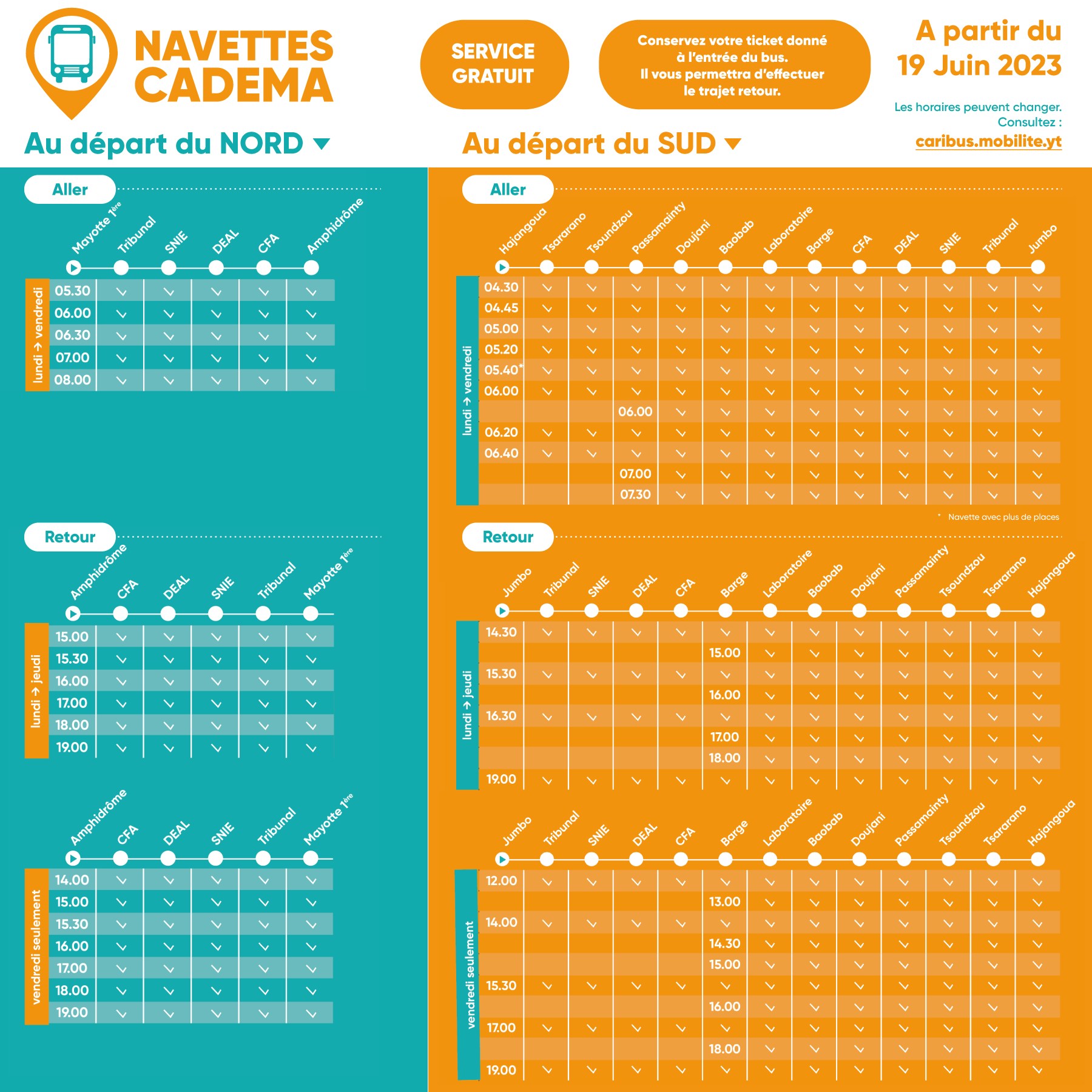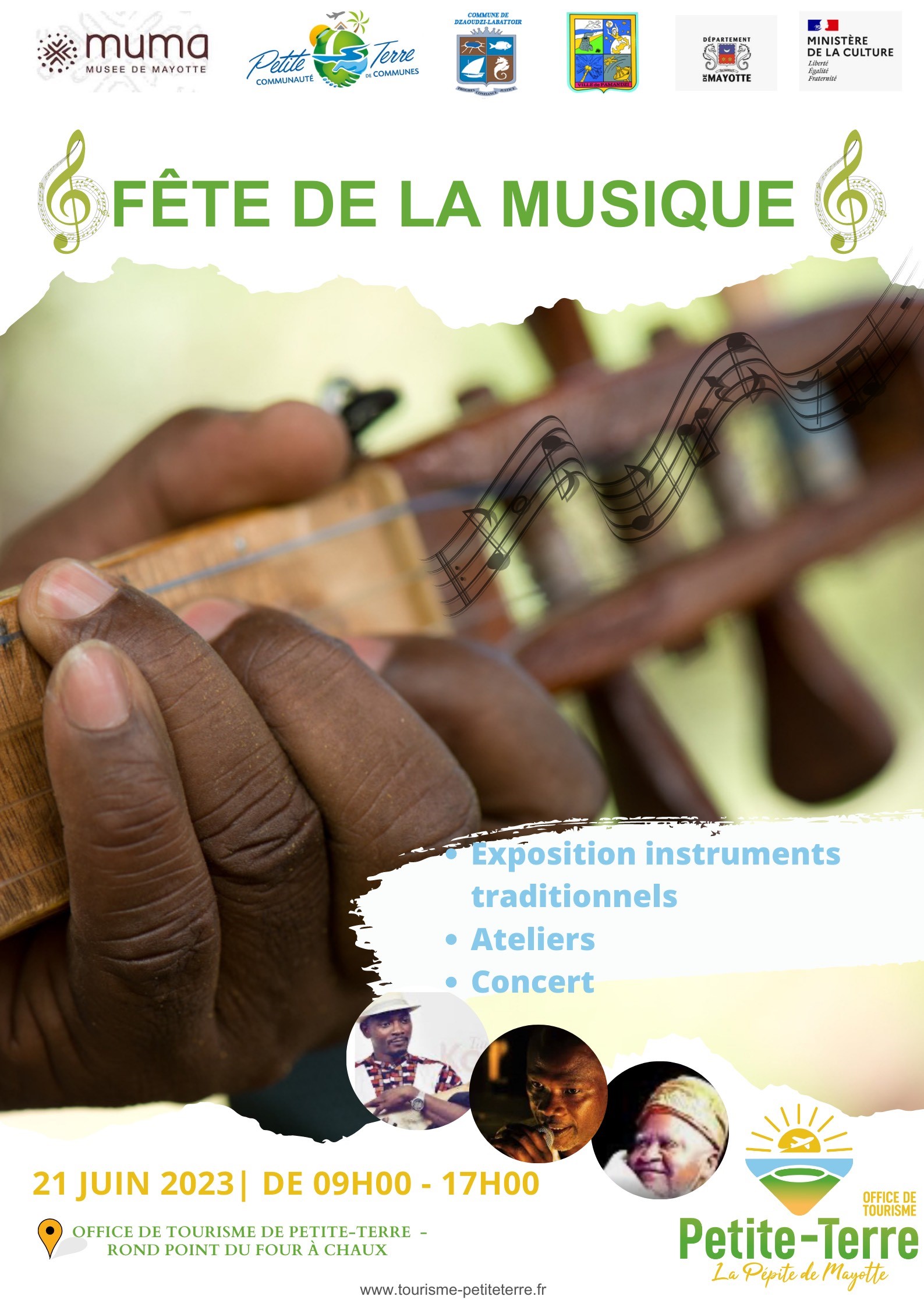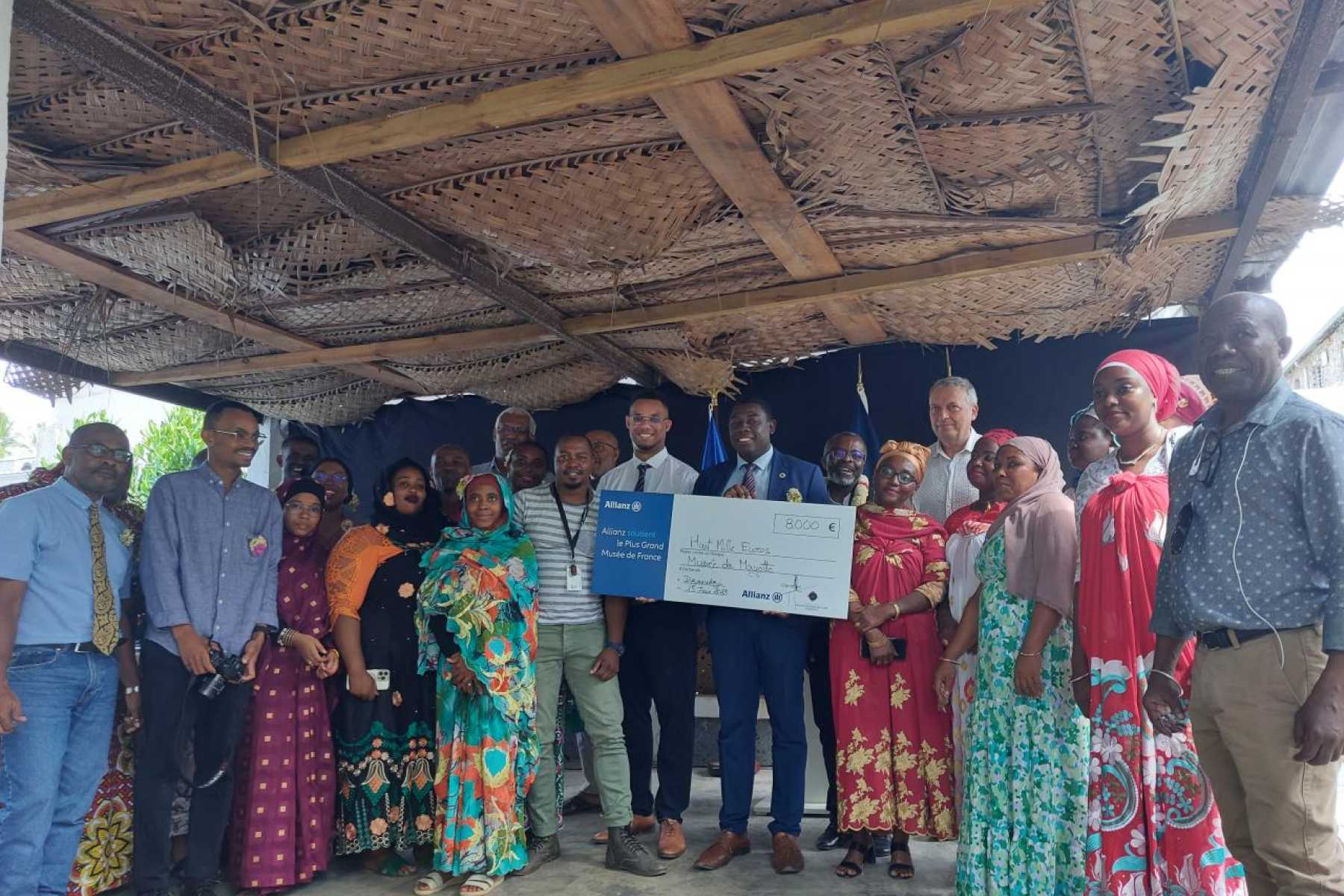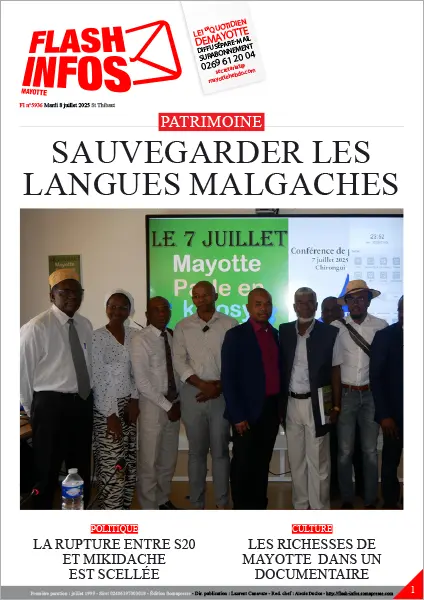Permettre aux jeunes de s’entraîner sur un vrai terrain, c’est l’objectif de Pierre Rivaud, professeur d’éducation physique et sportive au collège de Doujani. Après que son équipe soit arrivée huitième au championnat de France UNSS de golf, un partenariat entre le golf des Ylangs et l’UNSS de Doujani s’est lancé. On fait le point avec lui.
Presque un an après l’ouverture de la section golf à l’UNSS du collège de Doujani, un partenariat s’est créé entre l’association sportive et le Golf de Ylangs à Combani, qui permet aux élèves de venir s’entraîner les mercredis et vendredis après-midi. Récemment, le collège de Doujani a fait la fierté des golfeurs mahorais, en arrivant huitième sur seize au classement du championnat national. Ciblés, plusieurs objectifs sont dans le collimateur du professeur de sport, Pierre Rivaud.
Flash Infos : En quoi consiste le partenariat entre le Golf des Ylangs et l’UNSS Doujani ?
Pierre Rivaud : En tant que professeur d’éducation physique, nous avons ouvert à l’UNSS une section golf. Nous pouvions nous permettre de jouer sur le mini parcours que nous avons créé au collège, mais pour les grands coups c’était plus problématique. C’est pour ça que nous avons collaboré avec le Golf des Ylangs. Nous pouvons donc utiliser le terrain le mercredi après-midi avec l’UNSS, et le vendredi. Le problème c’est que le seul vrai parcours est à Combani au Golf des Ylangs. L’intérêt c’est, qu’à long terme, des jeunes mahorais puissent jouer sur Mayotte et s’ouvrir sur des compétitions à La Réunion, voire dans l’hexagone. C’est aussi de développer les capacités des jeunes, pour qu’il puisse plus tard jouer, je l’espère, au niveau national, puis si, dans quelques années, un se démarque et devient très fort, tendre vers l’européen ou l’international. Mais ça, c’est un objectif très lointain. Là pour le moment, le partenariat c’est qu’on puisse avoir des conventions avec les écoles primaires, les collèges, et pourquoi pas les lycées et l’université de Dembéni. Le Golf des Ylangs est complètement ouvert à ça, nous avons besoin de plus de joueurs et de mahorais surtout.
F.I. : Pouvez-vous nous parler un peu du championnat et du résultat ?
P.R. : Nous avons commencé le golf au collège de Doujani au mois d’août de l’année dernière. Les compétitions organisées par le service régional de l’UNSS étaient cette année qualificatives pour le championnat national. C’est le collège de Doujani qui a gagné. Nous sommes partis en métropole du 5 au 10 juin, nous nous sommes retrouvés huitième sur seize équipes, grosse performance, on en est très fiers ! Nous étions une équipe de quatre et un arbitre. L’équipe est obligatoirement mixte, donc obligatoirement une fille. Pourquoi ne pas espérer tendre vers une mixité totale avec deux filles deux garçons.
F.I. : Envisagez-vous de réitérer votre participation l’année prochaine ? Quel résultat espérez-vous ?
P.R. : Tout à fait. Ce que l’on espère pour l’année prochaine c’est que, même si je ne sais pas encore comment ça se passera pour le collège de Doujani, parce qu’un autre collège de Mayotte peut être sélectionné, mais il va y avoir des grosses discussions pour qu’une équipe de Mayotte puisse être qualifiée des trois catégories scolaires. Il y a excellence qui est réservée aux sections sportives aux jeunes joueurs qui sont classés, un championnat établissement, celui auquel on a participé où là tous les élèves peuvent venir s’ils ne sont pas classés et le dernier, le championnat de sport partagé, où un élève en situation de handicap, joue avec un élève dit « valide ». On espère que l’année prochaine on aura des financements pour qualifier des équipes dans ces catégories. Et nous, par rapport à Doujani, c’est sûr qu’on aimerait bien se qualifier au moins dans une catégorie. On veut repartir l’année prochaine et on espère, si c’est le cas faire mieux dans le classement.