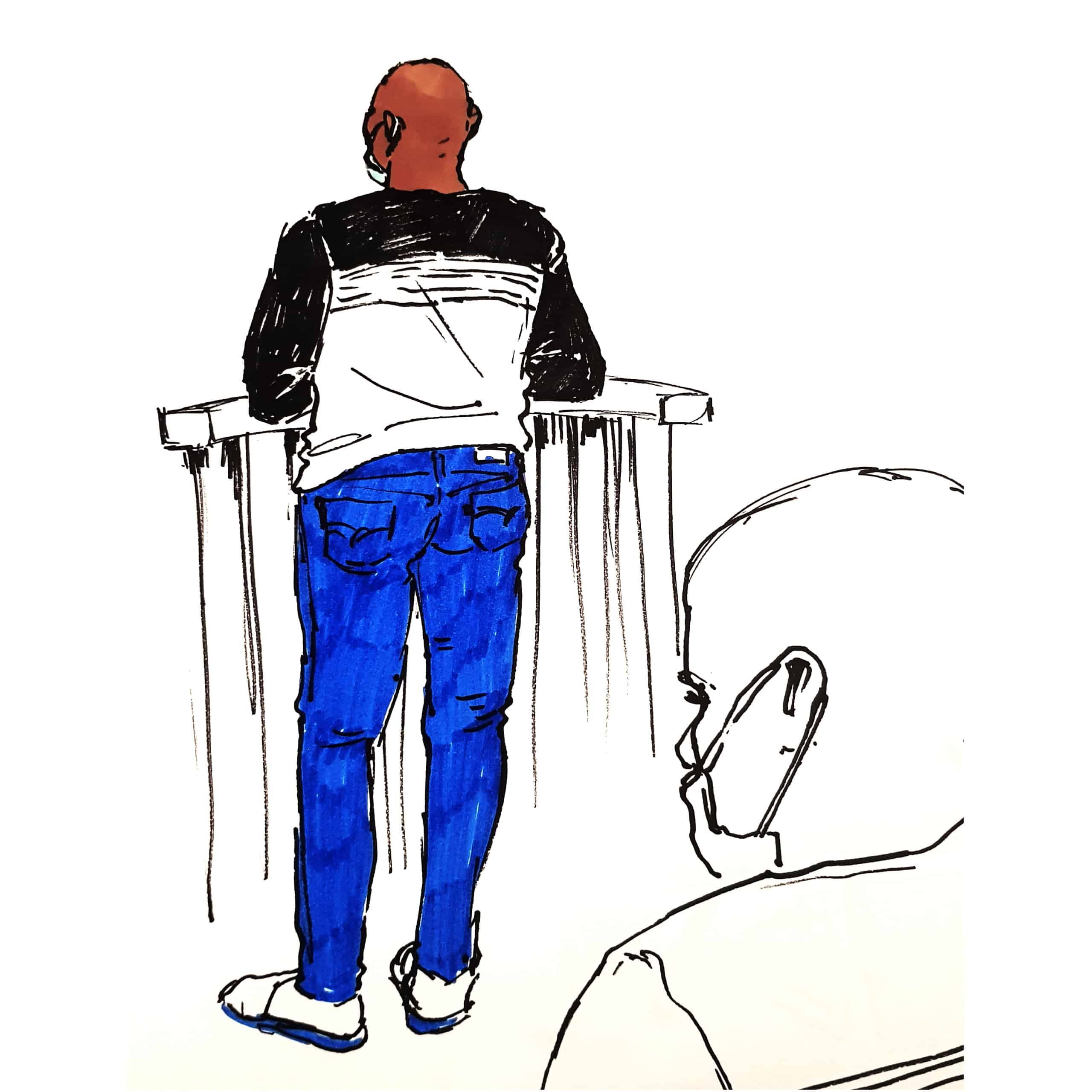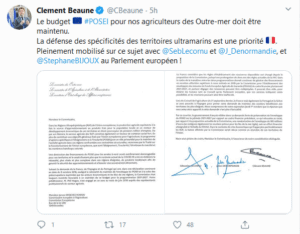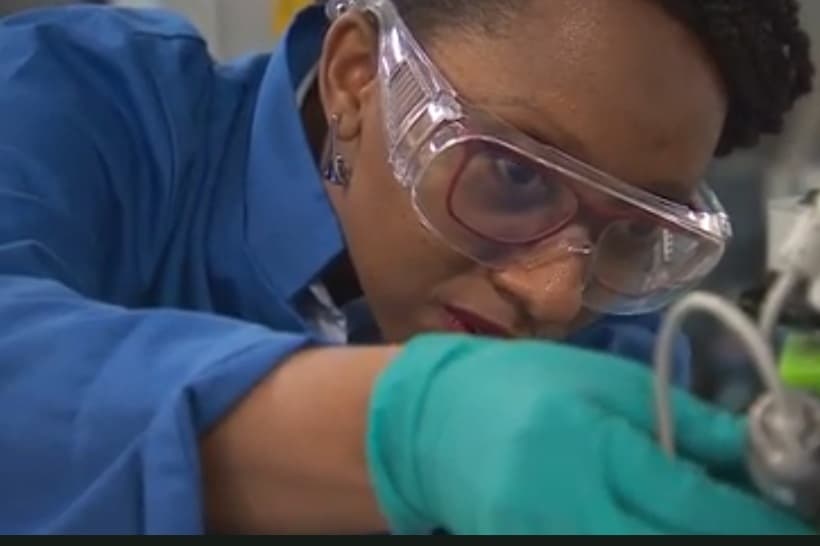La confédération française démocratique du travail a lancé un préavis de grève illimité au sein de l’agence régionale de santé (ARS) à partir de ce mercredi pour exiger un certain nombre de revendications, comme le départ du directeur de la Santé Publique, l’application d’un organigramme digne d’un établissement de plein exercice, la mise en place d’un nouveau programme régional de santé et d’un plan de formation individualisé. Toute une série de mesures que Dominique Voynet, la directrice générale, renvoie dans les cordes au cours d’une audioconférence « non prévue » lundi matin.
Sur le qui-vive depuis le début de l’année entre son émancipation de La Réunion le 1er janvier et la gestion de la crise sanitaire, l’agence régionale de santé (ARS) vit un nouvel épisode marquant dans sa récente histoire. Avec cette fois-ci un préavis de grève illimité lancé par la CFDT à partir de ce mercredi. Et leurs revendications sont multiples… « Il faut absolument arrêter l’hémorragie », plaide Kamalidine Dahalani, représentant syndical au sein du comité d’agence provisoire. « Elle fuit les discussions et fait croire que le dialogue est bon alors que nous faisons ce point presse sur le parking de la CSSM… » Une première missive qui annonce la couleur !
Parmi tous les points évoqués, l’un d’eux concerne le départ de l’actuel directeur de la Santé Publique. « Son maintien est incompatible car il était contre l’ARS Mayotte. » Et pour appuyer leurs propos, la quelque dizaine de colériques réunis ce lundi matin rappelle les 53 jours de grève en 2012 pour promouvoir l’égalité de traitement entre les deux départements d’Outre-mer de l’océan Indien ainsi que l’autonomie et le rééquilibrage des pouvoirs. « Il a contribué à la dégradation des conditions de travail des agents de la lutte anti-vectorielle. » Pas de quoi faire sourciller Dominique Voynet, la directrice générale, qui prône la prescription et qui se dit gênée de régler ce conflit après toutes ces années. « Nous voyons bien qu’il y a des problèmes personnels derrière [ce souhait]. »
« Nous ne sommes pas une armée mexicaine »
Mais les futurs grévistes n’en démordent pas. Au contraire. Aux yeux de Kamalidine Dahalani, l’ARS telle que nous la connaissons aujourd’hui ne rejoint en rien les espérances d’hier. « Nous nous sommes battus pour [en] avoir une de plein exercice, digne, de proximité, avec des valeurs humaines, pour mieux prendre en charge les besoins de santé de la population. » Selon eux, l’organigramme actuel fait défaut au bon fonctionnement de la structure, qui ressemble plus à du « bricolage » qu’à autre chose. Argument que réfute l’ancienne ministre, qui justifie « une organisation moderne, calquée sur celle du ministère de la Santé et des autres ARS », avec un secrétariat général – qui coordonne les ressources humaines, les finances, les marchés, les contrats, l’information – pour assurer « la solidité budgétaire et juridique des décisions qui sont prises dans tous les services ». « On me reproche la concentration des pouvoirs sous la houlette de la secrétaire générale, mais je ne l’ai pas mise en place puisqu’elle a été nommée par l’ancien directeur », se défend-elle. Avant de préciser qu’il apparaîtrait « un peu ridicule » de « créer neuf directions » et de « donner des postes à des gens qui ne relèvent pas de la direction ». « Nous ne sommes pas une armée mexicaine », ironise-t-elle.
Autre volet discordant : la formation. Là encore, la CFDT dénonce le mépris de Dominique Voynet, à l’égard des agents mahorais, qu’elle aurait qualifiés « d’incompétents ». Une attaque qui fait bondir la directrice générale. Cette dernière évoque un recrutement dédié à cette tâche et n’hésite pas à faire une piqûre de rappel. « Quand je suis arrivée, aucun Mahorais n’était chef de service. » Contre 5 aujourd’hui : Mayssoune Idaroussi au médico-social, Nassim Guy à la prévention, Alimo Mdjahila à la logistique, Kamal Dahalani à l’informatique et Anchya Bamana aux soins de premier recours. « Ils ont été tutorés par des pairs et ont suivi des formations. » Deux autres devraient suivre le même parcours dans un avenir proche. « Je ne suis pas là pour faire plaisir, mais je préfère nommer un candidat compétent et expérimenté qui a une vision sur le long terme à Mayotte. » En clair, que vous soyez un mzungu ou un natif de l’île, l’efficience prime sur les origines ! À l’instar du cas de Mouhoutar Salim, directeur général adjoint depuis le 1er août, dont le sort a fait couler beaucoup d’encre ces derniers mois. « Il incarne l’ARS auprès de la population et me représente dans beaucoup de réunions auxquelles je ne peux assister », justifie la directrice générale.
« L’arbitrage du ministère » pour le plan régional de santé
Enfin, Kamalidine Dahalani regrette l’absence de mise en place d’un plan régional de santé clair, net et précis. « Quand nous construisons une maison, la première des priorités sont les fondations. » Encore une fois, Dominique Voynet sort l’artillerie lourde pour contredire « le syndicaliste numéro 1, parti sur le chantier de guerre, [qui] est venu des dizaines de fois dans mon bureau [pour échanger] ». Sur ce dossier du PRS, la directrice générale clarifie le débat. « Il a été bâti à une époque où nous savions qu’il y aurait une scission avec La Réunion. Nous avons demandé l’arbitrage du ministère. » Et l’avis juridique devrait intervenir pour engager sa révision. La plus grande peur du syndicat ? Que la construction du second centre hospitalier n’y soit pas intégrée… « Nous l’intégrerons sans ouvrir la boîte de Pandore. Celui qui me convaincra de le réécrire pendant des mois n’est pas encore né », assure-t-elle, précisant au passage son déplacement à Paris en milieu de semaine pour évoquer les options du deuxième hôpital sur la façace ouest du territoire avec les ministres de la Santé et des Outre-mer.
Suffisant pour enterrer cette grève ? « Nous ne voulons pas lui mettre des bâtons dans les roues », mais « qu’elle se ressaisisse pour créer une vraie ARS », résume sobrement Kamalidine Dahalani. À l’heure actuelle, personne n’est en mesure de certifier sa tenue. Toujours est-il que Dominique Voynet semble avoir les reins assez solides pour atténuer ce brouhaha « d’un seul syndicat ». « Une partie des agents sont tombés de l’armoire en apprenant ce mouvement alors que nous organisons chaque mois une réunion de dialogue social depuis la création de l’ARS », confie-t-elle. D’autant plus que les élections syndicales, à la suite de la fusion des comités d’agence et des comités d’hygiène, sécurité et des conditions de travail, initialement prévues en mai ont été reportées à novembre… Hasard du calendrier ou véritables revendications ? Réponse ce mercredi.