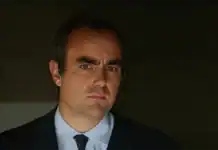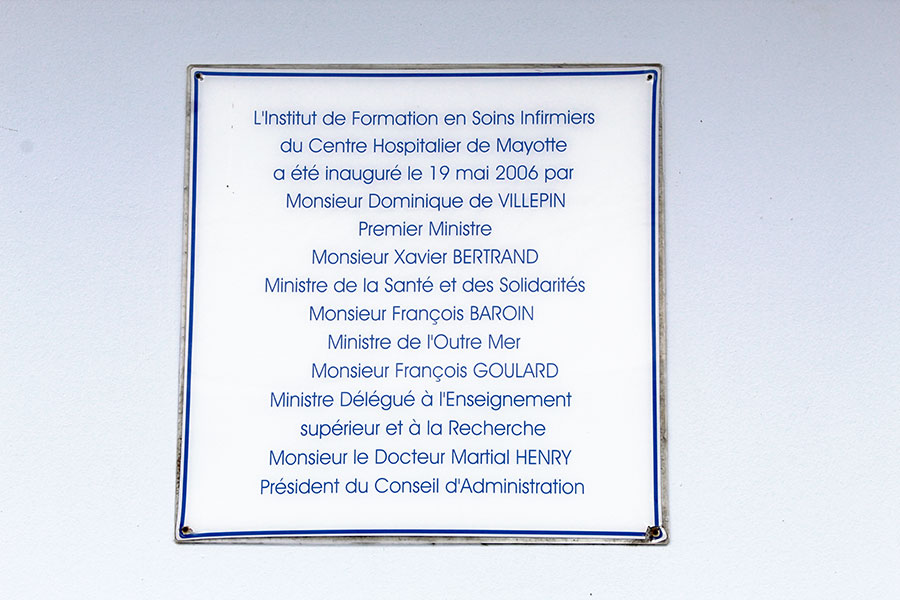L’installation du nouveau conseil municipal des jeunes (CMJ) de la ville de Mamoudzou s’est tenue samedi matin dernier à la MJC de M’Tsapéré. Au terme d’une élection qui s’est déroulée sur liste, dans des règles légèrement simplifiées par rapport à celle des adultes, c’est finalement la jeune Anaëlle Moussa qui a été élue, venant ainsi prendre la place d’Océane Plaideau, la maire jeune sortante.
Les femmes ont décidément la cote chez les jeunes de Mamoudzou ! Après Océane Plaideau, qui a tenu la place de maire pendant son mandat de trois ans au sein de la ville de Mamoudzou, c’est désormais Anaëlle Moussa qui est venue la remplacer. Agée de 16 ans, cette adolescente aux airs studieux est élève de seconde au lycée Younoussa Bamana. Elle a battu son unique adversaire, Dao Onthoimine à 26 voix contre 22. Le seul et unique bulletin nul placé dans l’urne n’aurait de toute façon pas fait la différence, preuve que la jeune fille s’est montré particulièrement convaincante auprès du CMJ. Se présentant comme « dynamique, sociable, engagée et à l’écoute », Anaëlle Moussa saura de toute évidence faire des propositions convaincantes pour améliorer les conditions de vie de la jeunesse de Mamoudzou.
Un programme visant à restaurer le lien social
Les deux points forts du programme de la nouvelle jeune maire sont les suivants : organiser des sorties sportives et culturelles afin « d’aider les jeunes en perte de repère » et surtout organiser des ateliers pour les personnes âgées pour « restaurer le lien intergénérationnel ». Un programme surtout axé donc sur le lien social entre les différents habitants de la ville chef-lieu qui, il ne faut pas se le cacher, tend à se perdre avec le changement de société opéré par la départementalisation de l’île. Mais Anaëlle a également bien l’intention de poursuivre le programme de la maire sortante laquelle, dans son discours précédant le vote, a insisté sur la nécessité de travailler efficacement sur les problématiques environnementales dans le cadre du projet « Mamoudzou ville durable à l’horizon 2040 ».
Anaëlle Moussa travaillera avec les 14 adjoints de sa liste, tous dédiés à des domaines différents de la vie de la commune. Évidemment, le rôle du CMJ est uniquement consultatif, mais il démontre la volonté de Mamoudzou d’intégrer les jeunes à la politique locale et illustre la victoire de la démocratie participative. Permettant aux jeunes habitants de la ville de découvrir le fonctionnement des instances politiques, il a un rôle foncièrement pédagogique. Il permet également d’apporter un souffle de fraîcheur et de nouveauté dans la politique locale en proposant parfois des idées novatrices, mais surtout en permettant aux jeunes d’exprimer leurs réels besoins.
Une élection sous l’égide du maire Ambdiwahedou Soumaïla
L’installation du nouveau CMJ s’est bien évidemment tenu en présence des principaux élus de la ville et sous l’égide du maire Ambdiwahedou Soumaïla. Ce dernier a fait un discours en prélude à l’élection pour encourager les jeunes, mais également pour les prévenir que « gérer les affaires d’une collectivité n’est pas une tâche facile ». « Il faut parfois tenir son mandat dans des conditions complexes en étant humble et toujours dans le respect de l’autre. Pour cela, le dialogue est essentiel », a-t-il déclaré tout en précisant que le rôle pédagogique du CMJ était très important dans la mesure où « un jour, vous aurez à gérer les affaires de la commune à notre place ». Gageons que la nouvelle jeune maire et ses 14 adjoints ne manqueront pas de se tenir à la hauteur de la tâche qui leur est désormais impartie !