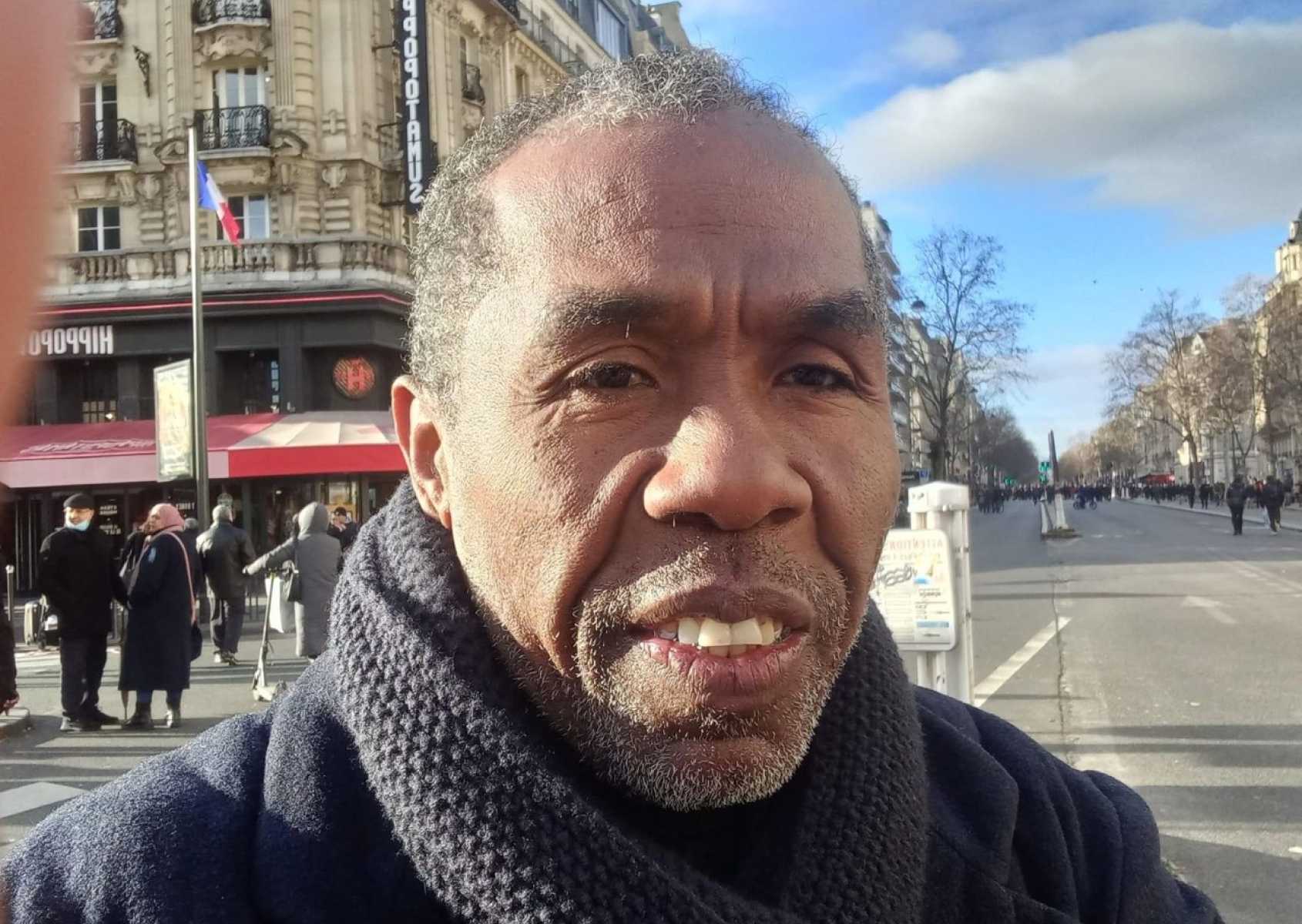Après quatre mois de travaux, le bureau de poste de Dzoumogné, situé 303, rue François-Mitterrand, achève sa transformation. Il a ouvert ses portes le lundi 6 février. Dans cet espace totalement métamorphosé et moderne, La Poste propose une offre de services adaptée aux habitants. « Les clients sont accueillis dans un bureau de poste modernisé et totalement repensé, avec un nouveau design et un espace lumineux et fonctionnel. Pour l’éclairage, l’utilisation de LED permet une consommation minimum. Pour compléter, un sol effet parquet apporte une touche contemporaine et chaleureuse à cet espace climatisé. Dès son arrivée, le client est accueilli par un chargé de clientèle facilement identifiable grâce à sa nouvelle veste noire aux couleurs de La Poste et de La Banque Postale », indique La Poste.
Deux conseillers bancaires reçoivent désormais les clients en toute confidentialité avec un accès réservé. Les clients peuvent au choix échanger avec leur conseiller à distance ou en face à face. Pour les opérations bancaires nécessitant du conseil et un accompagnement, un accueil dédié dans l’espace commercial a été installé. Un distributeur automatique de billets situé à l’extérieur du bureau de poste permet également aux clients de retirer des espèces en toute autonomie.
Les travaux ont aussi permis de créer un espace confidentiel dédié à l’accompagnement des démarches France services. Au-delà des services de La Poste, les habitants de la commune de Bandraboua pourront bénéficier des services de différents opérateurs, comme, la CSSM, le RSMA, la DRFiP, Pôle emploi et les services des ministères de la Justice et de l’Intérieur. Au total, 400.000 euros ont été investis dans cette modernisation. Ils ont été en totalité financés par le fonds postal de péréquation territorial et engagés par la Commission Départementale de Présence Postale Territoriale de Mayotte, au titre de la mission de service public d’aménagement du territoire confiée à La Poste. Le bureau de Dzoumougné est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et 13h à 15h, le samedi de 8h à midi.