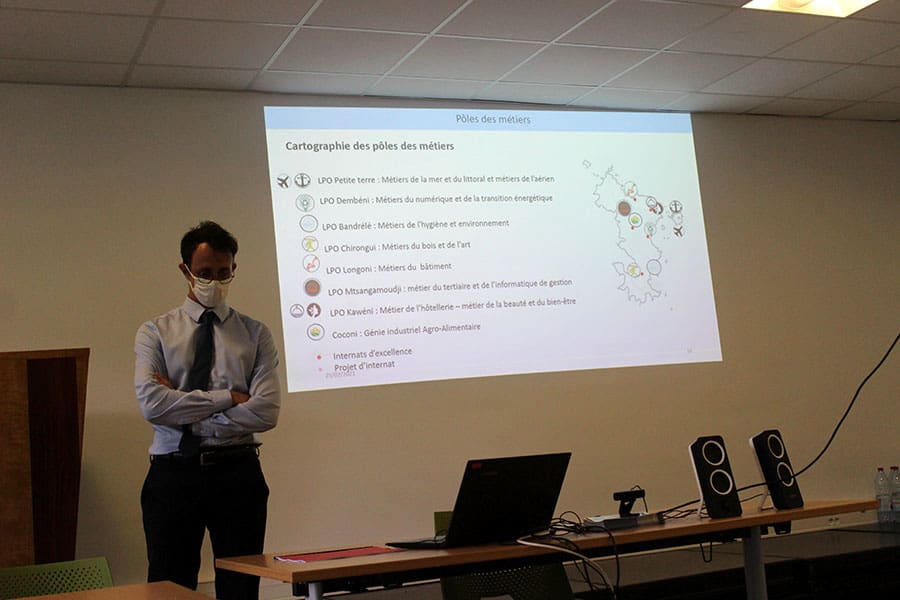On nous avait promis une fête pour ce 31 mars 2011 et bien il n’en a rien été. Ceux qui n’ont pas pu se rendre à Mamoudzou, ceux qui étaient au travail n’ont rien raté, les autres sont frustrés. La fête est reportée à ce dimanche.
Ça devait être la journée des Mahorais et Mahoraises. Tôt ce matin, à travers toute l’île, les femmes se sont vêtues de leurs plus beaux salouvas choisis pour l’occasion. Les unes avaient un châle bleu, le haut blanc et le salouva rouge, d’autres sont toutes de rouge vêtues, de blanc ou de bleu. En chemin, on croisait certaines avec les mêmes salouvas. Dans les taxis, on ne parlait que de ça : la départementalisation de l’île, l’arrivée de la ministre Marie-Luce Penchard, l’élection du président du conseil général de ce tout nouveau département… L’heure était à la fête. « Ca fait si longtemps qu’on l’attend ce département », déclare une femme… et patatras.
La fête, attendue depuis des dizaines d’années, est gâchée. L’élection du président n’a pas lieu et il faut tout reporter à dimanche. On en oublie presque que cela ne change rien et qu’on est officiellement le 101ème département de France, le 5ème Département d’Outre-mer. Sauf que sans un président au conseil général, la ministre Marie-Luce Penchard a préféré reporter à dimanche sa venue à Mayotte. Les visages sont fermés à l’annonce de cette nouvelle : « C’est vrai ça ? Je me disais que j’allais faire la fête après, mais elle ne vient vraiment plus… » Non, elle ne vient pas la ministre…
Sur le parvis du front de mer, là où siège le comité du tourisme, cette même place qui devait être inaugurée ce jour et changer de nom pour s’appeler « La place du 101ème département », les podiums sont prêts, les drapeaux tricolores et européens virevoltent au vent. On attendait jusqu’à 30.000 personnes, hommes, enfants et surtout des femmes. Mais la nouvelle est partie comme une trainée de poudre. Environ un millier de personnes tout au plus sont là, la police vérifie les dernières mesures de sécurité, mais l’ambiance n’y est plus. Il va falloir se préparer à nouveau pour dimanche. Et d’ici là que les passions retombent et que l’esprit de la fête revienne.
Certains chantent mais le cœur n’y est pas. Sur l’ancienne place du marché, les chapiteaux sont dressés, mais le maoulida shengué prévu est reporté aussi, et plus tôt que prévu le parvis du comité du tourisme se vide… Les gens rentrent chez eux avec une frustration et une amertume certaine. Il
va falloir se remobiliser pour faire la fête dimanche, et célébrer comme il se doit ce nouveau département.
Cet article a été repris tel quel dans le Mayotte Hebdo n°515 du vendredi 1er avril 2011
La réaction de la population
Madame Mdzadzé
C’est spectaculaire ! On observe, on regarde, mais franchement on ne comprend pas, rien de rien, mais bon, peut-être que ce sont des stratégies. En tout cas, on est encore sous le choc, voilà !
Hassani Abdallah
Ce n’est pas normal ! Ce n’est pas républicain. On a jamais vu ça depuis les années 80, jamais ! Qu’on ne soit pas une majorité, c’est normal parce qu’il y a un choix à faire. Ça ne doit pas se faire comme ça !
Hanima Ibrahima, maire de Chirongui
Il est fort dommage de voir les élus convoquer la population pour venir élire le président du conseil général et s’absenter, humilier la population ainsi. Ce sont des conseillers généraux qui vont devoir gérer le territoire pendant trois ans ? Comment la population peut accepter cela ? Comment on peut humilier à ce point, rabaisser à ce point la population mahoraise ?
Youssouf Bouchourani, UMP
On s’attendait à connaitre le nom du président – je n’ai pas tout bien saisi -, mais à ce qu’il paraît certains élus ne se seraient pas présentés à l’assemblée, par conséquent il n’y avait pas suffisamment de monde pour voter. Il y avait 11 conseillers, ils devaient être 13, le vote est reporté.
Maoulicharia Ridjali, enseignant Labattoir 4
J’ai laissé ma maison vide pour venir connaître le nom du nouveau président et voilà, une fois ici j’apprends de la bouche du président sortant que les votes sont reportés. Tous les Mahorais sont extrêmement déçus, voire dégoutés. Certains sont venus de très loin, des quatre coins de l’île. Il y a beaucoup de tension ici, les gens sont en colère, sans compter sans doute tous ceux qui sont devant leur télé.
Une mama de Passamainty
Je me suis déplacée exprès pour le maoulida shengué, mais j’attends de savoir ce qui se passe. Je n’aimerais pas être venue jusqu’ici et pas voir de fête, ça serait vraiment dommage et ça donnerait une très mauvaise image de Mayotte. Laissez-nous quand même faire la fête !
Hamide Attoumane, Kani-Kéli
Moi, ce que je veux, c’est la départementalisation de Mayotte. Dites-nous quand nous devons revenir pour la fête et je reviens, c’est tout ce qui compte pour moi.
Une mama de Bandrélé
Ce qui se passe aujourd’hui c’est simple. Celui qui a déjà bien mangé ne veut pas donner l’opportunité aux autres de manger aussi… Quand le combat de Mayotte a commencé, je n’étais même pas encore mariée. Je voyais ma mère souffrir, ma famille toute entière. Nous nous sommes battus pour nos enfants et aujourd’hui que c’est à eux d’en profiter, certains le leur interdisent. Les élus seuls sont responsables de cet état. En particulier un élu qui achète les votes au lieu de laisser s’exprimer la démocratie.
Lima Wild
Ces élus ont des raisons d’agir ainsi. Mais on les a élus, on a considéré qu’ils étaient responsables, alors il faudrait qu’ils prennent leurs responsabilités. Pour la première journée de la départementalisation, ils ont brillé par leurs gestes. Cette journée symbolique restera dans les annales. Vu ce qui s’est passé aujourd’hui, ça promet pour l’avenir !
Haladi Toihibou, Acoua
Personne ne s’attendait à ça, c’est plus une tristesse qu’une fête. Les leaders politiques ont gâché la fête. Ils essayent de faire de la politique, mais ce n’est pas encore ça, il devrait revoir leur méthode.
Méla Mahamda, Tsingoni
Les choses auraient du bien se passer aujourd’hui, au final vous voyez… Aujourd’hui, les élus se disputent entre eux, et c’est encore une fois nous, le petit peuple, qui payons les pots cassés. Il fut un temps où ils se sont embrouillés entre eux en France métropolitaine, aujourd’hui ça se passe ici. Nous ne pouvons qu’être inquiets. Sachez les élus que la voix que vous représentez est la voix du peuple. C’est nous, les citoyens, qui vous ont mis à vos places. C’est notre voix que vous devez faire entendre et non la vôtre. C’est nous qui décidons de votre sort. Nous attendons dans trois ans et nous ne réélirons aucun d’entre vous.
Wahab Manroufou, Kani-Kéli
Je suis abattu car ce département était attendu depuis si longtemps, presque 50 ans. Certains de nos élus ne sont pas allés jusqu’au bout du souhait des Mahorais, c’est triste. Une deuxième chose m’attriste, c’est ce qui s’est passé après. Ceux qui se sont présentés ont procédé à un vote symbolique. Ils ont pris le benjamin de l’assemblée pour le nommer président du conseil général. Je sais que Zaïdani est un jeune bien diplômé, mais je crains qu’il ne soit rien d’autre qu’une marionnette de Giraud. Ce n’est pas sérieux tout ça.
Anrfati, Koungou
Les choses se sont très mal passées. Nous ne pouvons qu’être déçus. Les élus qui ne sont pas venus auraient dû respecter la population et venir quand même, pour une bonne ou une mauvaise chose, c’est ainsi, ils auraient dû venir, c’est tout. C’est un département gâché ! Mais malgré tout, pour la prochaine fête je serai au rendez-vous.
Ousseni Moina
Peu importe ce qui s’est passé aujourd’hui, je ne peux qu’être heureuse. Auparavant, nos parents nous confiaient les enfants à garder pendant qu’eux allaient lutter pour ce combat de Mayotte française, tout ça pour un avenir meilleur. Même si je suis un peu inquiète parce que je ne comprends pas tout sur ce qui s’est passé aujourd’hui, je ne peux qu’être heureuse d’avoir vu la départementalisation. Pour le reste, nous continuons à prier Dieu pour que la paix et le calme reviennent et que toute l’île puisse savourer comme il se doit la départementalisation.






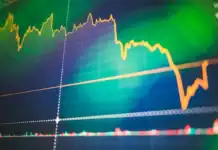



































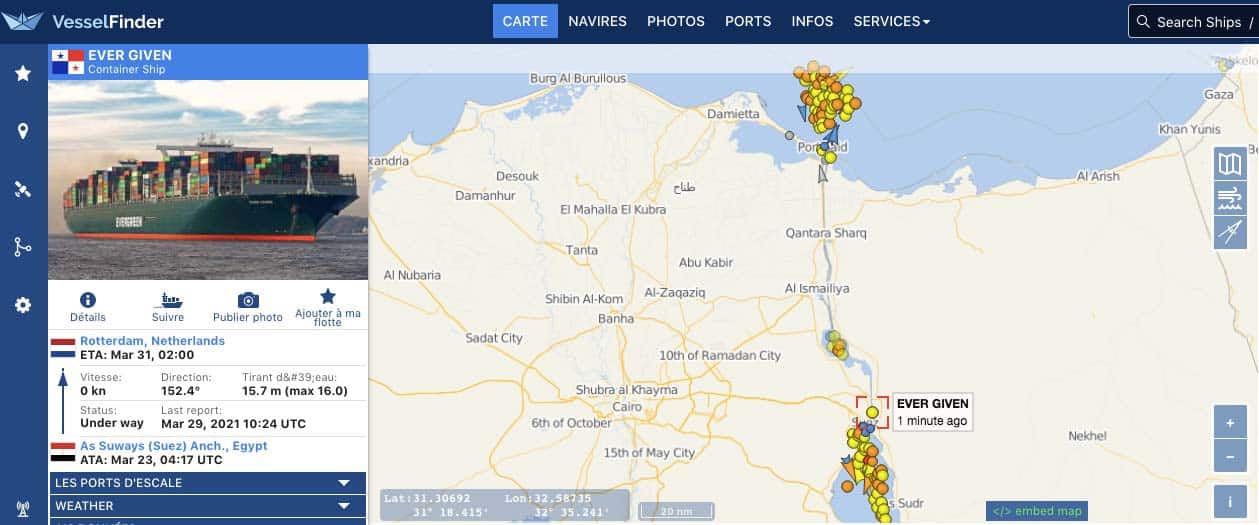


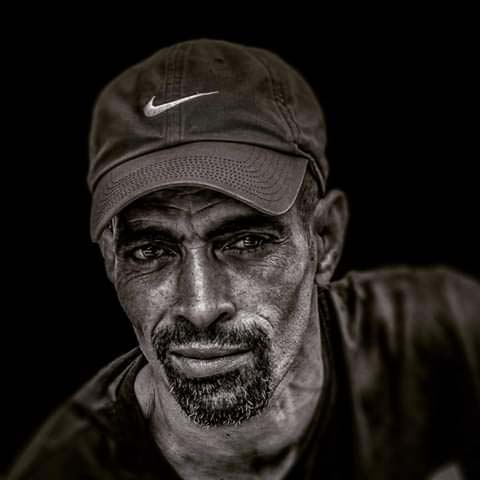

















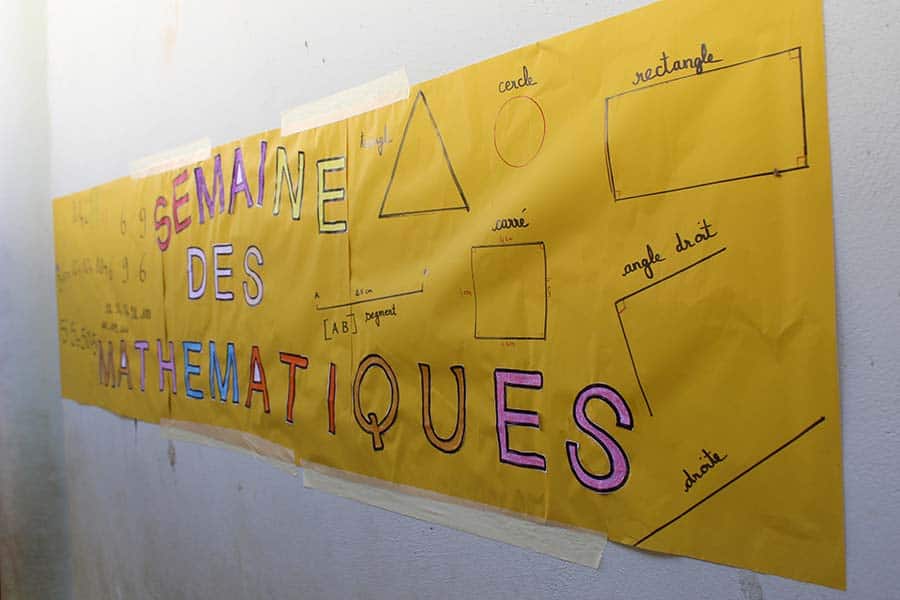




 “Nous souhaitons faire cette grosse opération, car nous sentons une demande pour ouvrir les centres le samedi, pour les gens qui ne peuvent pas se rendre disponibles la semaine”, explique Dominique Voynet, la directrice de l’agence régionale de santé (ARS), qui organisait une conférence de presse ce jeudi. “Nous allons proposer cela pour les plus de 40 ans voire toute personne se présentant et qui a plus de 18 ans”, précise-t-elle. À noter que pour les candidats ayant déjà contracté le coronavirus, un délai de trois mois est préconisé avant l’injection, et une seule piqûre suffit. Par ailleurs, s’il est demandé pour des questions pratiques de se présenter muni de sa carte vitale, “la vaccination n’est en aucun cas réservée aux assurés”. “L’immunité collective ne dépend pas de si la personne a des papiers ou non”, insiste l’ancienne ministre.
“Nous souhaitons faire cette grosse opération, car nous sentons une demande pour ouvrir les centres le samedi, pour les gens qui ne peuvent pas se rendre disponibles la semaine”, explique Dominique Voynet, la directrice de l’agence régionale de santé (ARS), qui organisait une conférence de presse ce jeudi. “Nous allons proposer cela pour les plus de 40 ans voire toute personne se présentant et qui a plus de 18 ans”, précise-t-elle. À noter que pour les candidats ayant déjà contracté le coronavirus, un délai de trois mois est préconisé avant l’injection, et une seule piqûre suffit. Par ailleurs, s’il est demandé pour des questions pratiques de se présenter muni de sa carte vitale, “la vaccination n’est en aucun cas réservée aux assurés”. “L’immunité collective ne dépend pas de si la personne a des papiers ou non”, insiste l’ancienne ministre. Or l’enjeu de la vaccination reste de taille à Mayotte, alors que le ramadan approche et que La Réunion connaît une nouvelle flambée épidémique. L’ARS envisage de rapatrier certains patients mahorais, pour libérer des lits sur l’île Bourbon. Un geste de solidarité, alors que de notre côté de l’océan Indien, les remous de la seconde vague continuent à s’estomper. Le taux d’incidence est repassé sous le seuil d’alerte, avec 94,8 cas pour 100.000 habitants, de même que le taux de positivité des tests, avec 7,5%, ce qui confirme cette tendance épidémique favorable (sans cet indicateur, l’analyse pourrait être biaisée, car la baisse du taux d’incidence pourrait aussi simplement s’expliquer par la baisse du nombre de tests effectués). La crise passée, l’ARS va par ailleurs lancer une étude de séroprévalence pour déterminer la progression de l’immunité collective à Mayotte.
Or l’enjeu de la vaccination reste de taille à Mayotte, alors que le ramadan approche et que La Réunion connaît une nouvelle flambée épidémique. L’ARS envisage de rapatrier certains patients mahorais, pour libérer des lits sur l’île Bourbon. Un geste de solidarité, alors que de notre côté de l’océan Indien, les remous de la seconde vague continuent à s’estomper. Le taux d’incidence est repassé sous le seuil d’alerte, avec 94,8 cas pour 100.000 habitants, de même que le taux de positivité des tests, avec 7,5%, ce qui confirme cette tendance épidémique favorable (sans cet indicateur, l’analyse pourrait être biaisée, car la baisse du taux d’incidence pourrait aussi simplement s’expliquer par la baisse du nombre de tests effectués). La crise passée, l’ARS va par ailleurs lancer une étude de séroprévalence pour déterminer la progression de l’immunité collective à Mayotte.










 La santé, un sujet encore épineux à Mayotte. Nombreux sont ceux qui pointent du doigt le fonctionnement du centre hospitalier de Mayotte, dénoncent le désert médical de l’île ou encore ré-clament la formation de médecins mahorais. Le comité de réflexion du mouvement Le Temps d’Agir s’est penché sur toutes ces questions et 50 propositions découlent du travail fait pendant des mois. Le membres du parti ont fait une série de consultations auprès des organisations syndicales, des professionnels de santé qui travaillent au CHM et dans le privé. Ils ont également interrogé des patients et d’autres qui ont pu bénéficier de l’évacuation sanitaire. “De façon unanime, la population dit que le système actuel doit évoluer. L’essentiel des personnes pensent que nous devons avoir un nouvel hôpital mais aussi un centre hospitalier universitaire”, annonce Soula Saïd Souffou, président du mouvement.
La santé, un sujet encore épineux à Mayotte. Nombreux sont ceux qui pointent du doigt le fonctionnement du centre hospitalier de Mayotte, dénoncent le désert médical de l’île ou encore ré-clament la formation de médecins mahorais. Le comité de réflexion du mouvement Le Temps d’Agir s’est penché sur toutes ces questions et 50 propositions découlent du travail fait pendant des mois. Le membres du parti ont fait une série de consultations auprès des organisations syndicales, des professionnels de santé qui travaillent au CHM et dans le privé. Ils ont également interrogé des patients et d’autres qui ont pu bénéficier de l’évacuation sanitaire. “De façon unanime, la population dit que le système actuel doit évoluer. L’essentiel des personnes pensent que nous devons avoir un nouvel hôpital mais aussi un centre hospitalier universitaire”, annonce Soula Saïd Souffou, président du mouvement.