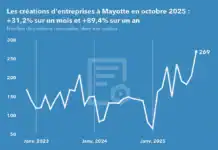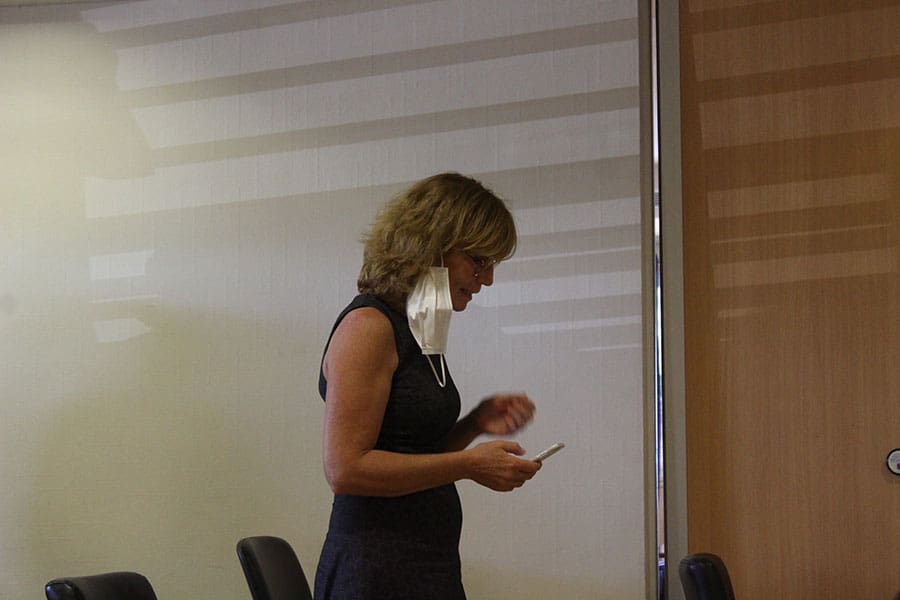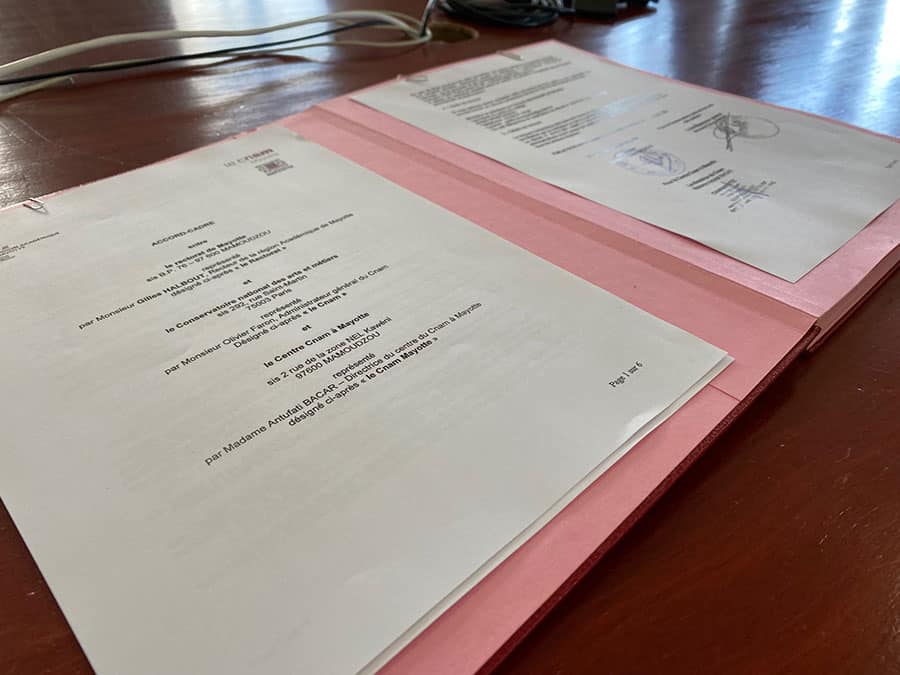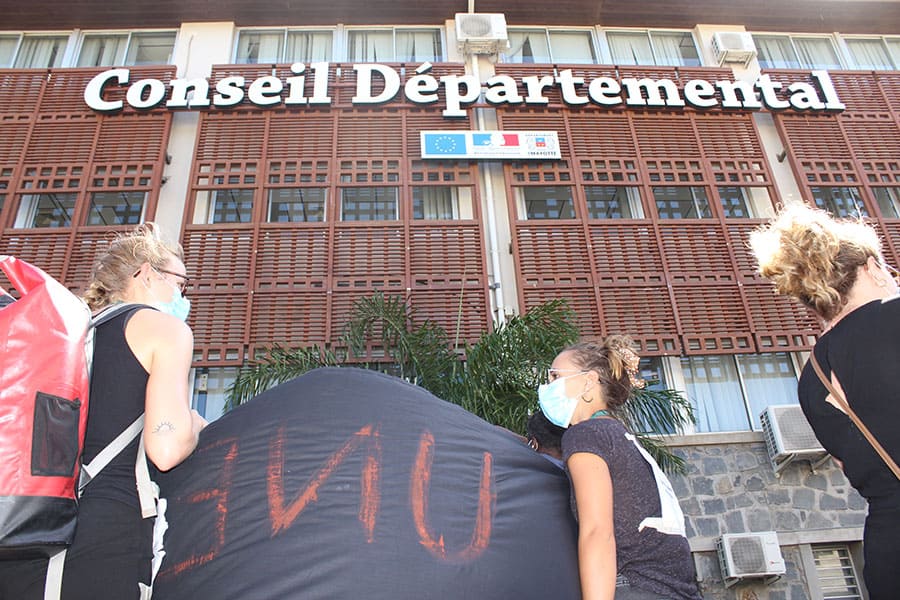La Fédération mahoraise des associations environnementales (FMAE) veut alerter sur les risques que fait courir le chantier du village relais de Tsoundzou II, censé accueillir les familles en situation de grande précarité, construit sur l’arrière-mangrove. Alors que ce projet est piloté par l’État, le trésorier de la fédération, Zaman Soilihi, veut interpeller les pouvoirs publics sur leur rôle dans la protection de l’environnement fragile de Mayotte. Et tire la sonnette d’alarme.
Flash Infos : Vous avez organisé une action ce vendredi, à côté du site du village relais de Tsoundzou II. Pourquoi ?
Zaman Soilihi : Ce n’était pas tant une action, mais j’ai souhaité amener les journalistes à côté du village relais, à gauche, quand on va vers vers le pont, car là-bas, il s’agit d’une zone humide. Or sur ce terrain, il y a un particulier qui est en train de remblayer la zone. Nous nous sommes rendus sur place pour constater les tractopelles et l’ensevelissement. Puis je les ai emmenés voir le village relais pour faire le parallèle. Pour nous, il n’y a pas de différence entre ce propriétaire privé qui est en train de dégrader la zone humide, et l’État, qui a saccagé l’arrière-mangrove pour construire ce village relais…
FI : Justement, quels sont les problèmes que posent ce chantier selon vous ?
Z. S. : Nous, nous ne sommes pas contre le village relais en soi. Ce que nous déplorons, d’une façon générale d’ailleurs sur l’île, c’est que les collectivités et l’État sont les premiers à ne pas respecter l’environnement. Le village relais en est le parfait exemple ! Le site se trouve sur l’arrière-mangrove, or il s’agit d’un écosystème aussi important que la mangrove elle-même. Quand on détruit l’arrière-mangrove, c’est la mangrove qui va finir par dépérir… Et si on détruit une zone humide, cela aura un impact sur la mangrove, et bien sûr sur le lagon en général. Bref, on ne peut pas faire n’importe quoi sur cette île, sans que cela ait des impacts et ces impacts-là doivent être mesurés. Le premier garant de cette réglementation c’est l’État, et en l’occurrence, ce sont eux qui financent ce village relais. L’on attendrait donc à juste titre qu’ils soient particulièrement tatillons sur le respect de la réglementation.
FI : Un avis de l’autorité environnementale a conclu que le projet de construction du village relais de Tsoundzou II était susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et sur la santé humaine au sens de l’annexe III de la directive susvisée n° 2014/52/UE du 16 avril 2014. Le projet doit donc être soumis à une évaluation environnementale. Quelles sont les suites de cette décision ?
Z. S. : Je n’en connais pas les suites. Mais d’une manière générale, la délinquance environnementale sur cette île n’est pas encore prise en considération au niveau de la justice. Tout du moins la justice ne s’en saisit pas à bras le corps. Nous comprenons que les procureurs aient bien d’autres sujets à traiter, mais à la FMAE, nous jugeons que cette délinquance environnementale doit être punie comme le code de l’environnement et le code pénal le suggèrent. On ne devrait rien laisser passer… Or, il y a déjà eu des précédents, à Tsararano où on a construit une station d’épuration sur la zone humide, ou encore un marché couvert, et l’État a laissé faire.
Par ailleurs, les études qui sont faites en termes d’impact environnemental sont souvent négligées et les bureaux d’études ne maîtrisent pas toujours bien le sujet en considérant qu’il n’y a pas d’espèce endémique à valeur patrimoniale, par exemple. Mais prenez l’arrière-mangrove justement : c’est un habitat pour les oiseaux, pour les crabes. C’est une zone où espèces animales et végétales vivent, où les oiseaux viennent se nicher. Non seulement on détruit cet habitat avec le village relais, mais quand il sera occupé, avec la lumière, les activités humaines, cela va faire fuir bon nombre d’animaux qui vivent là. L’argument qu’on nous oppose, c’est de dire qu’il y a déjà des habitations dans la zone. À qui la faute ? Ce sont la mairie de Mamoudzou et l’État qui ont laissé faire… et qui maintenant s’engouffrent dans la brèche.
FI : Au niveau de la FMAE, quelles actions prévoyez-vous et quelle réponse espérez-vous obtenir des autorités ?
Z. S. : Même si nous ne désespérons pas, tout cela est très compliqué… Le chantier va avancer. L’État est arrivé avec ses grosses bottes, et piétine tout, en tout cas, c’est comme ça que nous le ressentons. Même si nous faisons un recours devant la justice, je crains que le chantier ne soit fini avant que l’on commence à en voir les fruits… Tout ce que nous espérons, ce sont donc au moins des mesures compensatoires, que l’État compense ces dégradations en mettant en place des mesures qui protègent mieux l’environnement sur l’île. S’il faut vraiment porter plainte, nous le ferons, même si nous n’y croyons pas beaucoup. Nous allons donc aussi poursuivre nos campagnes de sensibilisation, alerter au niveau des médias, écrire au préfet, car au niveau de la justice en ce moment, force est de constater que nous n’avons pas beaucoup d’écho par rapport aux problèmes que nous soulevons. Nous avançons à très petits pas, et c’est très insuffisant par rapport aux défis que nous avons à relever sur cette île. Depuis 1842 jusqu’à maintenant, en un siècle pour faire simple, nous avons perdu la quasi-totalité de nos forêts. Nous avons forcément perdu des espèces endémiques que l’on ne connaissait même pas ! Dans la zone océan Indien mais à Mayotte encore davantage, nous sommes sur un point chaud, avec des risques d’extinction ou de danger imminent pour les différentes espèces. Ici plus qu’ailleurs, je pense que les enjeux anthropiques sont énormes, avec les flux migratoires et la croissance démographique, nos écosystèmes naturels sont soumis à des pressions considérables.Très rapidement, nous aurons tout dégradé, donc il est urgent d’aller plus vite dans les sanctions, que nos pouvoirs publics soient plus réactifs. Malheureusement, à la vitesse à laquelle nous allons pour l’instant, la vitesse tortue en réalité, dans cinquante ans nous aurons tout saccagé…