C’est un ras-le-bol qui a poussé les demandeurs d’asile africains à manifester ce lundi 20 juillet devant la mairie de Mamoudzou. Ils réclament de meilleures conditions de vie et une meilleure prise en charge de la part des associations et de l’État, mais les moyens mis à disposition à Mayotte ne sont pas suffisants.
Pancartes à la mains, visages fermés, les demandeurs d’asile africains étaient réunis devant la mairie de Mamoudzou lundi dernier. Leurs revendications se résument en une seule phrase “On veut que l’État nous prenne en charge comme tous les demandeurs d’asile qui vivent en France”, déclare Bakidi Massamba, leur porte-parole. Plus concrètement, ils souhaitent que les autorités mettent à leur disposition des logements. Une très grande partie d’entre eux vivent dans des habitats précaires. Ils réclament également un local afin de pouvoir vendre leurs marchandises “légalement”. Enfin, ils veulent que leurs enfants soient scolarisés. “Cela fait trois ans qu’on est à Mayotte et mon fils n’est jamais allé à l’école. J’ai fait tout mon possible pour l’inscrire à la mairie mais c’est impossible parce qu’on me demande une facture à mon nom. Comment puis-je trouver cela ?”, se demande Nana Aloko. La scolarisation est l’unique domaine où la mairie de Mamoudzou a pu apporter une réponse, même si elle reste évasive. “Nous sommes à l’écoute, nous allons essayer de travailler avec eux dans la mesure du possible. Tous les enfants doivent être scolarisés et nous allons travailler pour que tous les enfants de la commune de Mamoudzou puissent aller à l’école”, déclare Malidi Mlimi, conseiller délégué qui a reçu les demandeurs d’asile lundi. Les questions de logements, de régularisation administrative ou d’aides financières ne font pas partie des compétences du maire.

Un eldorado qui n’existe pas à Mayotte
En théorie, les demandeurs d’asile se trouvant sur le sol français sont protégés jusqu’à la fin de leurs démarches administratives. Ils sont en premier lieu hébergés dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile (Cada). Cependant, à Mayotte, la réalité est toute autre. “Les solutions d’hébergements sont quasi inexistantes, voire nulles. Il n’y a pas de Cada, les demandeurs d’asile se retrouvent donc à la rue. Certains arrivent à se loger dans des habitats précaires avec toutes les difficultés qui s’en suivent”, indique Solène Dia, chargée de projet régional à La Cimade (association qui s’occupe de réfugiés). Le manque de logement n’est pas le seul problème que rencontre les associations. Les demandeurs d’asile sont censés percevoir l’Ada (allocation des demandeurs d’asile) mais là encore, les aides financières sont bien en deçà. Ils reçoivent un forfait de 30 euros par mois pendant 6 mois. “Est-ce qu’en France on peut vivre avec seulement 30 euros par mois, soit 1 euro par jour ?”, s’indigne leur porte-parole. À la fin des 6 mois, ils n’en bénéficient plus et ne sont toujours pas autorisés à travailler. “Normalement, ces personnes devraient avoir une autorisation pour travailler, mais dans la réalité c’est quasi impossible. Donc elles se retrouvent dans des procédures qui peuvent durer 2 ans, voire plus, complètement livrées à elles-mêmes”, dénonce Solène Dia.

À cela s’ajoute le problème de scolarisation qui est un vrai casse-tête pour les associations qui accompagnent les demandeurs d’asile. Selon la chargée de projet régional de La Cimade, certaines mairies de l’île refusent systématiquement l’inscription des enfants dont les parents sont étrangers ou rendent impossible leur scolarisation. “L’Éducation nationale vient de sortir un décret qui liste les pièces que les mairies peuvent exiger des parents. Sauf qu’ici, les mairies ne le respectent pas et continuent à exiger des pièces abusives que les parents ne peuvent avoir.” Toutes ces doléances seront transmises à la préfecture par les demandeurs d’asile africains. Ils seront reçus par le directeur de cabinet de la préfecture de Mayotte mardi prochain. Mais ils ne se font plus d’illusion. Tous ont réalisé que l’eldorado mahorais n’est finalement qu’un mythe.




















































.jpg?1594972748397)
.jpg?1594973078858)
.jpg?1594973107019)





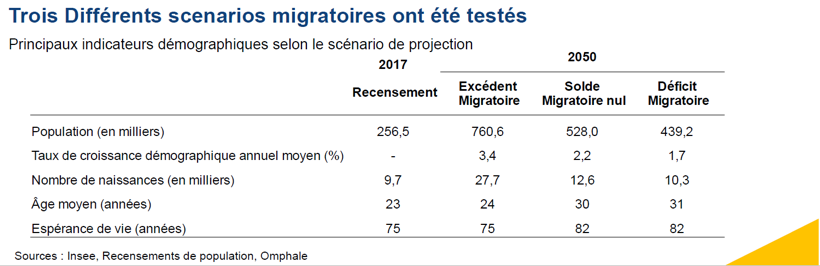





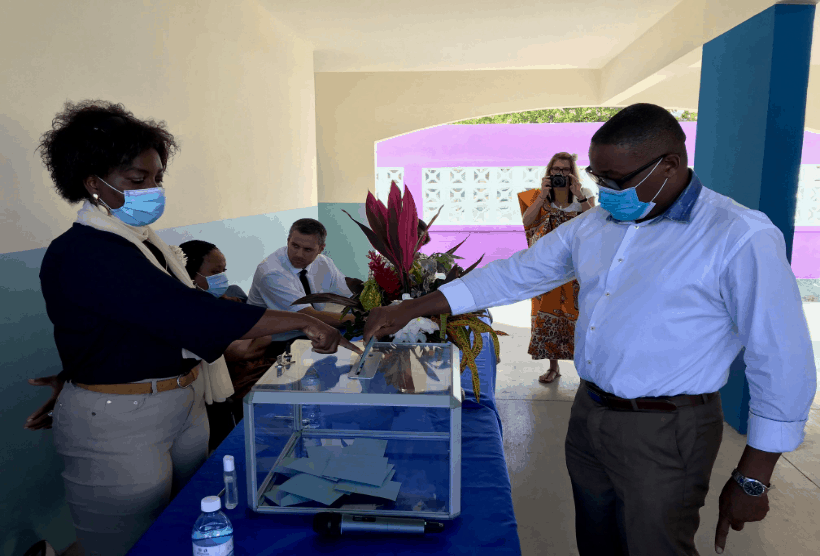

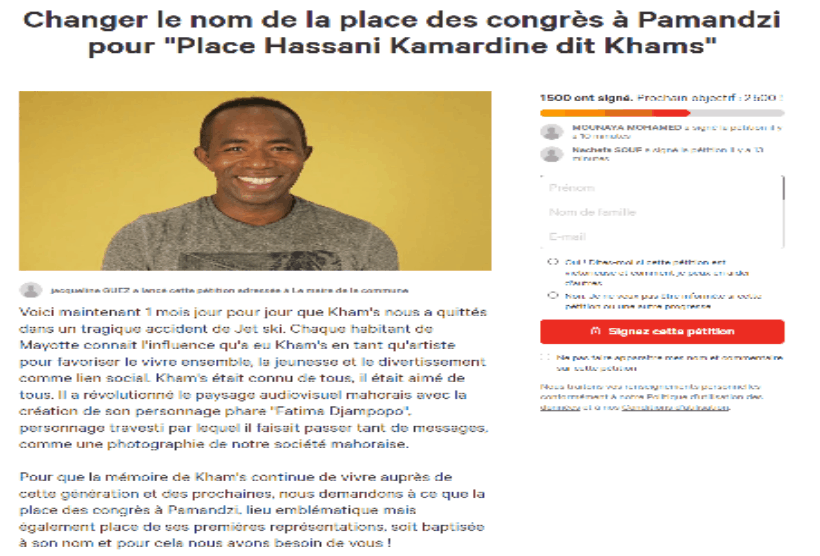

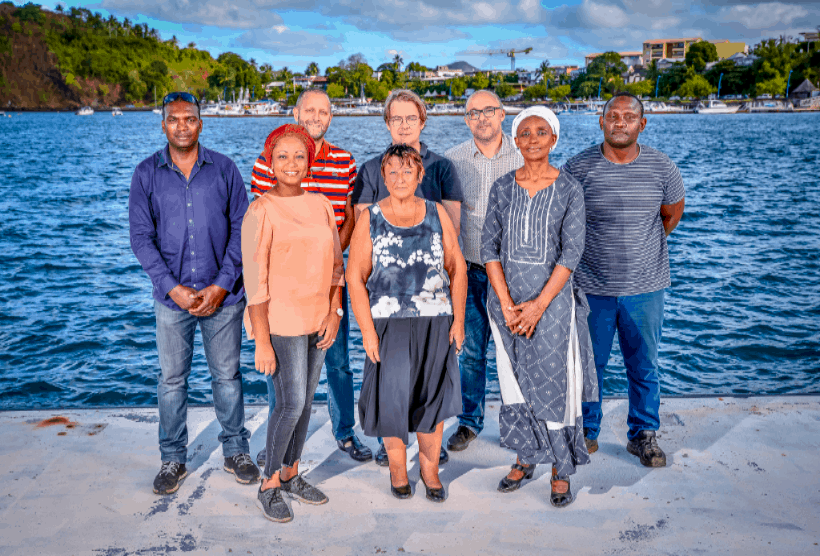






.jpg?1594280567780)



