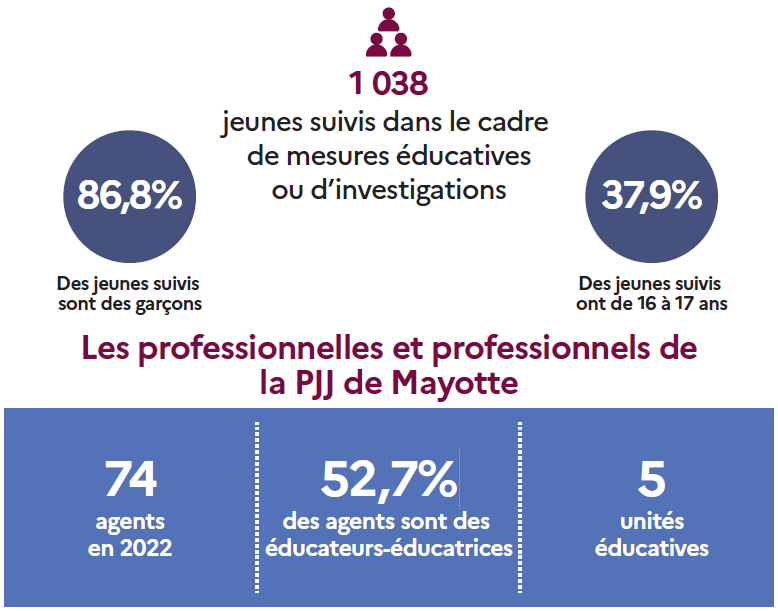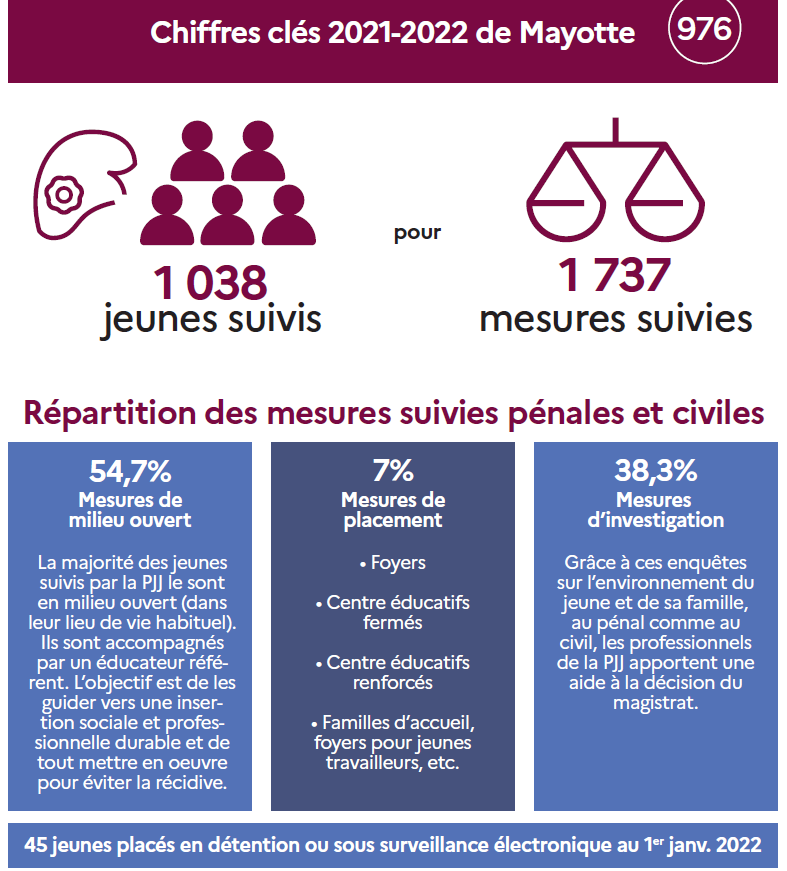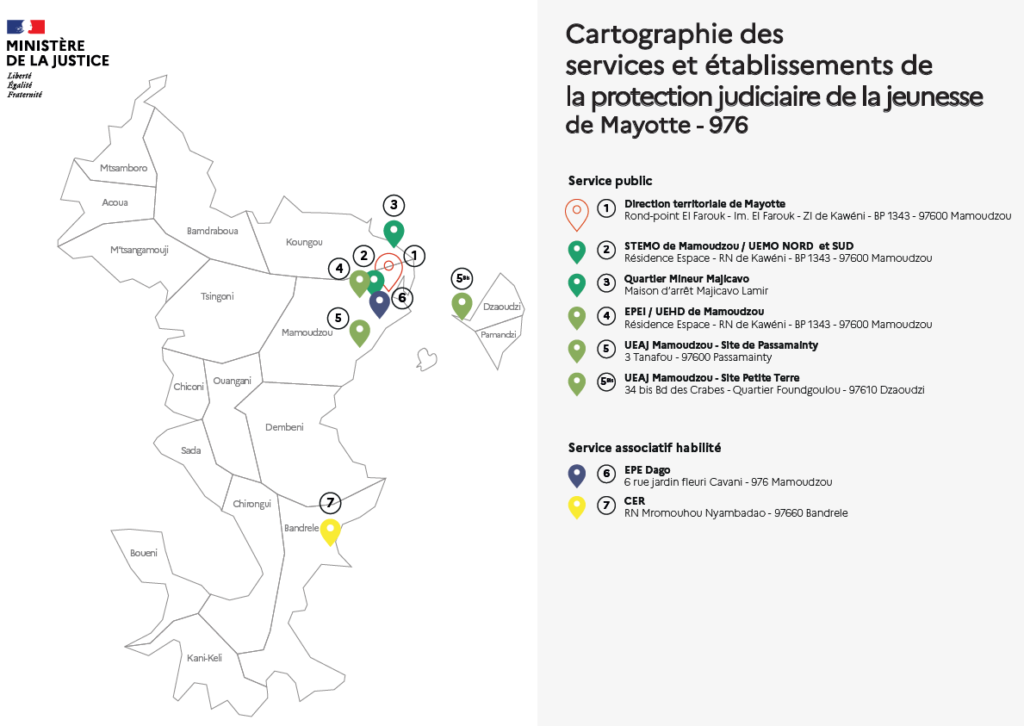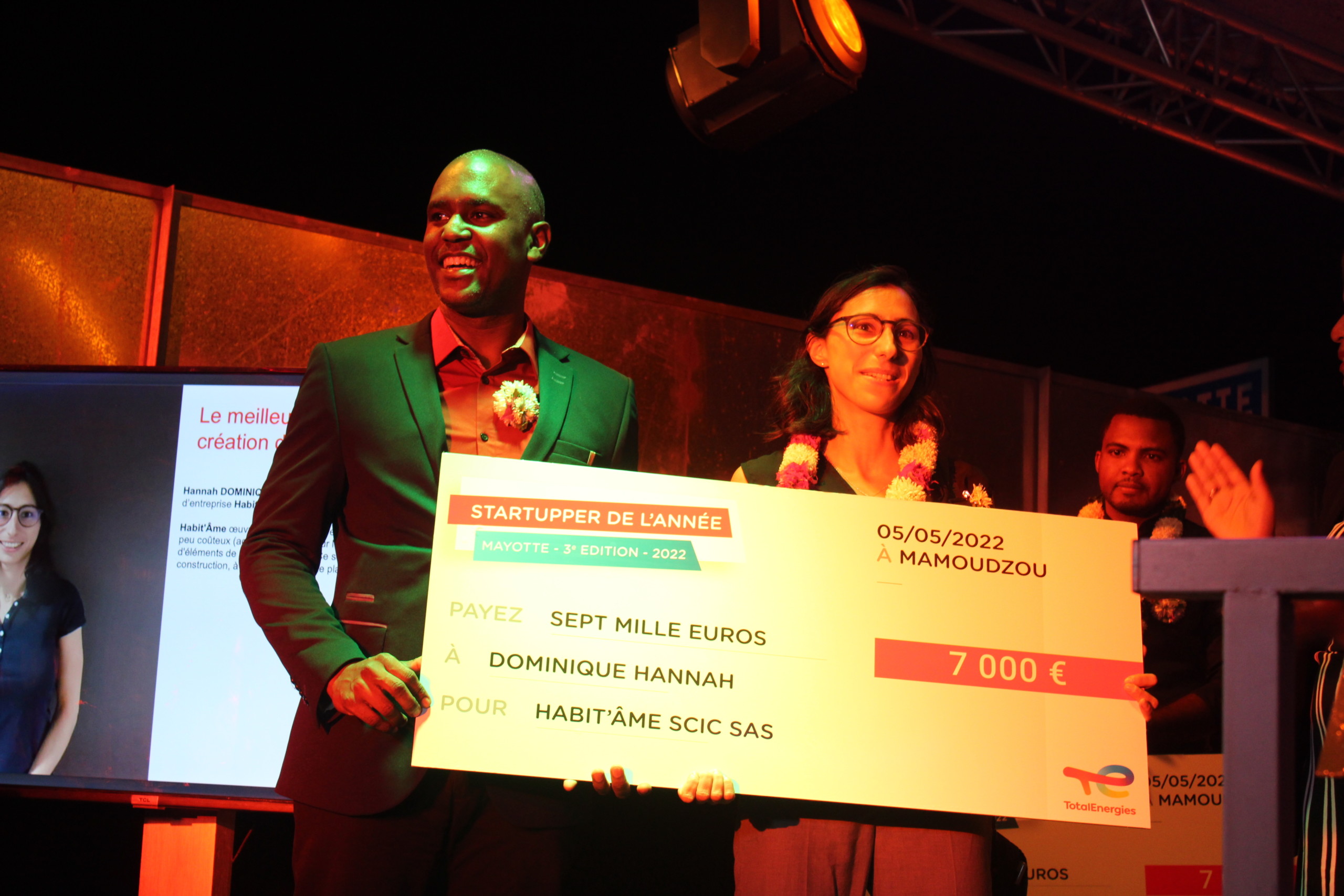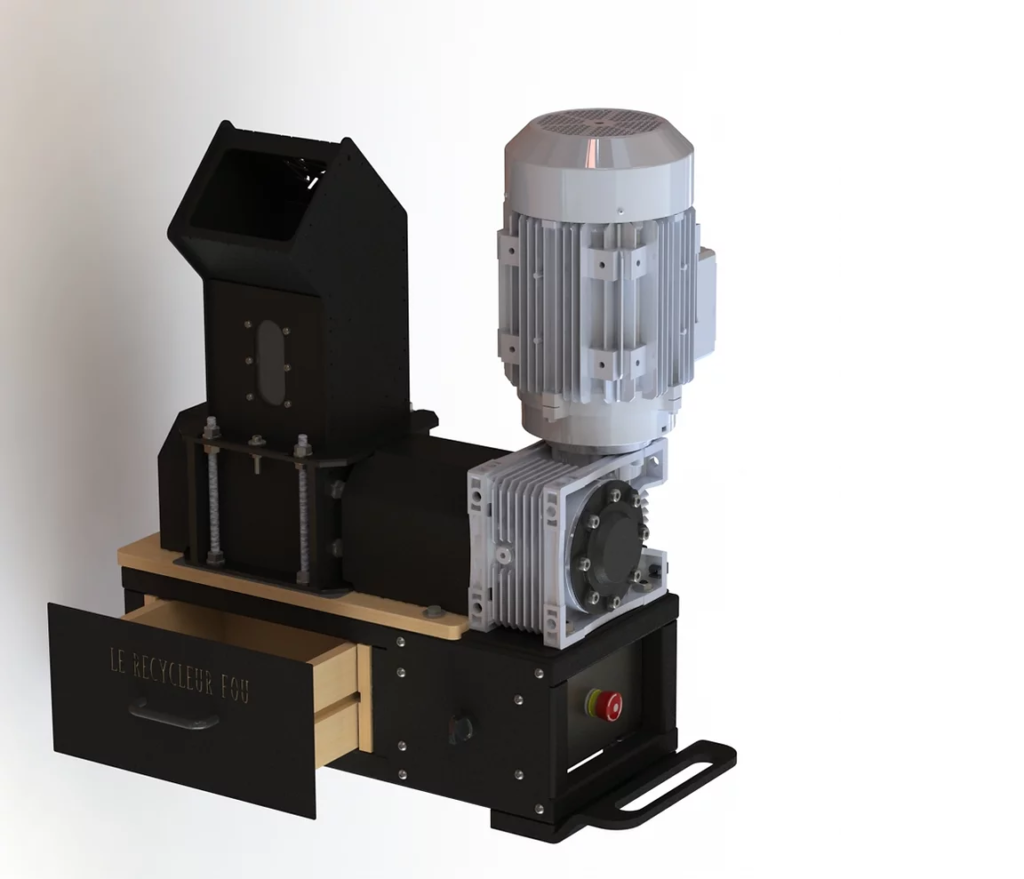La Rando Raid Mayotte fait son grand retour durant cette période estivale avec une nouvelle édition spéciale été. Au programme cette année, une course d’orientation partant de M’tsamoudou jusqu’à la plage de Sazilé et une chasse au trésor géante qui promet de nombreuses surprises. Les participants sont attendus le 7 août pour partir à l’aventure.
Se mettre dans la peau d’un chasseur de trésor, le temps d’une matinée, c’est ce que propose l’association Rando Raid Mayotte. Après le franc succès de la première édition l’année dernière sous le thème « Koh Lanta », les organisateurs reviennent cette année avec une course d’orientation et une chasse au trésor. Les participants sont attendus à 7h à M’tsamoudou pour un départ prévu à 8h. « Nous allons marcher jusqu’à Sazilé. Normalement, on fait ce parcours en vingt minutes, mais comme nous serons nombreux, je pense que l’on mettra une heure », indique Adjimal Badja, le trésorier de l’association Rando Raid Mayotte. En parallèle, dix équipes de cinq personnes participeront à la chasse au trésor. Il n’y a pas de critères spécifiques pour y prendre part, mais il faudra prendre son mal en patience. « Il faut juste savoir qu’il y aura beaucoup de marche. La chasse au trésor nécessite aussi énormément de patience. Il faudra vraiment être attentif, avoir l’oeil, bien observer, chercher et savoir collaborer en équipe », conseille le trésorier. Les chasseurs d’un jour seront choisis par les organisateurs et tous auront une carte. La participation au jeu est totalement gratuite, cependant un barbecue sera organisé à la fin et ceux qui souhaitent y prendre part doivent cotiser dix euros.
Préparer un tel évènement requiert un réel investissement personnel et une certaine organisation pour éviter toute mauvaise surprise. Les membres de l’association Rando Raid Mayotte ont fait du repérage pour définir le parcours. Ils s’assurent également que toutes les personnes présentes soient en sécurité. « Parmi les participants, on a identifié des forces de l’ordre et des soignants qui viendront avec leur matériel pour pouvoir intervenir en cas de besoin », assure l’organisateur. Pour motiver les troupes, plusieurs cadeaux seront mis en jeu, pour une valeur totale de 1.000 euros.
« On ne s’attendait pas à avoir un tel engouement »
La première édition spéciale été de l’année dernière avait fait carton plein avec près de 400 participants. Cette fois-ci, les organisateurs n’en attendent pas moins. Après la diffusion du teaser il y a quelques jours, les membres de l’association constatent que les « les gens sont impatients de partir à l’aventure » avec eux.

Si on leur avait dit que leur concept de Rando raid Mayotte prendrait une telle ampleur, ils n’y auraient pas cru. Tout a commencé il y a il y a un an et demi quand deux amis décident de découvrir l’île en faisant des randonnées. « Quand on s’est lancés, c’était un petit truc, puis on a commencé à inviter nos connaissances, mais on ne s’attendait pas à avoir un tel engouement », déclare Adjimal Badja. Aujourd’hui, ils se sont officiellement structurés comme association, et durant chaque vacance scolaire, ils organisent des randonnées sur tout le territoire, en plus de l’édition spéciale été. « C’est devenu quelque chose que tout le monde attend. Nous avons même des participants qui viennent depuis l’île de La Réunion. » Une fierté pour les membres de l’association Rando Raid Mayotte.
Pour participer à cette édition, vous devez vous inscrire via le lien suivant : https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAa__e2IzbVUMkhFSjFFRDg3RjNBSVBZREhMQzREVUNPVC4u