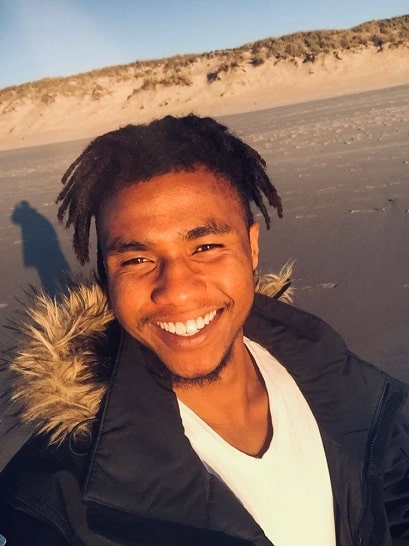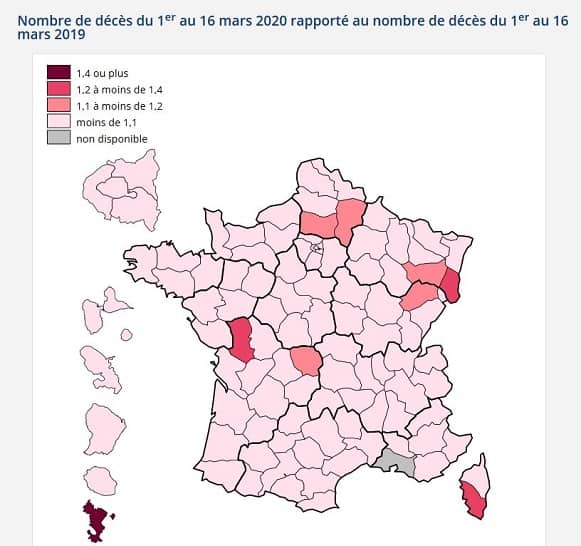Les journées sont chargées pour les autorités. Représentant direct de l’État à Mayotte, le préfet Jean-François Colombet nous répond sur crise du Covid-19. Équipement sanitaire, liaisons aériennes, porte-hélicoptères Mistral, confinés du RSMA et ramadan : le haut fonctionnaire fait le point.
Flash Infos : Un avion de la présidence de la République s’est posé hier matin à Mayotte avec du matériel médical pour le CHM. Dans le détail, de quoi s’agit-il ?
Jean-François Colombet : De masques haute protection. Presque une tonne de masques qui étaient très attendus. C’est extrêmement important, car nous en avions besoin. Ils ont immédiatement été remis à l’agence régionale de santé (ARS). Ce vol n’était pas prévu pour cela il y a quatre semaines, mais lorsque la crise est montée en puissance, nous en avons profité pour remplir ses soutes de ce dont nous avions besoin en urgence absolue. Il n’est d’ailleurs pas exclu qu’il refasse un aller-retour depuis La Réunion [ce matin] pour que l’on charge ses soutes à nouveau afin de ramener une dizaine de tonnes de fret sanitaire : masques, gel, etc.
FI : À l’annonce de l’arrêt des liaisons commerciales, la question de l’approvisionnement et surtout de la rotation des matériels pour le CHM, notamment pour les bombonnes d’oxygène, s’est posée. Un pont aérien est-il au programme ?
J-F. C. : Le sujet de l’oxygène est réglé depuis longtemps puisqu’il est à bord du navire de la Marine nationale qui arrive. Concernant le pont aérien, j’ai eu une visioconférence durant deux heures [avant-hier] avec la ministre des Outre-mer, Annick Girardin. Nous avons sollicité deux allers-retours entre La Réunion et Mayotte par semaine, en Dreamliner, pour à la fois amener du personnel qui nous est indispensable, transporter des évacuations sanitaires dans les meilleures conditions, et ramener 16 tonnes de fret à chaque vol. Cela nous amènerait à un potentiel de 32 tonnes de fret par semaine, sanitaire et hors sanitaire. Cette proposition a été arbitrée [hier après-midi] par le premier ministre lors de la cellule “décision” en centre interministériel de crise (CIC). Nous sommes confiants. D’ici à ce que le contrat d’affrètement soit signé, nous avons un vol militaire qui arrive jeudi avec 4 ou 5 tonnes de matériel sanitaire et des personnels, car cet avion, un Casa, peut embarquer les deux.
FI : À propos de l’arrivée prochaine du Mistral à La Réunion, sa mission reste assez floue. Quelle sera-t-elle ? Et Mayotte en bénéficiera-t-elle également ?
J-F. C. : Le président de la République a dit qu’il y aurait deux porte-hélicoptères amphibies de déployés : un entre la Guadeloupe et la Martinique, et un dans l’océan Indien pour desservir Mayotte et La Réunion. Ce navire est polyvalent et peut remplir la mission qu’on lui affecte en fonction de l’armement qu’on lui donne. Aujourd’hui, il est trop tôt pour dire quelles missions il va assurer ici, mais ce qui intéressant, c’est qu’il peut tout à fait transférer des personnels et des patients sous réanimation, par exemple, ou servir à faire venir des choses volumineuses et lourdes, car sa capacité d’emport de fret est phénoménale. Son potentiel est très polyvalent. Il faut donc se réjouir de l’arrivée du Mistral sur zone.
Alors est-ce qu’il sera à La Réunion ou à Mayotte ? Je dirais que ce n’est pas un sujet : il ira là où on aura besoin de lui. Ce bateau est capable de rallier les deux îles en deux jours, il est extrêmement véloce. De quoi nous rendre de grands services et nous être tout à fait utile si nous entrons dans une
phase épidémique. Les Martiniquais et les Guadeloupéens ne sont pas dans ce débat de savoir où sera le Dixmude : le sujet est qu’il soit présent dans la zone, c’est ce qui est important.
FI : Les confinés en quatorzaine au RSMA se sont plaints de leur sort. Quelle est votre réponse ?
J-F. C. : Déjà, je comprends que les gens qui sont obligés d’être confinés au RSMA éprouvent soit de la colère, soit des difficultés à y rester. C’est humain. En même temps, je ne peux pas accepter toutes les critiques. On me dit que les gens qui reviennent de cette région de Madagascar sont sains parce que cette zone ne connaitrait pas la circulation du virus. Mais il est difficile de l’établir objectivement, je n’ai pas d’autorité sanitaire capable de me l’assurer. Sont-ils restés dans cette région ? Ont-ils fréquenté des Malgaches qui, eux-mêmes, étaient contaminés en venant d’autres régions ? Je ne le sais pas.
Ce que je sais en revanche, c’est qu’on ne peut pas me dire à la fois que ces gens ne présentent pas de danger sanitaire et dans le même temps invoquer l’explosion d’une bombe virale. Cela n’est pas cohérent. Cette mesure de confinement contrôlé que j’ai mise en œuvre sur instruction écrite du gouvernement, à La Réunion les élus – et quels que soient les partis politiques – se sont tous mobilisés pour l’obtenir. Aujourd’hui, 600 personnes y arrivent chaque semaine et vont être confinées pendant 14 jours dans des gymnases, etc. : là où ils seront sous le contrôle des autorités.
Il y a donc une approche de ce sujet qui me fascine, bien que je sache d’où vient le trouble. On sait bien qu’une personne, par ailleurs très paisible au quotidien me dit-on, a des relations dans la presse et dans la politique. Il crée le trouble et menace de porter plainte contre le préfet. Moi, j’ai pris cette décision et je l’assume complètement, car je l’ai fait pour protéger les Mahorais. Je suis convaincu que, s’il y avait dans ce groupe des gens contaminés et qu’on les lâche dans la nature, nous prendrions un risque inconsidéré. C’est ce qu’on appelle le principe de précaution : on n’est pas certain que le risque puisse arriver, mais comme cela peut être le cas et créer des dégâts considérables, on prend la précaution de garder les gens 14 jours. Ce n’est pas la mer à boire.
FI : Un des reproches formulés est le fait de partager des chambres à plusieurs alors que distanciation sociale est le mot d’ordre…
J-F. C. : Oui, et il y a même un élu qui a soutenu – avant de vérifier – qu’ils étaient 15 par chambre. Elles font 42 mètres carrés ces chambres, et ils sont quatre dedans. Dans la plupart des bangas où vivent aussi des Mahorais, des gens sont beaucoup plus condensés qu’ils ne le sont au RSMA. C’est inacceptable de dire ça. Les choses ont été faites sérieusement par des militaires. Ces confinés n’ont pas été confiés à n’importe qui, mais au colonel Jardin, dont chacun sait qu’il est parfaitement à la hauteur de cette affaire. Les familles ont été regroupées dans leur propre chambre et les gens isolés l’on été à quatre par chambre. S’ils veulent mettre en œuvre les gestes barrières et se protéger, ils peuvent le faire sans aucun problème. Cela relève de leur responsabilité personnelle d’appliquer les directives que nous appliquons ici depuis déjà trois semaines, et qu’ils n’appliquaient sans doute pas à Madagascar pour certains d’entre eux, bien que leur statut aurait dû les conduire à être attentif à la situation.
Je suis convaincu en mon âme et conscience d’avoir pris la bonne décision, tout simplement parce que c’est celle dont j’ai reçu instruction par le gouvernement et que c’est mon métier de les faire appliquer. Par ailleurs – et alors que nous n’avions que 12h pour l’organiser –, je pense l’avoir fait dans des conditions optimales et avec une assistance sanitaire permanente. Si quelqu’un venait à être en danger, l’ARS me l’indiquerait immédiatement et je ne mettrai pas 1h pour décider d’extraire la personne. Ce que nous avons d’ailleurs fait pour une dame diabétique dès le samedi soir.
Je maintiendrai donc ma décision, car je suis convaincu que c’est en faisant cela que je protège les Mahorais. J’exerce mes responsabilités, je les prends et je les assume. Si l’individu en question considère qu’il est en danger, il peut faire un référé liberté : cela sera jugé dans les 8 heures maximum et si le juge le décide, il le libèrera.
Enfin, pour ceux qui se plaindraient du confort, je rappelle qu’il y a 600 jeunes Mahorais qui passent, chaque année, plusieurs mois dans ces locaux. Ils en retiennent les valeurs qu’ils ont retenues et les métiers qu’ils ont appris, et non de l’état des chambres. Donc exprimons un tout petit peu de pudeur, prenons notre mal en patience et soyons raisonnables en ne mettant pas en danger la communauté mahoraise. Mais de manière générale, l’esprit du groupe n’est pas celui qui est relaté ici ou là.
FI : Il se pourrait que le confinement soit de nouveau prolongé à l’issue de celui en cours. Or, une question commence à se poser, celle du ramadan. Avez-vous commencé à étudier la question avec les autorités religieuses et donnerez-vous des consignes strictes pour cette période ?
J-F. C. : Le ramadan est un sujet majeur pour moi. Cette période est extrêmement importante pour ceux qui pratiquent le culte que nous retrouvons majoritairement à Mayotte. Or, nous avons une équation à résoudre : une pratique du ramadan égale à une non-prolifération du Covid-19. Pour y répondre, je vais constituer dès [aujourd’hui] un groupe que je souhaite composé uniquement de Mahorais, de pratiquants hommes et femmes. Je compte faire appel à des responsables comme les parlementaires, quelques maires, le grand cadi, le président de l’Union des familles de Mayotte, etc. En somme, des personnes qui pourront réfléchir au sujet et formuler dans une semaine des propositions pour répondre à cette question : comment conjuguer la fête du ramadan et la protection individuelle de chacun contre le virus ? Une semaine pour avoir des solutions cohérentes, bien adaptées au territoire, bien adaptées à la pratique locale et qui permettent tout à la fois de pratiquer le culte et de protéger la communauté.
Le sujet est sensible, il faut donc naturellement qu’il soit porté par ceux qui le connaissent réellement et qui connaissent ce qu’il implique dans les familles. Je compte beaucoup sur ce groupe pour avoir des pistes intéressantes à mettre en œuvre et pour convaincre les Mahorais de les emprunter.