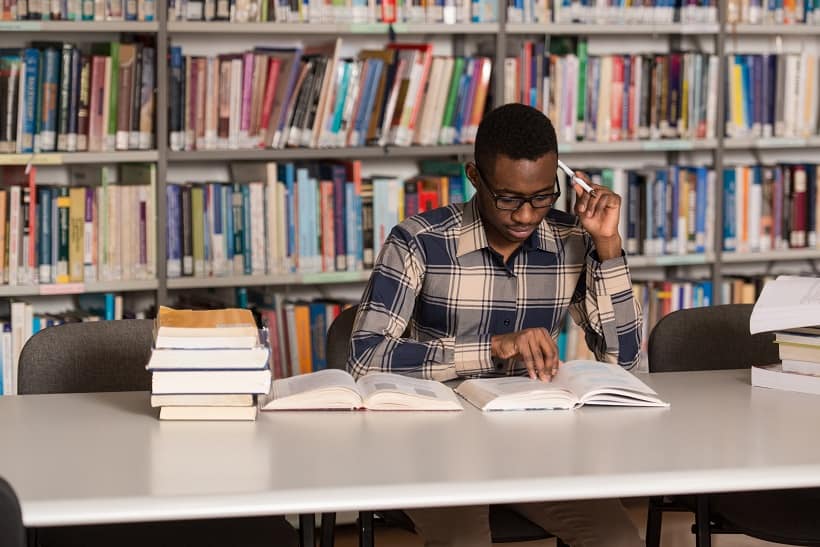La décision du tribunal administratif concernant la demande en référé déposé par le Collectif des citoyens de Mayotte et du Comité de défense des intérêts de Mayotte n’aura pas pris trop de temps au juge administratif. En l’absence d’éléments prouvant l’intérêt à agir des demandeurs, le tribunal a rejeté la requête sans étudier les demandes. À La Réunion cependant, une requête similaire a été reçue, sans que le juge administratif n’accède toutefois aux demandes des requérants.
“Il n’y a rien dans cette requête, il y a bien des demandes, mais rien ne permettant au juge administratif de considérer que les demandeurs ont intérêt à agir”, explique Gil Cornevaux, président du tribunal administratif de Mayotte et de La Réunion. “Si un groupe de rock m’avait demandé de moduler le couvre-feu afin que son concert puisse tenir, il y aurait eu plus d’intérêt à agir que dans cette requête”, illustre encore le magistrat, tout en soulignant qu’il ne s’agit pas à travers ce rendu jeudi “d’un rejet méprisant du revers de la main sur le fond, mais bien d’une impossibilité par le juge administratif de statuer en l’absence d’un élément primordial. L’intérêt à agir est très clair en droit administratif et repose sur une jurisprudence constante”. Or, dans la requête déposée par Maître Ahamada, représentant le Collectif des citoyens de Mayotte et le Comité de défense des intérêts, rien ne permet de soutenir que ces deux requérants ont effectivement ce fameux “intérêt à agir”. Lequel doit être démontré par les demandeurs. Mais dans la requête déposée par l’ancien bâtonnier de Mayotte, rien ne figure à ce titre. “C’est vide, je ne sais même pas s’il s’agit d’associations, je le présume simplement. Or pour analyser l’intérêt d’un requérant à agir, il nous faut regarder le bien fondé des demandes au regard de la personne qui les portes. En l’occurrence, s’agissant d’une personne morale, il faut que les demandes aient une certaine corrélation avec les statuts ou objets sociaux de l’association. Ici, rien ne vient même tenter de le démontrer puisqu’il n’y a aucun élément”, justifie encore Gil Cornevaux.
À travers ce référé liberté, les requérants demandaient au juge des référés d’enjoindre aux directrices de l’ARS et du CHM de passer commande de 400.000 tests de dépistage, de mettre en œuvre à Mayotte un dispositif de dépistage complet à destination des personnels soignants, des forces de sécurité et des membres des familles de personnes atteintes par le virus. Le Collectif et le Codim demandaient également au juge d’enjoindre les deux administrations de “prendre toutes mesures utiles pour fournir le département en masques de protection respiratoire individuelle de type chirurgical FFP2 et FFP3 aux professionnels de santé, aux forces de sécurité ainsi que des masques chirurgicaux aux malades et à la population en général”. Autre demande, la commande de “doses nécessaires au traitement de l’épidémie de Covid-19 par hydroxyxhloroquine, d’azithromycine en nombre suffisant pour couvrir les besoins actuels et à venir de la population mahoraise”. Enfin, il était également demandé au juge administratif d’enjoindre de “prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre à la population vivant au sein d’habitats insalubres de mettre en œuvre les mesures exigées, gestes barrières et confinement, par la fourniture de solutions hydroalcooliques notamment et de produits de première nécessité, limitant ainsi la propagation du virus”.
Des demandes similaires rejetées à La Réunion
Autant de demandes qui n’ont pu être étudiées. Mais qui ressemble à s’y méprendre, hormis la dernière qui correspond à une particularité de l’île à celles sur lesquels Gil Cornevaux, en audience collégiale, a du statuer le 6 avril à La Réunion. “Il s’agissait alors d’un groupement de personnes agissant chacune en leur nom, mais représentées par le même avocat et qui formaient leur demande en tant que professionnels de la santé ou surveillants pénitentiaires. Bien entendu, dans ce cadre nous avons déclaré la recevabilité de la requête”, explique le président du tribunal administratif. “Il y avait un intérêt direct à agir”, estime encore le magistrat tout en détaillant les motifs de rejet de la requête en question. “Concernant la chloroquine, le rejet est lié au fait que ce traitement est prescrit sous contrôle collégial en milieu hospitalier en vertu d’une ordonnance gouvernementale et non pas à destination de toute la population compte tenu de l’incertitude qui pèse encore sur ce traitement. Pour l’instant, aucun traitement général n’est validé par les autorités, ce qui nous empêche d’enjoindre qu’il soit délivré à grande échelle”, expose le juge administratif.
Concernant la demande de tests à destination de la population, la même logique est de mise concernant les dépistages dits sérologiques “qui ne sont pas encore tous validés par les autorités”. Et sur les tests nasaux, il faut s’en référer aux capacités du territoire pour enjoindre ou non un dépistage systématique. En l’occurrence : “le nombre de laboratoires en capacité de les effectuer n’est pas suffisant”, indique Gil Cornevaux. Enfin, les masques. “Nous avons également rejeté cette demande pour plusieurs raisons. D’abord au vu de la situation extrêmement tendue et concurrentielle qui règne sur la fourniture de masques qui limite nécessairement les efforts effectivement déployés par les autorités pour en obtenir dans la mesure du possible. Car il faut, dans cette analyse mettre en regard les efforts déployés au regard des circonstances pour juger de l’atteinte aux libertés soulevée par les requérants”, ajoute encore le magistrat pédagogue.
Autant d’éléments donc, qui laissent à penser que si l’intérêt à agir du Collectif des citoyens de Mayotte et du Comité de défense des intérêts de Mayotte avait été retenue, leurs demandes auraient tout de même été rejetées. Exception faite de celle portant sur les quartiers informels, situation toute particulière à Mayotte et à propos de laquelle le juge aurait dû se pencher sur les moyens effectivement déployés par les autorités.