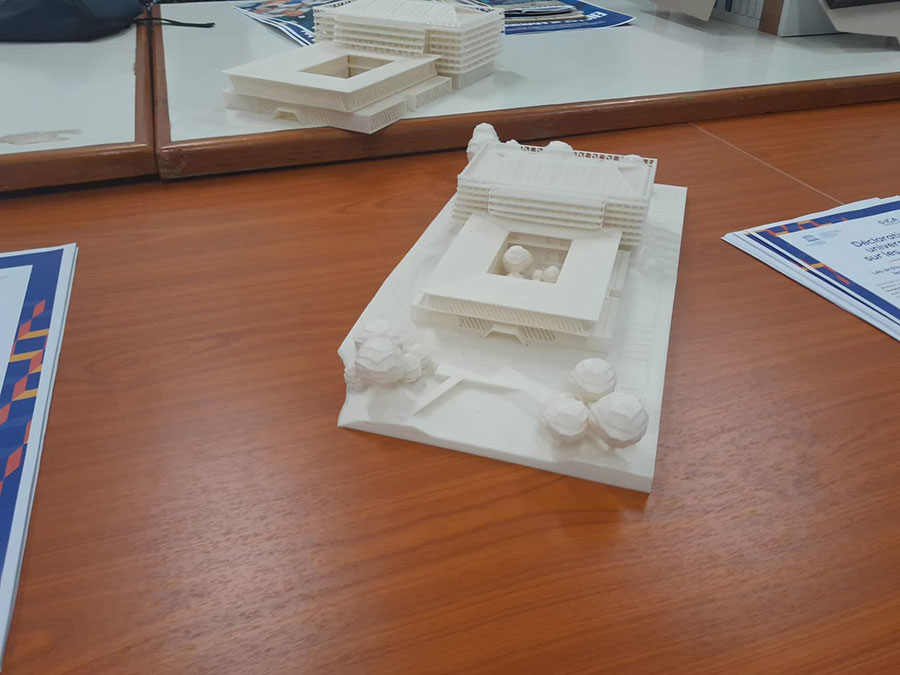Courant mai 2022, sur trois semaines consécutives, une formation maritime a été organisée et proposée par le service territorial de la police aux frontières de Mayotte au profit de policiers, en poste au groupe d’appui opérationnel, au centre de rétention administrative ou à l’aéroport, tous candidats à une affectation au sein de l’unité nautique, en qualité d’équipiers. Cette formation fait suite à la réussite préalable et indispensable des tests de pré-sélection.
Composée de deux séquences, théorique au sein du STPAF et pratique à bord d’un intercepteur de la police nationale, en conditions réelles, la formation interne dispensée a pour objectif d’apporter aux stagiaires toutes les connaissances maritimes nécessaires pour embarquer à bord d’un navire, d’intégrer une équipe opérationnelle pour naviguer en sécurité et de répondre aux besoins opérationnels en matière de lutte contre l’immigration clandestine et de secours en mer.
L’ensemble de ces sujets a été abordé de manière spécifique mais l’intérêt de cette formation reste la polyvalence des personnels embarqués. En effet, ces derniers doivent être capables de tenir l’ensemble des postes sous l’autorité d’un chef de bord. Pour cette première session 2022, cinq postes étaient à pourvoir, mais seuls trois stagiaires ont satisfait aux évaluations finales sous les yeux bienveillants mais non moins rigoureux et exigeants des deux formateurs nautiques, le brigadier de police Olivier D. et le brigadier-chef Benaissa E.M, de la PAF de Mayotte.