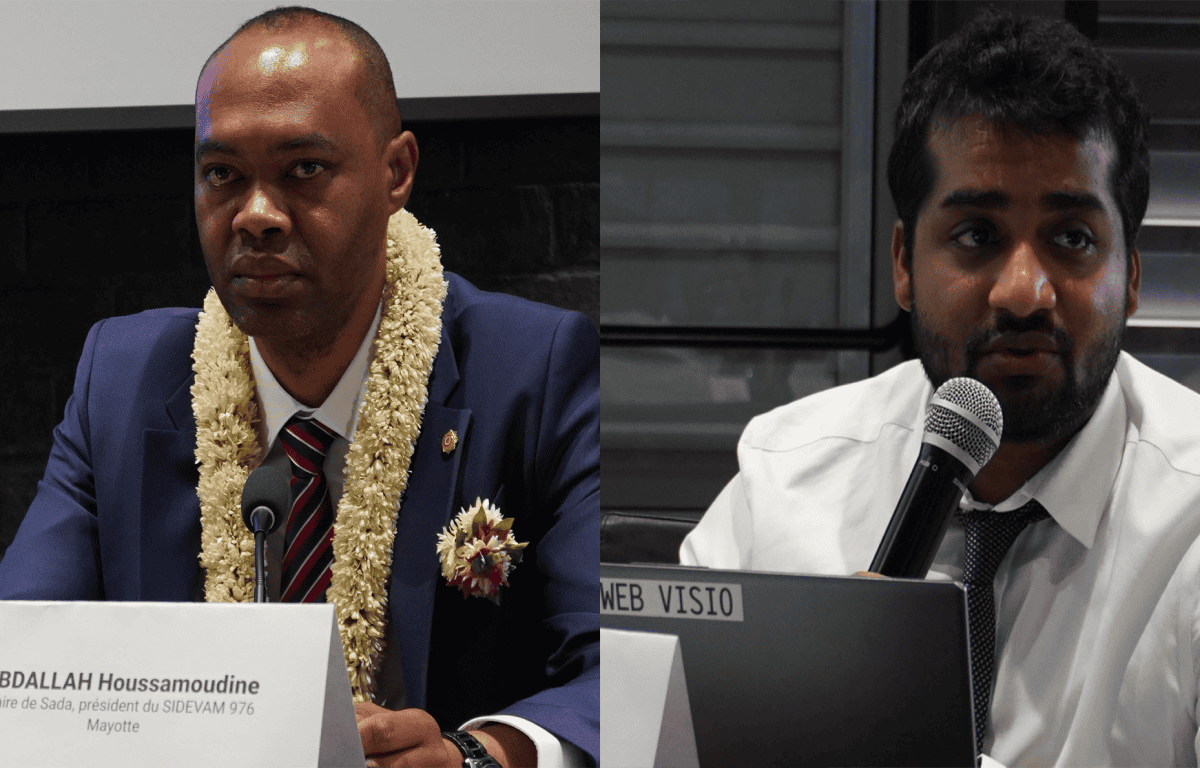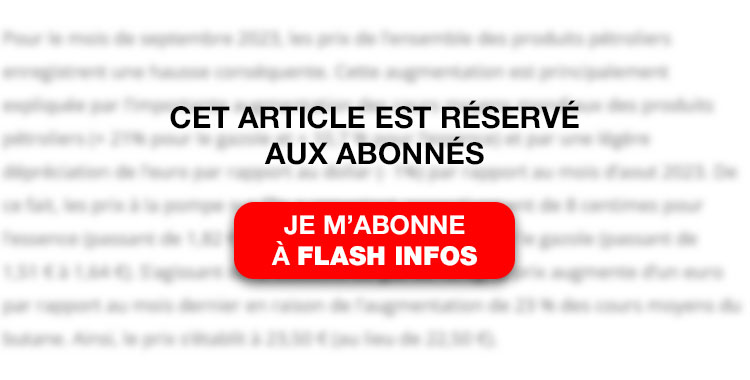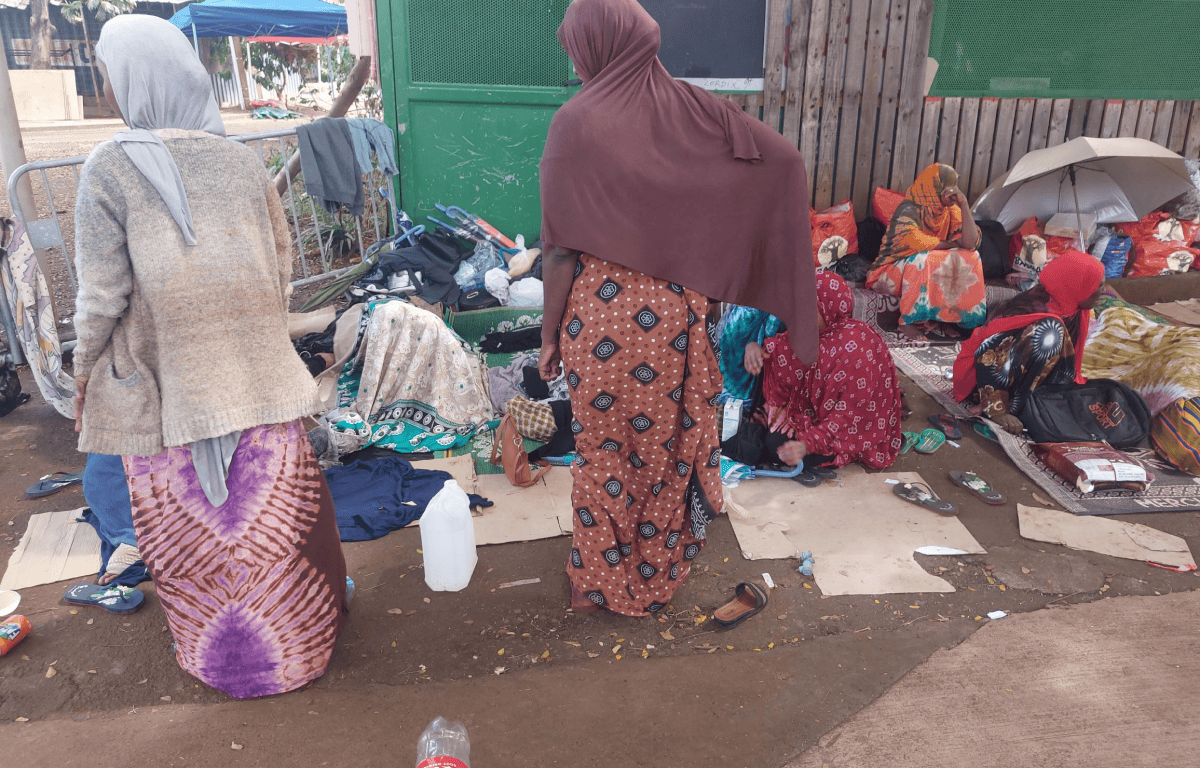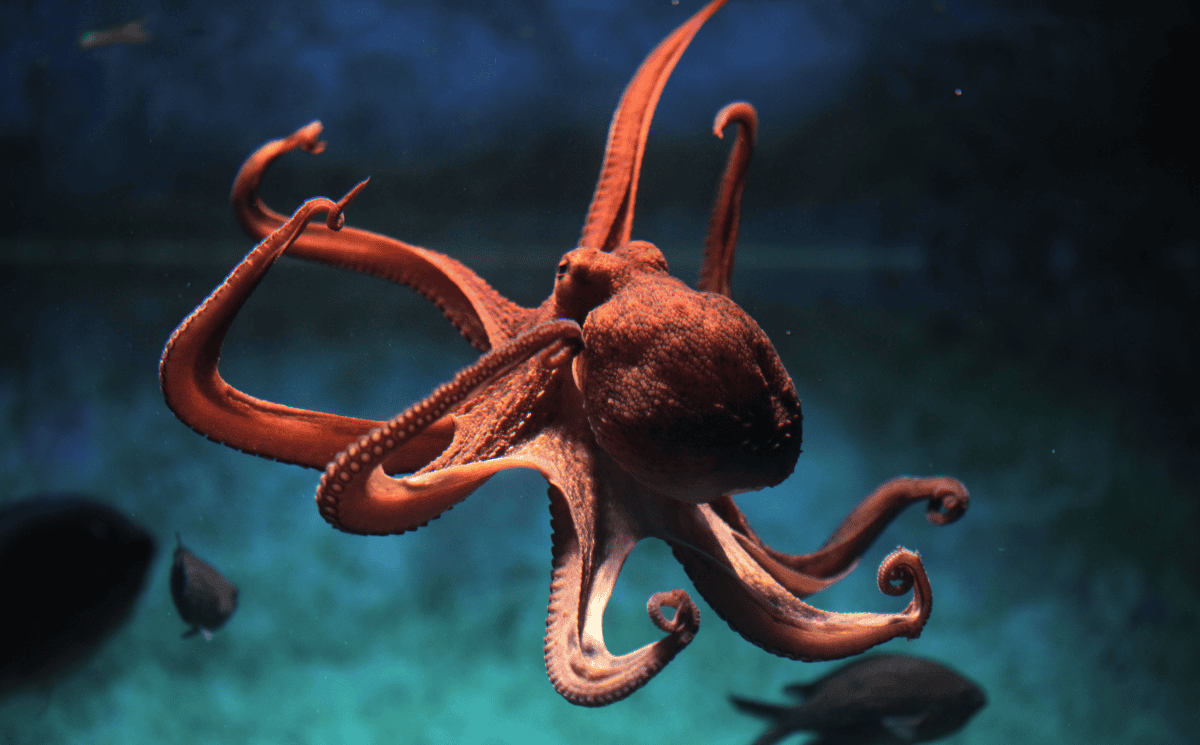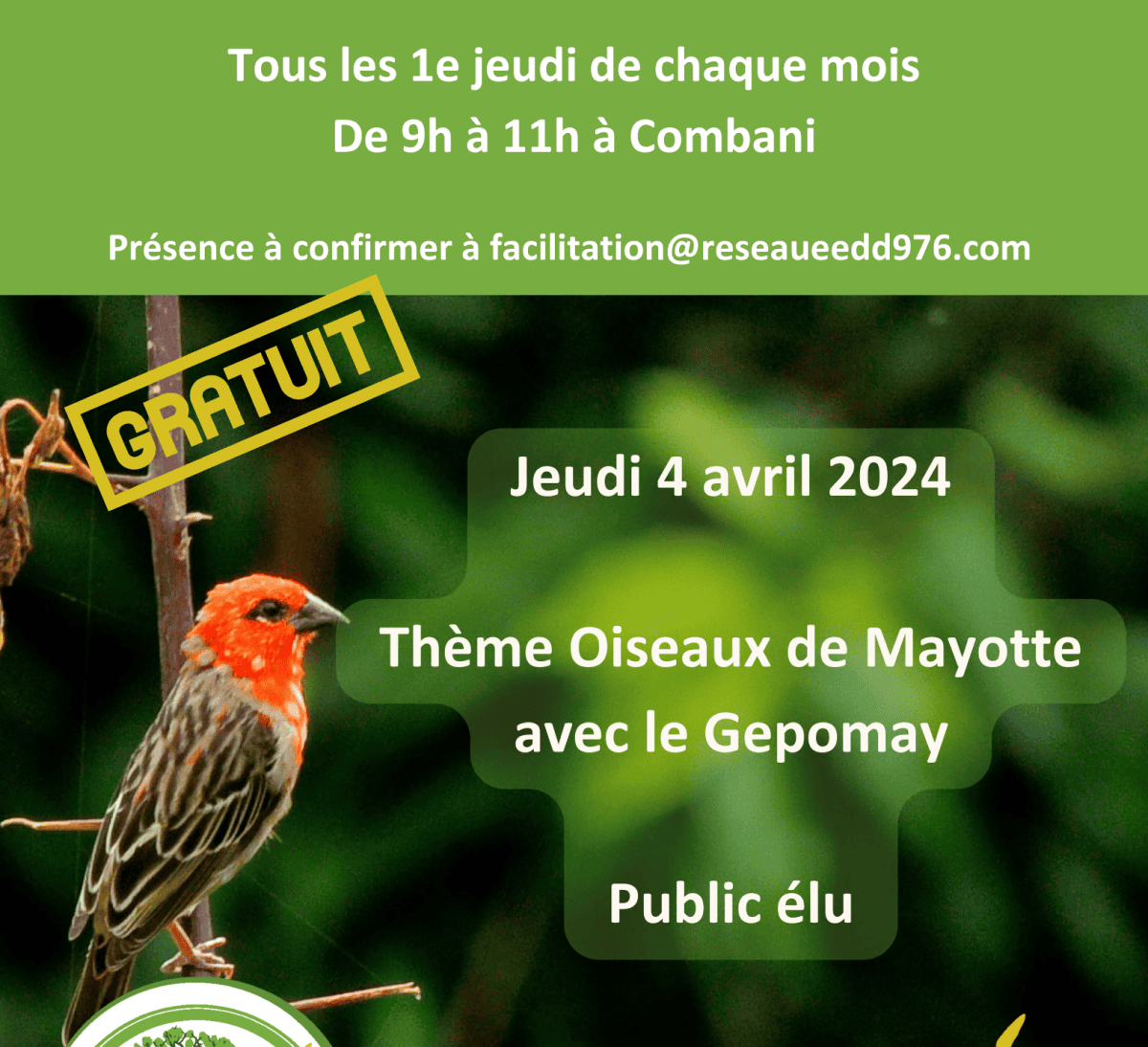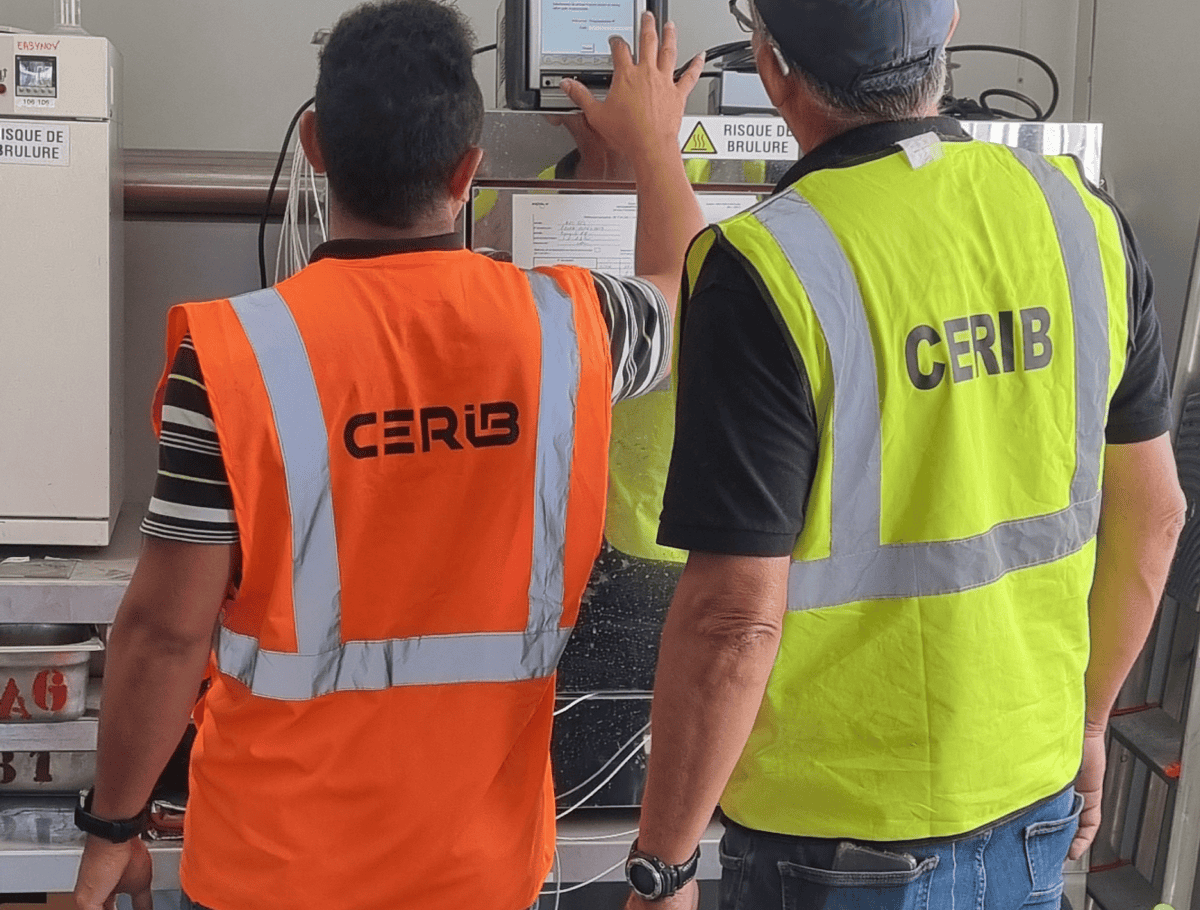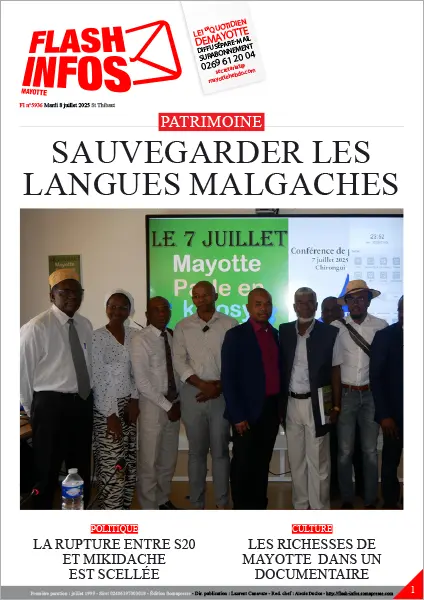Cinq hommes, dont trois étaient mineurs au moment des faits, sont jugés depuis ce mardi par la cour d’assises de Mayotte pour vol, enlèvement et séquestration en bande organisée. Au premier jour d’un procès qui doit se poursuivre jusqu’à vendredi, la victime, l’ancien secrétaire général du lycée agricole de Coconi, s’est exprimée en visioconférence et a décrit des scènes d’horreur et le machiavélisme des cinq accusés, tous originaires de Chiconi.
Plus de trois ans après, il peut encore retracer heure par heure le déroulé des faits. Monsieur G., à l’époque secrétaire général du lycée agricole de Coconi, n’a gardé que quelques stigmates physiques du violent cambriolage de sa résidence et de la nuit qu’il a passé attaché à un arbre, en contre-bas d’une route départementale, à proximité de M’zouazia. Psychologiquement, les conséquences sont davantage perceptibles chez cet homme qui s’est exprimé ce mardi depuis l’île de Wallis, où il réside désormais.
A la cour d’assises de Mayotte, la première journée d’audience du procès pour séquestration, vol et détention arbitraire des cinq accusés auxquels il fait face en visioconférence a permis de conforter un point primordial : « Kiki », « MD », « Satche », « Desso » et « Lolo », de leurs surnoms, reconnaissent les faits qui leurs sont reprochés, mais pas les rôles qui leur sont attribués. Il faut dire que l’enquête menée par la section de recherches n’a laissé guère de doute quant à l’implication de ces cinq hommes originaires de Chiconi, dont trois étaient mineurs au moment des faits, dans cette affaire.
« Ils disaient qu’ils allaient me tuer »
Le 30 septembre, Monsieur G. est rentré plus tard du travail que d’habitude. Logé par le lycée agricole dans une résidence réservée à la direction de l’établissement, à Coconi, l’homme de 58 ans à l’époque se souvient avoir regagné son domicile sur les coups de 20h, avant de s’endormir deux heures plus tard sans verrouiller la porte de sa cuisine. « Vers 22h30, j’ai été réveillé par cinq individus qui me tenaient les bras, les jambes et me bâillonnaient la bouche. Un coupe-coupe était brandi au-dessus de moi. Ils disaient qu’ils allaient me tuer », se remémore, depuis Wallis, le quinquagénaire, auditionné en visioconférence ce mardi.
Selon les déclarations de l’enseignant, un des malfrats parlait français et donnait des consignes aux quatre autres. C’est cet homme, surnommé « Satche » et âgé de 23 ans au moment des faits, qui l’aurait bâillonné et ligoté avant que les autres ne passent à l’action et dérobent des objets high-techs ainsi qu’environ 200 euros en numéraire. Le début d’un long calvaire. Pas satisfaits par leur butin, les monte-en-l’air sont partis avec la voiture de la victime en direction du sud, emmenant l’enseignant par la force dans l’habitacle. Ils ont ensuite rejoint Bandrélé, où ils ont forcé l’homme ligoté à retirer de l’argent, précisément trois fois 150 euros. Pensant que ses agresseurs en avaient fini avec lui, Monsieur G. a alors demandé sa libération, sans obtenir un avis favorable. L’homme a dû attendre une heure supplémentaire et un passage à la station-essence de Chirongui avant d’être extrait du véhicule.
Abandonné seize heures contre un arbre
Lors de sa prise de parole devant la cour, la victime a déroulé, non sans émotions, la bobine de fin de la violente opération orchestrée par les cinq jeunes, sous l’emprise de stupéfiants lorsqu’ils sont passés à l’action ce soir-là : « trois d’entre eux [parmi les cinq malfaiteurs] sont venus avec moi dans la forêt et ont tracé un chemin dans la broussaille avec leurs coupe-coupe (sic), c’était assez dense. Ils m’ont attaché, c’était très serré. Celui que j’avais qualifié de chef a brandi son coupe-coupe devant moi, j’ai cru qu’il allait me trancher la gorge. Il a coupé un bout de ma chemise pour m’attacher la tête à l’arbre ». « Monsieur G. est abandonné sur les coups de minuit, en bordure de route, au niveau de M’zouazia, à dix mètres en contre-bas de la chaussée dans une zone totalement démunie d’habitations », confirme Stéphane Petit, directeur de l’enquête menée par la section de recherche, également auditionné à l’audience.
De son côté, l’enseignant a aussi expliqué comment il a « perdu la notion du réel » pendant la nuit, en apercevant des « dames endimanchées pour une fête » passer devant l’arbre sans lui prêter toute forme d’attention. « Je voyais un champ de bananier proche de moi. J’avais espoir que des gens viennent récolter des bananes ». Bâillonné par un bout de chemise, il aurait réussi, en salivant, à détendre le tissu dans la matinée du 1er octobre. « Je me disais que si j’appelais au secours, personne ne viendrait m’aider car on est à Mayotte et que les personnes penseraient à un traquenard », a-t-il rajouté. Son acharnement n’aura pas été vain : après avoir entendu ses cris, un promeneur a alerté la gendarmerie peu avant 16 heures.
Les gendarmes de la brigade de M’zouazia trouve alors l’homme torse-nu, bâillonné et ligoté à un arbre en contrebas de la CCD4. Le secrétaire général du lycée agricole de Coconi est méconnaissable et déshydraté. Son véhicule a été retrouvé quelques heures plus tôt par une patrouille de la brigade de gendarmerie de Sada. La découverte d’une machette dans l’habitacle avait intrigué les militaires. Les feuilles aspergées d’essence disposées sur le siège avant-gauche du véhicule avaient également laissé penser que des personnes ont tenté d’incendier la Peugeot 2008 de l’enseignant originaire du Nord de la France.
L’ADN retrouvé dans le logement
Appelée sur les lieux, la section de recherches doit patienter avant d’auditionner la victime. Emmené au dispensaire de M’ramadoudou puis aux urgences du centre hospitalier de Mayotte (CHM), le secrétaire général du lycée agricole est en état de choc psychologique. Malgré cela, l’homme n’a pas perdu la mémoire. Une fois son audition rendue possible, il décrit en détail aux militaires la nuit traumatisante qu’il vient de passer entre les mains de la bande.
Dans les jours qui suivent, l’ADN recueilli sur les objets déplacés dans la résidence de la victime a parlé. Les cinq hommes avaient par ailleurs enlevé leurs bonnets et casquettes lorsqu’ils se sont présentés dans la nuit du 1er octobre à Combani pour tenter de retirer de l’argent. Trois des cinq auteurs présumés ont été confondus dans un premier temps. L’un d’entre eux, « MD », a été interpellé au centre pénitentiaire car il était déjà mis en cause dans une affaire de tentative d’homicide sur sa compagne. Ceux qui manquaient à l’appel ont été balancés au fil des auditions.
Affecté à Mayotte depuis quelques mois, Monsieur G. se rappelle encore des missions « riches et intenses » qui l’attendaient sur place au lycée agricole. Mais, après cet épisode douloureux, d’importante séquelles psychologiques l’ont obligé à revoir ses plans. « Je me suis rendu compte que le soir, la nuit, j’avais peur du moindre bruit. Je n’osais plus sortir, même le jour. Le week-end qui a suivi, j’ai voulu aller ranger mon bureau car j’avais pris la décision de partir, ce qui m’avait été proposé par l’autorité académique du ministère de l’agriculture. »
De retour dans les Hauts-de-France, il s’est retrouvé placardisé à un poste « qui se fermait en juillet 2021 ». En septembre, il a finalement été muté sur l’île de Wallis, qu’il juge « beaucoup plus tranquille que Mayotte ». Et même avec un éloignement certain de l’île aux parfums, il constate encore aujourd’hui, presque fatalement : « ma vie normale s’est arrêtée après cette agression ».