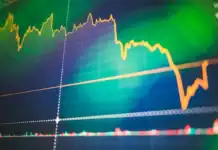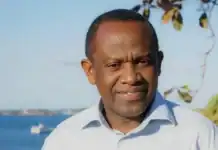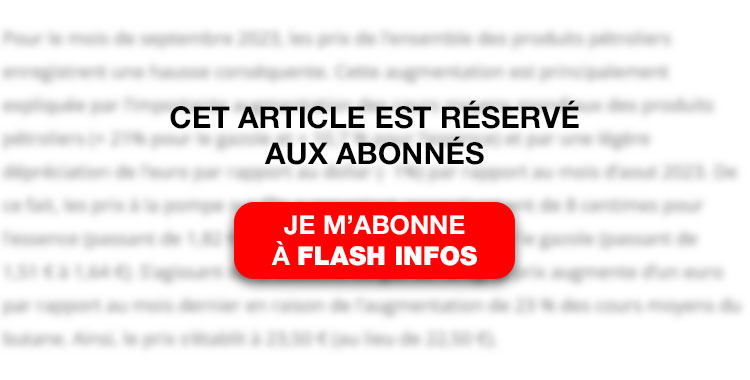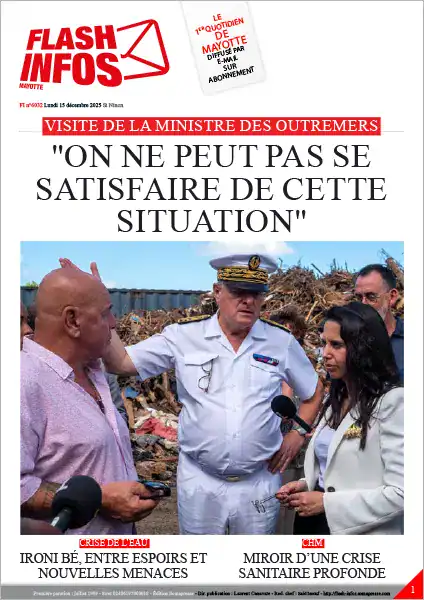Le court-métrage « Laka » rejoint la sélection officielle au festival La Toile des Palmistes, le rendez-vous des amoureux du cinéma en Guyane et l’un des plus importants festivals ultra-marins. Il se déroule à Cayenne du 24 au 26 octobre. Le film mahorais sera diffusé le vendredi 25 octobre en plein air, sur la place des Palmistes. Une dixième nomination pour la production de Germain Le Carpentier, qui avait été présentée au festival congolais Fickin (Festival international de cinéma de Kinshasa). Il est d’ailleurs en replay sur la plateforme France TV.
Une journée de de sensibilisation sur la santé mentale à Brandélé
Le CCAS de la mairie de Bandrélé organise la journée de sensibilisation sur la santé mentale autour d’activités sportives, qui aura lieu ce samedi 19 octobre à Musicale Plage de 8h à 13h. Au programme, café-débat, mgodro, animations… pour mieux comprendre les effets bénéfiques du sport, notamment sur la santé mentale.
Le ministère de l’Agriculture lance une nouvelle campagne : « Stop au gaspillage alimentaire !
En France, le gaspillage alimentaire représente quatre millions de tonnes de déchets par an (chiffre de 2022). Alors à l’occasion de la Journée mondiale de l’alimentation, le 16 octobre, le ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt lance une nouvelle campagne « STOP au gaspillage alimentaire ». Cette campagne reprend les contes et fables, tels que le Corbeau et le Renard, Blanche-Neige, pour cibler en priorité les parents, les enfants, et les jeunes adultes. Le but, partager des actions simples pour réduire le gaspillage alimentaire.
Tecma se dote d’un nouveau site internet
Le magasin spécialisé en scooter, motos et matériel agricole Tecma se dote d’une nouvelle page web, qui permet de remplir un formulaire de contact. Bientôt, les différents produits en vente, des 2 roues, aux pièces détachées en passant par les accessoires, seront disponibles ( https://tecma.yt/)
Coupure d’eau inopinée à Mamoudzou et Tsoundzou ce mercredi
La Société mahoraise des eaux (SMAE) indiquait, mercredi, que les réservoirs de Mamoudzou et de Passamaïnty étaient insuffisants par rapport aux demandes en eau de ces secteurs. Pour cette raison, une fermeture anticipée a eu lieu, ce mercredi, à Mamoudzou centre à 12h au lieu de 14h pour une réouverture entre 16h et 18h, ce jeudi. A Tsoundzou 1, une coupure technique a été mise en place entre 10h et 16h, ce mercredi.
Une voiture en feu entre Combani et Kahani bloque la circulation
Vers 15h30, un incendie s’est déclaré sur la route départementale entre Combani et Kahani. C’est une voiture qui a pris feu, « le conducteur a vu de la fumée sous le capot, il s’est aussitôt mis sur le bas-côté », indique Soule Anli, agent de la police municipale de Tsingoni. Il est sain et sauf.
À peine quelques minutes plus tard, le véhicule s’est embrasé et le feu s’est propagé sur les bambous à proximité. Les végétaux sont tombés sur la route bloquant la circulation. Des équipes de la direction de l’environnement, de l’aménagement, du logement et de la mer (Dealm) sont sur place pour tronçonner les bamabous et laisser passer les voitures. De leur côté, les pompiers de Longoni et de Kahani interviennent pour éteindre le feu. En attendant de pouvoir circuler, les conducteurs sont sortis de leurs véhicules et s’arment de patience.
La majorité est recomposée au conseil municipal de Chirongui

Depuis la démission d’Andhanouni Saïd en 2022, suite à une décision de justice, la vie du conseil municipal de Chirongui est agitée. Bihaki Daouda, élu maire en mai 2022, n’avait pas réussi à conserver sa majorité avec le départ de quelques élus Les Républicains, rendant difficile la prise de délibérations depuis. Le climat est semble-t-il plus apaisé ces derniers temps, et l’élection d’un nouveau bureau a pu avoir lieu, ce mardi 15 octobre (voir encadré).
Est-ce la fin du calvaire pour Bihaki Daouda ? Le maire élu en mai 2022 n’a pas baigné dans la facilité depuis qu’il a pris les rênes d’une municipalité de Chirongui marquée par le passage d’Andhanouni Saïd (l’ex-maire de 2020 à 2022 a été condamné en première instance et en appel pour prise illégale d’intérêts, favoritisme et détournements de fonds). Le nouveau premier magistrat avait tout d’abord réussi à fédérer une partie de la majorité municipale et l’opposition. Sauf que deux éléments ont vite éclaté cette « majorité macédoine ». La première a été le départ, en octobre 2022, des Républicains qui l’avaient initialement rejoint dont Dhoifir Mkadara, son premier adjoint en charge de la sécurité. « Une crise politique majeure avait dès lors paralysé la commune pendant de longs mois. Avec pour conséquence, le rejet du budget de l’exercice 2023 », rappelle la municipalité dans un communiqué. En guerre ouverte et notamment judiciaire, la branche LR avait pu un temps faire retirer au maire ses délégations (à nouveau votées finalement au conseil municipal suivant). Les relations entre les LR et Bihaki Daouda ont pu ensuite s’adoucir et ont permis un vote du budget 2024 d’une importance capitale. « Si le budget n’était pas voté, on repartait pour refaire les élections », précise Adams Ridjali, le directeur de cabinet du maire.
Le deuxième événement de la vie municipale a été le retour dans l’opposition du camp d’Hanima « Roukia » Ibrahima, l’ex-maire de la commune. Parmi celui-ci, il y avait pourtant deux adjoints, Ismaïla Mderemane Saheva et Moussa Daniel. Un nouveau basculement qui a nécessité une clarification pour le conseil municipal. « Vu ce contexte, le maire de Chirongui a convoqué le conseil municipal, mardi 15 octobre, pour une recomposition de la majorité et l’élection d’un nouveau bureau politique, afin de finir le mandat dans de meilleurs conditions », explique la mairie. Ils sont trois à rejoindre le bureau, Mouridou Mari (troisième adjoint au maire), Salim Assani (quatrième adjoint) et Fatima Saïd Bacar (sixième adjointe), tous LR.
Une double opposition
Avec ce retour des élus LR au sein d’une majorité à 19 membres (sur 29 sièges), le maire compte toujours deux oppositions au sein du conseil. Il y a d’abord un camp rassemblant des conseillers municipaux LR qui ne souhaitent pas soutenir le maire comme Youssouf Abdallah, l’ex-maire par intérim, et Tahamida Ibrahim, ancienne conseillère départementale du canton de Sada-Chirongui. Mardi, lors du conseil, ils ont ainsi préféré s’abstenir lors de la plupart des délibérations. Tandis que le clan d’Hanima « Roukia » Ibrahima, qui était au départ favorable au maire, est retourné dans une opposition franche. Réduit à une portion congrue, aucun de ses membres n’a souhaité participer au conseil de ce mardi.
Cette majorité est un nouveau soulagement pour le maire, celui disant vouloir « mener à terme les projets en cours et installer les bases pour un développement harmonieux de la commune ». « On a assez perdu de temps », estime son directeur de cabinet, qui rappelle que la municipalité doit se concentrer sur des travaux importants comme le plateau sportif de Tsimkoura ou le marché couvert de Chirongui.
La composition du bureau
Bihaki Daouda, maire ; Dhoifir Mkadara, premier adjoint ; Momedi Abdillah, deuxième adjoint ; Mouridou Mari, troisième adjoint ; Salim Assani, quatrième adjoint ; Hissani Jean-René, cinquième adjointe ; Fatima Saïd Bacar, sixième adjointe ; Djamalia Antoissi, septième adjointe ; Intia Abdallah, huitième adjointe.
Un nouveau pas vers la recherche clinique à Mayotte

L’unité de recherche clinique vient de voir le jour au sein du centre hospitalier de Mayotte. L’objectif : renforcer la recherche au sein de l’hôpital pour évaluer les actions de santé et indirectement améliorer la prise en charge des patients. L’hôpital espère aussi retenir ses médecins en proposant un accompagnement aux chercheurs.
Le capitaine Couric prend la tête de la toute première compagnie de Dembéni

En 2022, la gendarmerie de Mayotte avait créé sa première compagnie départementale à Koungou, afin de renforcer son état-major en Grande-Terre. Avec l’arrivée du capitaine Arnaud Couric au commandement de la compagnie de Dembéni, elle en fait de même pour le sud de Mayotte et ses trois brigades.
Des défis, le capitaine Arnaud Couric en cherchait. Et à Mayotte, le jeune officier de gendarmerie de 30 ans, qui a pris son service le 2 septembre, est déjà servi. Outre ses débuts sur le terrain, la direction de la gendarmerie nationale lui a confié la toute nouvelle compagnie départementale de Dembéni. En effet, comme Koungou en 2022, Dembéni a été choisi (et plus précisément Hajangua) comme centre de commandement pour superviser les trois brigades territoriales du sud de Mayotte, Dembéni, M’zouazia et Sada. Un nouvel échelon à peaufiner qui n’effraie pas celui qui est passé auparavant par la communauté de brigade de Castanet-Tolosan (Haute-Garonne) et la compagnie de Gaillac (Tarn). « L’Outremer, c’est une découverte pour moi. Par contre, je connais la gendarmerie départementale pour avoir commandé deux unités très différentes. L’une était en périphérie de Toulouse avec beaucoup de violences, du trafic de stupéfiants et une grosse activité. La deuxième expérience dans le Tarn était très rurale. Il y avait beaucoup de troubles de l’ordre public, de contestation de l’ordre établi. Ces deux expériences mixées m’ont donné les outils pour amener des idées ou des pratiques dans cette compagnie », explique le diplômé de l’école militaire de Saint-Cyr et de l’école des officiers de gendarmerie de Melun. Il dit vouloir s’appuyer sur ce qui existe déjà, les brigades de Sada, M’zouazia et Dembéni existant respectivement depuis 1974, 1989 et 2020.
Lors de sa prise de commandement, ce mardi matin, le général Lucien Barth lui a donné trois missions prioritaires, « maintenir l’ordre public », « animer la police judiciaire comme la police administrative » et « être en contact de la population et des élus ». « J’ajoute une exigence, soyez le garant des militaires que vous commandez désormais, le garant de leur professionnalisme, de leur adhésion aux ordres que vous leur donnerez », complète le commandant de la gendarmerie de Mayotte, qui espère avec cette création de compagnie renforcer un territoire qui « fait face à la moitié des crimes et délits constatés par les gendarmes ».
Un maillage renforcé
Si Grande-Terre est scindée en deux compagnies désormais, la compagnie départementale du Koungou ne rétrécit qu’à minima. Elle s’est étoffée dernièrement et va continuer à le faire à l’avenir. Depuis trois mois maintenant, la brigade de Tsingoni (installée à Combani, à proximité de la Maison France service) est opérationnelle et compte actuellement douze militaires. Elle fait partie des 238 nouvelles brigades annoncées par Emmanuel Macron en 2023, comme celle de Dzoumogné. Prévue en 2025, cette dernière permettra de décharger la brigade de M’tsamboro, la plus petite de l’île, de la commune de Bandraboua. Présidant la cérémonie, le général Lionel Lavergne confirme que la démographie a joué un rôle dans la création de cette nouvelle compagnie et de ces brigades. « Avec le développement de l’île et la nécessité qu’il y ait le même niveau de sécurité pour tous les Mahorais et Mahoraises, il nous a semblé évident de créer cette deuxième compagnie et de permettre à celle de Koungou de se concentrer sur le nord de Mayotte », précise le commandant de la gendarmerie en Outremer. Alors que l’effectif de la gendarmerie est régulièrement renforcé par des escadrons supplémentaires de gendarmerie mobile (composés de 72 militaires chacun), le renforcement de la gendarmerie territoriale ne se fera pas au détriment des « mobiles » (il y a quatre escadrons pérennisés à Mayotte actuellement), assure le général de corps d’armée. « Les deux sont complémentaires. A Mayotte, par rapport au reste de l’Outremer, on voit bien que la gendarmerie mobile est dans son cœur de métier de prise en compte de l’ordre public (N.D.L.R. et de lutte contre la gendarmerie clandestine). Ailleurs, les gendarmes mobiles sont amenés à faire du renfort de brigades », explique-t-il, ajoutant qu’il est lui-même favorable à avoir « un niveau de capacité de gendarmes mobiles un peu supérieur à quatre escadrons, de manière à continuer de regagner du terrain ».
Le préfet de Mayotte, François-Xavier Bieuville, voit dans la création de la nouvelle compagnie « un atout supplémentaire qui va nous permettre de marquer davantage le terrain ». S’adressant au nouveau venu, il le prévient « qu’ici, vous avez une attente de sécurité publique, d’ordre public et de paix civile. Ce que demandent les Mahorais, c’est de vivre en paix. […] La paix civile, c’est de pouvoir sortir de la mosquée, le soir, sans être agressé. C’est pour les mamans de pouvoir accompagner leurs enfants à l’école sans subir de caillassages. C’est de pouvoir faire un voulé en famille sur la plage et de profiter des bons moments ensemble, faire en sorte que nous puissions profiter des nôtres ».
🔴 Le capitaine Arnaud Couric prend ses fonctions à la tête de la compagnie départementale de Dembéni, la deuxième de Grande-Terre après Koungou. La cérémonie de ce matin se déroule sous la présidence du général de corps d’armée, Lionel Lavergne. pic.twitter.com/Ahu9ztywSn
— Mayotte Hebdo (@MayotteHebdo) October 15, 2024
« Mayotte est une terre de biodiversité qui structure sa filière cosmétique »

Président de l’entreprise de production d’ylang-ylang Neosent et du cluster cosmétique de Mayotte, Kassim Fidaly participe au salon Cosmetic 360. L’évènement, qui se tient à Paris du 16 au 17 octobre, est l’occasion de parler du marché de la cosmétique mahoraise qui s’organise, sans quitter des yeux les enjeux environnementaux.
Flash Infos : Le salon Cosmetic 360 fête ses dix ans et organise son édition autour de l’innovation. Pour la première fois, des entreprises mahoraises y participent. Quels sont les enjeux de l’événement ?
Kassim Fidaly : C’est l’un des plus grands salons au monde qui réunit différentes entreprises de la cosmétique pour parler de leurs innovations et de leurs visions de la filière. Il y a un pavillon Outre-mer où nous avons la chance de représenter l’île avec quatre entreprises mahoraises : Kasalance, Moeva, Loa cosmetique et Neosent, mon entreprise. Le salon a fait le choix de mettre en avant les problématiques environnementales dans le domaine de la cosmétique. Et les outre-mer ont de l’expérience et des innovations à proposer.
F.I. : Vous pensez à quelles problématiques ?
K.F. : Nous sommes des territoires insulaires, où les ressources comme le bois sont très limitées. Par exemple, pour produire deux kilogrammes d’huile essentielle d’ylang-ylang, il faut près d’une tonne de bois et quarante mètres-cube d’eau. Aujourd’hui, Mayotte ne peut pas s’en sortir. Déjà, on a des coupures d’eau. Ensuite, il faudrait des quantités de bois astronomiques que l’on n’a pas, pour lancer une filière. Donc il faudrait maîtriser l’eau, une denrée déjà rare, et l’énergie soit le bois, qui deviendra bientôt elle aussi une denrée rare. Alors certains essaient d’innover. Mon entreprise propose un procédé de distillation innovant, en apportant de l’énergie solaire, en recyclant les eaux de refroidissements nécessaires à la distillation (pour ne pas déverser l’eau chaude dans la nature) et les déchets. Tout ça pour justement préserver la biodiversité. De plus en plus, des parfumeries tiennent compte des empreintes carbones dans leurs procédés, compositions, emballages. J’aimerais retrouver ça à Mayotte. L’environnement nous préoccupe sur l’île, mais il manque des actes.
Là, je suis en France métropolitaine pour me rendre au salon, et je vois l’étendue des terres. Un espace dont on ne dispose pas sur l’île, et je me dis que nous n’avons pas encore les mêmes priorités que dans l’Hexagone. Une entreprise qui réussit en outre-mer aura surmonté de nombreux obstacles et pourra, selon moi, s’implanter en métropole. L’objectif, c’est donc de dire que Mayotte est une terre de biodiversité qui structure peu à peu sa filière cosmétique.
F.I. : Pourquoi est-ce important de participer à cet événement en tant qu’entreprise mahoraise ?
K.F. : Déjà, pour gagner en visibilité auprès d’acteurs nationaux et internationaux, puisque le salon est un évènement mondial. Donner aussi une meilleure image de Mayotte pour mettre en avant les beaux projets qui se lancent. C’est aussi un moyen de montrer au conseil départemental de Mayotte et à l’Agence de développement et d’innovation à Mayotte (Adim) que nos projets, dont celui de Neosent, ont une réelle crédibilité. Je ne parviens pas à trouver du foncier depuis 2021. Et avec mon activité, louer un terrain sur 25 ans pour y installer notamment des panneaux solaires, c’est impensable. Ils peuvent agir pour justement aider les entreprises du cluster cosmétique, à outrepasser certaines difficultés, même si l’Adim nous épaule déjà beaucoup. C’est elle qui nous a inscrit au salon et a financé une partie du voyage.
F.I. : Vous êtes président du cluster cosmétique de Mayotte. A quoi sert ce dispositif ?
K.F. : Aujourd’hui, plus de 80% de la cosmétique mahoraise n’est pas réglementée. Au sein du cluster, on aimerait que ça change. Il a été créé en même que d’autres clusters en 2021 pour canaliser les activités économiques de l’île. On propose de former nos adhérents aux réglementations, par exemple à l’étiquetage des produits. On aide aussi à la montée en compétences, à comprendre les enjeux environnement. Nous comptons pour l’instant une dizaine de membres. Nos adhérents, qui représentent presque toute la chaîne de valeurs sont de très petites structures et ont souvent besoin d’un coup de pouce. On centralise les acteurs, mais aussi les financements. Tout ça pour sublimer les cosmétiques mahorais qui ont tout le savoir. Notre projet, c’est de créer d’ici deux ans un atelier de transformation collectif pour permettre aux petites entreprises d’avoir des locaux aux normes et sains pour préparer leurs produits en toute tranquillité.
Service civique : « C’est une manière de découvrir le monde du travail »

À l’initiative du centre régional d’Information Jeunesse de Mayotte (Crij), une centaine de volontaires en service civique se sont rassemblés au collège de M’gombani, à Mamoudzou, ce mardi 15 octobre. L’occasion pour de nombreux professionnels de l’insertion, de rappeler l’utilité de ce volontariat pour une future insertion professionnelle.
« J’ai été en service civique, j’ai été embauché par la suite, affirme Madi Ali Madi, coordinateur du pacte de sauvegarde des tortues marines pour l’association des Naturalistes de Mayotte. Dans la cour de récréation du collège de M’gombani, une centaine de volontaires en service civique se sont réunis, ce mardi 15 octobre. À l’initiative du centre régional de l’Information Jeunesse (Crij), les volontaires ont pu se questionner sur leurs droits et leurs démarches d’insertion. Des professionnels de l’insertion étaient donc présents afin d’encenser le parcours des volontaires.
Roibouan Soilihi, référente familiale à la maison de famille de Koungou, garde un bon souvenir de son volontariat au sein d’une école maternelle et primaire. « Mon volontariat en service civique m’a permis d’obtenir des compétences que je réutilise aujourd’hui, notamment dans la prise de contact avec les familles. » Aujourd’hui tutrice, elle accompagne, à son tour, une volontaire au sein de sa structure.
De six à douze mois
Le volontariat est destiné aux jeunes âgées de 16 à 25 ans. Cet engagement ne dure qu’entre de six mois et douze mois selon les missions, parmi différents « domaines prioritaires » définis par l’Agence du service civique tel que le sport, la solidarité, l’éducation pour tous, le développement international et action humanitaire, etc. Une compensation financière d’environ 600 euros par mois est versé aux volontaires. « C’est comme une manière de découvrir le monde du travail, surtout si un jeune ne sait pas trop quoi faire. Cela permet d’avoir un projet professionnel », rapporte Razena Chanfi Mari, conseillère numérique à la Maison France Service de Combani. Kayoum Attoumani est volontaire en au Point Information Jeunesse de Pamandzi depuis sept mois. « Ma mission consiste à accueillir, accompagner les usagers de tout âge qui entrent dans ma structure », explique-t-il. Le jeune volontaire se dit satisfait de sa mission : « Ça m’a permis d’avoir un aperçu du monde professionnel, je compte reprendre mes études dans l’informatique ».
Madi Ali Madi a réussi à obtenir un contrat de travail à la suite de son volontariat. « Ils ont vu que j’étais vraiment intéressé par la nature et la protection des tortues. D’abord en tant qu’agent polyvalent, ensuite comme coordinateur. » À présent, il est le tuteur de douze volontaires au sein des Naturalistes. Malgré le peu de qualification nécessaire à l’embauche d’un service civique, Nasser Madi Hamidouni conseiller en insertion professionnel à Cavani, recommande : « Il ne faut pas faire n’importe quelle mission, il faut une mission qui complètera ou qui visera un projet professionnel ». Car le service civique, qui ne peut s’effectuer qu’une seule fois dans une vie, reste un solide moyen de s’immiscer dans la vie active.
Le village de M’tsapéré ciblé pour une campagne de vaccins
Les carnets de santé sont empilés sur les tables et s’échangent de main en main. Ce mardi, au pont de M’tsapéré, des dizaines d’enfants et de parents attendent sous les tentes blanches déployées par l’Agence régionale de santé (ARS), en partenariat avec la PMI (Protection maternelle infantile), l’association Mlezi Maoré et la réserve sanitaire. Des dizaines d’infirmières et quelques médecins sont là pour vacciner contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche, la rougeole, etc. « Ça ne désemplit pas depuis ce matin », commente Florence, infirmière.
De 8 h à 16 h, les primo-vaccinés ou ceux qui viennent pour un rappel peuvent être accueillis. Si la campagne vise surtout les enfants et adolescents jusqu’à 18 ans, le personnel ne rechigne pas à vacciner les parents, lorsqu’ils en font la demande. L’opération de rattrapage vaccinal sera reconduite vendredi, au dispensaire de M’tsapéré.
Comores : La société nationale de paiements mobiles congédie la moitié des employés
Filiale de Comores Telecom, l’opérateur comorien de téléphonie, Huri Money a justifié ces licenciements par les problèmes de trésorerie qui frappe l’entreprise, dont la masse salariale avoisinait déjà les 22.363 euros pour un effectif de 64 agents.
Après les employés des aéroports des Comores (ADC), vient le tour des agents de Huri Money de se voir notifier leurs licenciements. Si les premiers attendent d’un moment à un autre la confirmation de la décision de radiation, ceux de la société nationale de paiements mobiles n’ont malheureusement pas eu d’échappatoire. En tout, près d’une trentaine d’employés ont été remerciés par la nouvelle direction de la filiale de Comores Telecom, soit la moitié du personnel. Dirigée depuis juillet dernier par Simoh Souef, fils de l’ancien ministre des Télécommunications, Kamalidini Souef, la société a lancé pour la première fois son service de paiement par smartphone en juillet 2021. Trois ans plus tard, elle se retrouve coincée dans des difficultés au point de devoir se séparer d’une partie de ses effectifs. C’est du moins ce qu’avance l’équipe qui dirige actuellement la boîte, laquelle avait bénéficié au départ d’un fonds d’épargne de 300 millions de francs, soit 609.900 euros, versés par la maison mère. Aux Comores, le secteur de paiements mobiles est disputé par Mvola et Huri Money, deux filiales de Telma Comores et par Comores Telecom, les seules entreprises de téléphonie opérant au sein de l’Union. A ce jour, la santé financière semble préoccupante chez la deuxième, dont la masse salariale de ses 64 agents avoisinait les onze millions de francs (22.363 euros). Pour redresser l’entreprise, seule une trentaine d’emplois été gardée. Les autres, dont la plupart étaient en fait en affectation, devraient retourner à Comores Telecom.
Des indemnisations
Mais avant de les licencier, la nouvelle direction assure avoir pris toutes les mesures nécessaires en termes d’indemnisations, conformément aux textes en vigueur, disent-ils. A en croire le directeur commercial, Souef El-Haidar, ces vagues de licenciements étaient un passage obligé dans la mesure où l’entreprise croule sous les dettes. « Depuis sa création, la société accumule les dettes, dont près de 400 millions de francs de Comores Telecom. Il y a également celles des autres prestataires. Pendant que les recrutements parfois pour des raisons politiques continuaient à croître, sans que le besoin ne fasse pas sentir », a déploré le directeur commercial. Il est reproché à l’ancienne équipe dirigeante de s’être adonnée aussi à des dépenses excessives, notamment dans l’achat de matériel roulant, de mobiliers entres autres. Certains véhicules ont dû être revendus pour renflouer les caisses. Même les loyers des locaux sont jugés trop coûteux. La direction a également changé de siège social pour des raisons économiques.
En dépit des arguments avancés pour justifier ces radiations, les dirigeants de Huri Money assurent vouloir mettre l’entreprise sur les rails, le tout en favorisant les compétences. « On a remarqué qu’il n’y avait pas le même traitement salarial entre les employés. Certains étaient payés gracieusement que d’autres alors qu’ils accomplissaient presque le même travail. Nous voulons lutter contre cela. Notre vision est de donner la chance à ceux qui le méritent. Avoir les bras longs ne sera pas un critère de recrutement », a promis le directeur commercial. D’après la direction, même la productivité est en baisse. L’on a en effet appris ce mardi, qu’entre 2023 et 2024, l’activité de l’entreprise a décru de 33%.
Comptant sur un vaste réseau de concessionnaires éparpillés sur le territoire, la filiale de Telma Comores a pu s’emparer d’une grande partie du marché en nouant des partenariats avec par exemple des agences de transfert d’argent à l’instar d’Orange Money ou Ria. Des solutions très prisées par la diaspora comorienne qui envoie chaque mois des devises aux proches restés dans le pays. Au niveau du pays, peu de gens optent pour le paiement par téléphone une fois au marché ou au restaurant. La recharge d’électricité, de crédit téléphonique et le dépôt de cash restent en revanche les principaux services sollicités par les utilisateurs.
Faut-il attendre un décollage du côté de Huri Money avec l’arrivée de nouveaux dirigeants qui se disent ambitieux ? Seul l’avenir nous le dira. En tout cas, le gouvernement aurait approuvé la politique de licenciements déjà rodée dans d’autres sociétés publiques.
Un tournoi de futsal et d’éducation à la santé à Mangajou
Le club de l’AS Papillon d’honneur de Mangajou, dans la commune de Sada, organise l’événement « Papillon en forme ». Ce tournoi de futsal et d’éducation à la santé vise à sensibiliser la jeunesse à travers le sport. Ouvert aux jeunes de 10 à 17 ans, il aura lieu vendredi 25 octobre au plateau polyvalent de Mangajou. Des stands seront aussi installés pour évoquer des thématiques de santé publique.
L’Office de l’eau de Mayotte désormais installé
C’est une instance qui existe dans d’autres territoires ultramarins, mais qui restait encore étranger à Mayotte. Ce mardi, la nouvelle gouvernance de l’Office de l’eau a pris place dans l’hémicycle Younoussa-Bamana du conseil départemental de Mayotte. Selon le Département, « l’objectif de ce nouvel organisme est clair : proposer des solutions durables pour que la population ne subisse plus les coupures récurrentes et puisse bénéficier d’une gestion stable et pérenne de cette ressource essentielle ». Le conseiller départemental du canton de Mamoudzou 3, Nadjayedine Sidi, a été désigné président délégué. « L’eau est essentielle pour notre développement économique. Il est urgent de mettre fin aux coupures qui freinent l’essor de notre territoire », a-t-il indiqué. Au conseil d’administration, il sera entouré de représentants des collectivités locales, de l’État, des usagers et des experts. « Ensemble, ces derniers concentreront leurs efforts sur la surveillance des ressources en eau, la protection des milieux aquatiques, la planification des infrastructures et la formation des acteurs locaux », promet le Département.
Prison de Majicavo : des transferts vers La Réunion qui ne plaisent pas
Afin de réduire la densité carcérale du centre pénitentiaire de Majicavo-Koropa, l’administration pénitentiaire d’Outremer organise régulièrement des transferts de détenus vers la métropole ou La Réunion. Une nouvelle vague de départs vers l’île intense a d’ailleurs suivi la mutinerie du samedi 28 septembre. Une situation que n’accepte pas les élus réunionnais. Huguette Bello, la présidente du conseil régional de l’île, s’en est émue à nos confrères, lors d’une conférence de presse devant la prison de Domenjod, ce lundi. « Que le gouvernement français prenne ses responsabilités, que les Mahorais touchent leur RSA (N.D.L.R. revenu de solidarité active) plein et entier, peut-être qu’il y aurait moins de monde ici. Nous ne sommes pas là pour régler les problèmes de Ma… Nous sommes solidaires, mais nous ne sommes pas là pour régler les problèmes, étant donné qu’à La Réunion, nous avons une situation déjà extrêmement difficile », a confié la présidente de région aux médias réunionnais.
Un concert à la plage d’Hamjago par Tatie Chris
L’association Tatie Chris organise une soirée, le samedi 19 octobre, à partir de 21 heures au large de la plage pour encourager la transmission culturelle et intergénérationnelle. Plusieurs artistes de la scène nord seront présents, comme Baro, Mabré et bien d’autres.
Une huitième édition de la Journée pour entreprendre à Kani-Kéli
Ce jeudi, de 9h à 13h, le plateau de Kani Bé, village de la commune de Kani-Kéli, accueillera la huitième édition de la Journée pour entreprendre. Cet événement, organisé par la Chambre de commerce et d’industrie de Mayotte en partenariat avec l’Agence de développement économique du sud et le conseil départemental de Mayotte, a pour objectif d’accompagner les porteurs de projet et de stimuler l’émergence de nouvelles initiatives sur le territoire.
L’objectif est d’informer sur les démarches administratives et financières, de présenter les différentes structures d’accompagnement existantes, et de favoriser les échanges. Cette édition mettra l’accent sur deux problématiques cruciales pour le sud de Mayotte, la lutte contre l’illettrisme et l’illectronisme.
Le bureau des étrangers bloqué depuis ce lundi

Le collectif des citoyens de Mayotte 2018 a commencé à bloquer dès lundi matin le bureau des étrangers de la préfecture de Mayotte à Mamoudzou, suite à l’agression d’une mère de famille dans une voitureà Koungou, ce vendredi. Pour l’instant, les manifestants promettent un blocage jusqu’à mercredi, jour où ils rencontreront le préfet François-Xavier Bieuville.

« Stop. On régularise pour nous tuer », est-il inscrit sur une banderole placée devant le bureau des étrangers. Ce lundi, depuis cinq heures du matin, les membres du collectif citoyens de Mayotte 2018 bloquent ce service de la préfecture de Mayotte qui délivre habituellement les titres de séjour. C’est l’agression, ce vendredi, d’une mère de famille à Koungou dans son véhicule, qui a poussé le collectif à se mobiliser. « Pourquoi ces jeunes qui sont nés ou grandis ici nous en veulent ? Depuis des années, cela dure. Est-ce que les papiers suffisent à les satisfaire ? », demande en colère Safina Soula, la présidente du groupe. Celle-ci souhaite alerter les autorités sur cette insécurité : « Ils doivent agir. On demande l’arrêt des régularisations des personnes arrivées clandestinement, il nous faut des mesures d’urgence ». Selon elle, le bureau des étrangers serait à l’origine d’une régularisation abusive qui conduise à cette insécurité.
Une rencontre prévue mercredi
En attendant une rencontre avec le préfet François-Xavier Bieuville prévue mercredi, le collectif compte bien continuer à faire le pied de grue pour empêcher l’activité du service préfectoral et même si la pluie a partiellement interrompu la mobilisation. Car les nouvelles du large (voir encadré), qui font mention de nouvelles arrivées en kwassas ces dernières heures, ne calment en rien la colère du groupe.
Arrivée de trois kwassas en une nuit
Dans la nuit de dimanche, trois kwassas ont accosté à Mayotte. Deux ont été repérés aux larges d’Acoua aux alentours de 23h30 avec une trentaine de passagers à bord. Dans le sud du département, au large de Sada, c’est une embarcation avec une vingtaine de passagers qui tentaient d’entrer illégalement. A son bord, deux blessés ont été pris en charge par les secours. Le reste des occupants ont été conduits au centre de rétention administrative (CRA) de Petite-Terre, où ils feront l’objet d’une reconduite à la frontière.
La Caisse des écoles de Mamoudzou écope d’une mauvaise note

En charge de la collation, des accueils collectifs de mineurs (ACM) et des dispositifs de réussite éducative, la Caisse des écoles de Mamoudzou n’a cessé de grossir et s’est dotée d’une direction autonome depuis 2018. Gouvernance, compétences, fonctionnement, ressources humaines, de multiples irrégularités ont été constatées par la Chambre régionale des comptes La Réunion-Mayotte.
Gouvernance
Dès le premier point, la Chambre régionale des comptes La Réunion-Mayotte s’étonne que le nombre de membres du comité d’administration n’ait cessé de grandir pour atteindre seize aujourd’hui. Cette évolution, ainsi que le mode de désignation, se fait en dépit des statuts de cette structure (la CDE promet une révision en 2025) qui a trois principales missions, organiser la distribution de la collation dans les écoles de Mamoudzou, le fonctionnement des accueils collectifs de mineurs (ACM) et celui des dispositifs de réussite éducative. Cela ne favorise pourtant pas la gouvernance de la Caisse puisque les réunions peinent à faire le plein ou sont tout bonnement annulées faute de quorum suffisant. « Outre la lourdeur administrative liée à un ajournement et une nouvelle convocation, l’absence de quorum pourrait être interprétée comme un manque d’intérêt des administrateurs pour les questions de la caisse », estime la CRC, dans son rapport rendu public le vendredi 11 octobre. Et pour l’assemblée générale, la Chambre note tout simplement qu’elle « est absente de la vie de la vie de l’organisme » et « ne s’est réunie pour la première fois depuis sa création qu’en janvier 2023 ».
Si la Caisse ne rencontre pas de problèmes de financement, les magistrats s’inquiètent aussi des pratiques, comme ces billets en classe confort achetés 3.761 euros pour un déplacement hors Mayotte de la vice-présidente en 2022, « alors qu’aucune décision n’autorise une prise en charge dérogatoire à la classe économique ». Cette même année, une indemnité pour frais de représentation « à hauteur de 1.000 euros pour l’année » a été aussi votée pour la même personne, avant que « cette délibération ait été retirée à la demande du préfet ».
Compétences
C’est l’une des limites de l’exercice de la Caisse des écoles, celle-ci dépend beaucoup de la municipalité, à la fois pour ses finances, ses locaux, l’informatique ou la commande publique. Cela n’empêche pas « un manque flagrant de rigueur administrative et de coordination entre les deux structures, qui nécessitent assurément d’améliorer leur articulation ».
Car cette dépendance, la CDE arrive parfois à s’en affranchir. Comme ce projet d’auberge de jeunesse qu’elle avait commencé à mettre en place. « La caisse des écoles a indiqué intervenir dans le cadre d’un mandat du maire, mais sans en apporter la moindre justification, en lien avec la direction des projets structurants de la commune », ont constaté les magistrats. Il en va de même pour la création d’un poste de chef de projet pour le dispositif national de la politique de la ville Cité éducative, « sans aucun accord de la commune et après s’être positionné expressément sur l’agent qui l’occuperait ». Afin d’éviter les mauvaises surprises, la Chambre recommande de « mettre en place, dès à présent, les moyens nécessaires au renforcement de l’exercice de la collectivité de rattachement par une instance de coordination donnant lieu à des comptes rendus formalisés ».
Les collations
C’est la mission principale de la Caisse des écoles, assurer la collation pour les milliers d’élèves inscrits (environ 17.000 pour l’année 2022-2023). Si celle-ci s’acquitte de sa tâche en fournissant une collation composée d’un produit laitier (tel que yaourt, fromage ou lait), d’un pain ou d’une biscotte et d’une boisson (eau ou jus de fruit sans adjonction de sucre), elle peine à assurer un suivi clair de ce marché confié à deux prestataires. « La caisse des écoles et la commune, qui a porté les différents marchés, ont produit des éléments de dossier particulièrement désordonnés et incomplets pour cette prestation qui représente pourtant la première dépense de l’établissement public. Ni l’une ni l’autre n’ont été en mesure de dresser un historique précis, exhaustif et clairement documenté. Le nombre de consultations lancées diffèrent selon les réponses produites, et certaines indications ne sont pas étayées », fait remarquer la CRC. En outre, elle note que des enfants se retrouvent des mois durant sans collation quand les parents ne paient pas. Elle invite donc la Caisse à « revoir la tarification des collations pour prévoir une modulation des tarifs en fonction des niveaux de revenus, et rappelle à l’occasion que si des difficultés peuvent être identifiées chez certains parents, la caisse doit associer la ville et son CCAS pour tenter d’y remédier ».
Les magistrats ont remarqué aussi que le développement de la restauration scolaire est toujours à la peine, citant l’exemple de Doujani 1 qui a un réfectoire inutilisé depuis plus d’un an.
Ressources humaines
La Caisse des écoles n’a pas cessé d’augmenter ses effectifs au fil du temps. Fin 2022, ils étaient ainsi 34 emplois permanents à y travailler. Des agents de catégorie B rémunérés sur des grilles de salaire de catégorie A, des employés mis à disposition par la commune « pour lesquels la caisse n’a pas réalisé de création de poste », des postes qui « ne s’appuient pas sur une délibération de création d’emplois », indemnité non justifiée, la liste des bizarreries est longue, tandis que « des anomalies et des incohérences de natures diverses ont pu être aussi relevées dans l’établissement des actes relatifs aux ressources humaines ».
La CDE a connu notable en 2023 avec le transfert des personnels en matière de restauration scolaire et périscolaire, avec en premier lieu la reprise de l’ensemble des agents ayant exercé en tant qu’encadrant du PEDT (animateur ou animateur référent) avec le statut de vacataire. La Chambre alerte sur les risques financiers d’une telle mesure, mais également conseille la réalisation d’« une étude de sa soutenabilité avec la mise en place de groupes de travail concrets. Il s’agit d’une étape préalable incontournable, afin notamment de ne pas risquer d’employer et de rémunérer du personnel en sous-activité ». Elle cite en exemple le cas de régisseurs « qui n’exercent qu’une activité temporaire et ponctuelle au regard des périodes de paiement ouvertes sur l’année ».
En réponse, la Caisse des écoles fait valoir le recrutement d’une responsable aux ressources humaines en juin 2024. « Nous nous appuyons sur elle pour dresser un diagnostic RH, et mettre en place un plan d’actions qui sera échelonné dans les temps, avec un cadencement à l’immédiat, à court, à moyen et à long terme, selon les situations et problématiques repérées », défend la structure.
📊Rapport d’observations définitives:
La caisse des écoles de #MamoudzouRetrouvez le rapport en intégralité sur notre site internet⬇️https://t.co/zuMpYShF3P pic.twitter.com/719bos4Ss0
— Chambres régionales des comptes La Réunion-Mayotte (@CRCLRM) October 11, 2024