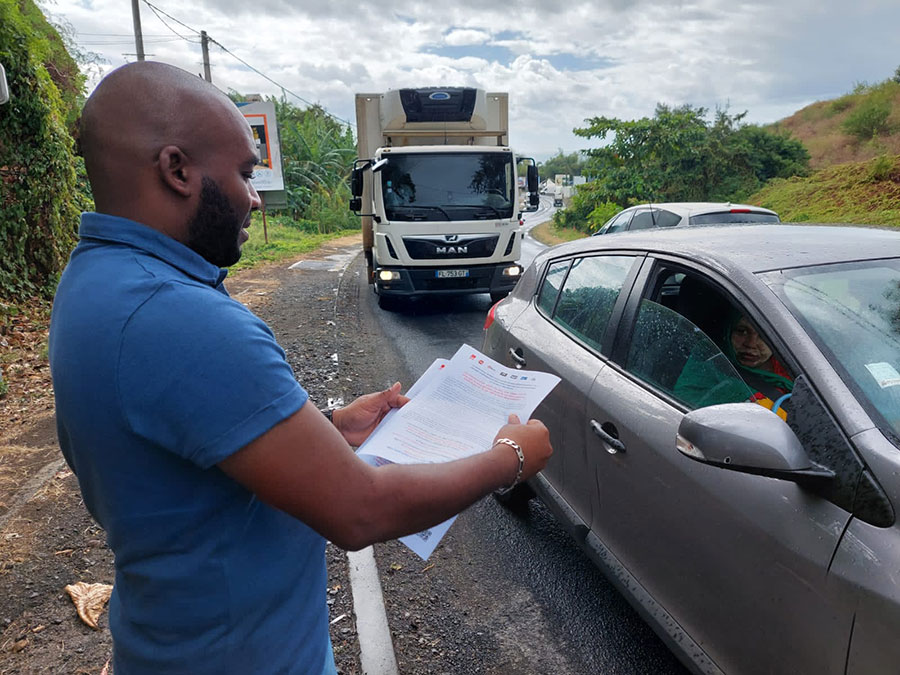Le 20 mai 2022, le tribunal de Mamoudzou a rendu un jugement annulant une vente de plusieurs parcelles de terrain (contenant la carrière de Koungou) avec rente viagère conclue entre Frédéric D’Achery et la « SAS Vinci Construction Dom-Tom« . La plaignante, Alaine Andriambavy, l’une des héritières de l’ancien maire et conseiller général de Koungou, risquait gros si elle n’avait pas obtenu gain de cause, le défendeur lui réclamant 400.000 euros de dommages et intérêts.
L’affaire ainsi jugée fera incontestablement jurisprudence à Mayotte, en particulier dans le monde très restreint des exploitants de carrières de basalte, « l’or gris de Mayotte« . Très sensible parce que touchant à un secteur important de l’économie mahoraise, cette affaire remonte au 3 février 2020 lorsque Alaine Andriambavy, l’une des héritières de Fréderic D’Achery (ancien élu et grand propriétaire terrien dans la commune de Koungou), a saisi le tribunal judiciaire de Mamoudzou pour demander l’annulation d’une vente intervenue le 15 septembre 2015 entre son aïeul et l’entreprise « Vinci Construction Dom-Tom« .
Dans sa plainte transmise par exploit d’huissier de justice, elle indique qu’en sa qualité de cohéritière, elle s’estimait fondée à agir en nullité de cette vente avec rente viagère concernant la carrière de Koungou. Celle-ci faisait également valoir le fait que dans cette affaire, la société précitée ne risquait aucune perte compte tenu du fait que les revenus du bien aliéné étaient supérieurs aux arrérages stipulés dans l’acte de vente de sorte que si Frédéric D’Achery n’avait pas cédé son bien, il aurait perçu un revenu mensuel moyen supérieur au montant de sa rente viagère. Mis en avant aussi ? L’âge avancé (82 ans) de ce dernier au moment de la vente, de même que le bouquet lui ayant été versé, lequel ne représentait que 7.2% de la valeur de la carrière telle que définie dans le contrat signé entre les deux parties. L’héritière considère donc que le capital versé à son parent était manifestement dérisoire au regard de la valeur du bien et de l’espérance de vie du créditeur rentier. Mais aussi que cette vente était dépourvue de tout aléa et que de ce fait la succession de Fréderic D’Achery réclamait 350.000 euros de dommages et intérêts à la société « Vinci Construction Dom-Tom« .
Par ailleurs, Alaine Andriambavy demande également à la justice d’annuler purement et simplement la totalité de la procédure ayant abouti à cette vente, y compris la phase notariale, de « dire que la créance de la société « Vinci Construction Dom-Tom« née de son droit à restitution des sommes versées au titre de la vente est absorbée par les dommages et intérêts qui doivent être mis à sa charge pour réparer le préjudice subi par Frédéric D’Achery au moment de la vente, de sorte qu’il y a lieu à compensation par l’article 1289 du code civil« . Autre requête de l’héritière pour obtenir un effet de jurisprudence à Mayotte ? Ordonner au conservateur des hypothèques de publier le présent jugement (sur présentation de son expédition et du certificat attestant qu’il est passé en force de la chose jugée), ainsi qu’une condamnation de la partie adverse à lui verser une somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, la société « Vinci Construction Dom-Tom » (qui n’a pas consenti à répondre à nos demandes d’entretien au sujet de ce jugement), avait demandé au tribunal de débouter Mme Andriambavy, à titre principal, de « ses demandes injustes et mal fondées« , lui reconnaitre la pleine propriété des 5 parcelles cadastrées section AR n° 272, 276, 277 du lieu-dit lotissement d’Achéry, ainsi que les sections BS n° 120 et 210, lieu-dit Be M’Randra et débouter la plaignante de ses demandes contraires.
En outre, et à titre de réparation, la société « Vinci Construction Dom-Tom » demandait à la justice que la plaignante soit condamnée à :
- lui payer la somme de 400.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédures abusive,
- lui payer la somme de 10.000 € en application de la de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la plaignante au titre de distraction de son avocat, Maître Charles Simon, mais aussi de toute la procédure.
Question de droit et procédures
En guise de réponse à toutes ces démarches, le Tribunal judiciaire de Mamoudzou a jugé recevable la demande en nullité de Mme Andriamabavy, en sa qualité d’héritière de M. Fréderic d’Achery, en estimant que « cette qualité ne (lui) ai pas contestée, ce qui permet de constater que l’objet de la présente et que les termes de l’assignation de cette dernière permettent de constater que l’objet de la présente instance est une demande d’annulation d’une vente fondée sur le vice dont elle considère qu’elle est affectée, action dont le de cujus était demandeur et qu’il a transmis à ses héritiers au jour de son décès« . Sur cette base, il a déclaré recevable la demande de la plaignante en s’appuyant sur l’article 1108 du code civil « le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s’engage à procurer à l’autre un avantage qui est regardé comme l’équivalent de celui qu’elle reçoit. Il est aléatoire lorsque les partis acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d’un événement incertain« .
De même que le tribunal, en se basant sur l’article 1583 du Code civil a estimé que la vente entre les deux parties n’est parfaite que « dès qu’on est convenu de la chose et du prix quoique la chose n’ait pas encore été livrée et le prix payé« . Dans son arrêt, le tribunal précise que les dispositions de l’article 1169 du Code civil indiquent qu’un contrat conclu à titre onéreux est nul lorsqu’au moment de sa formation, la contrepartie au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire. Se référant également aux articles 1583 et autres, du même code civil, le tribunal judiciaire de Mamoudzou a considéré qu’en l’absence de prix réel et sérieux, l’acte de cession ne constitue pas une vente et doit être déclaré nul.
Par ailleurs, se basant sur d’autres aspects du code civil, le Tribunal a estimé que dans le cadre d’une vente avec rente viagère, c’est lors de la conclusion de celle-ci qu’il faut se placer et apprécier sa validité au regard du montant du prix stipulé, partie en rente et partie en capital … « Il faut également que le risque économique soit partagé. Ainsi l’aléa disparait lorsque le montant de la rente viagère est inférieur au montant des revenus du bien immobilier« a-t-il précisé. Il ressort également de cette procédure qu’au moment où M. Fréderic d’Achéry a pris sa décision de vendre ce site (les 3 parcelles concernées) après l’expulsion de la société IBS, il avait 3 offres en dehors de celle qu’il a choisie d’accepter :
- Société IBS : 4 millions d’euros,
- Groupe Lafarge : 3,2 millions d’euros,
- Société COLAS : 2, 2 millions d’euros.
D’autres éléments et conditions pris en compte par le tribunal dans cette affaire ont été évoqués par le tribunal. Dans son arrêt, celui-ci donne une suite favorable à la requête de la plaignante, Mme Andriambavy, en déclarant la nullité de la vente du site à la société « Vinci Construction Dom-Tom« intervenue le 15 septembre 2015, tout en rappelant que la succession de feu M. D’Achery doit restituer la somme de 200.000 € à l’autre partie contractante au titre de l’indemnité de d’immobilisation et du bouquet et la somme de 112 500 € versée au titre des arrérages. Le conservateur des hypothèques de Mamoudzou se voit également obligé de publier le jugement rendu sur « présentation de son expédition et du certificat attestant qu’il est passé en force de chose jugée« . La société « Vinci Construction Dom-Tom« se voit par ailleurs condamnée à verser à Mme Andriambavy la somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 de la procédure civile. Les plus amples demandes des deux parties ont été rejetées et le défenseur a été condamné aux entiers dépens. Il convient de préciser que la présente décision de justice a un effet exécutoire.