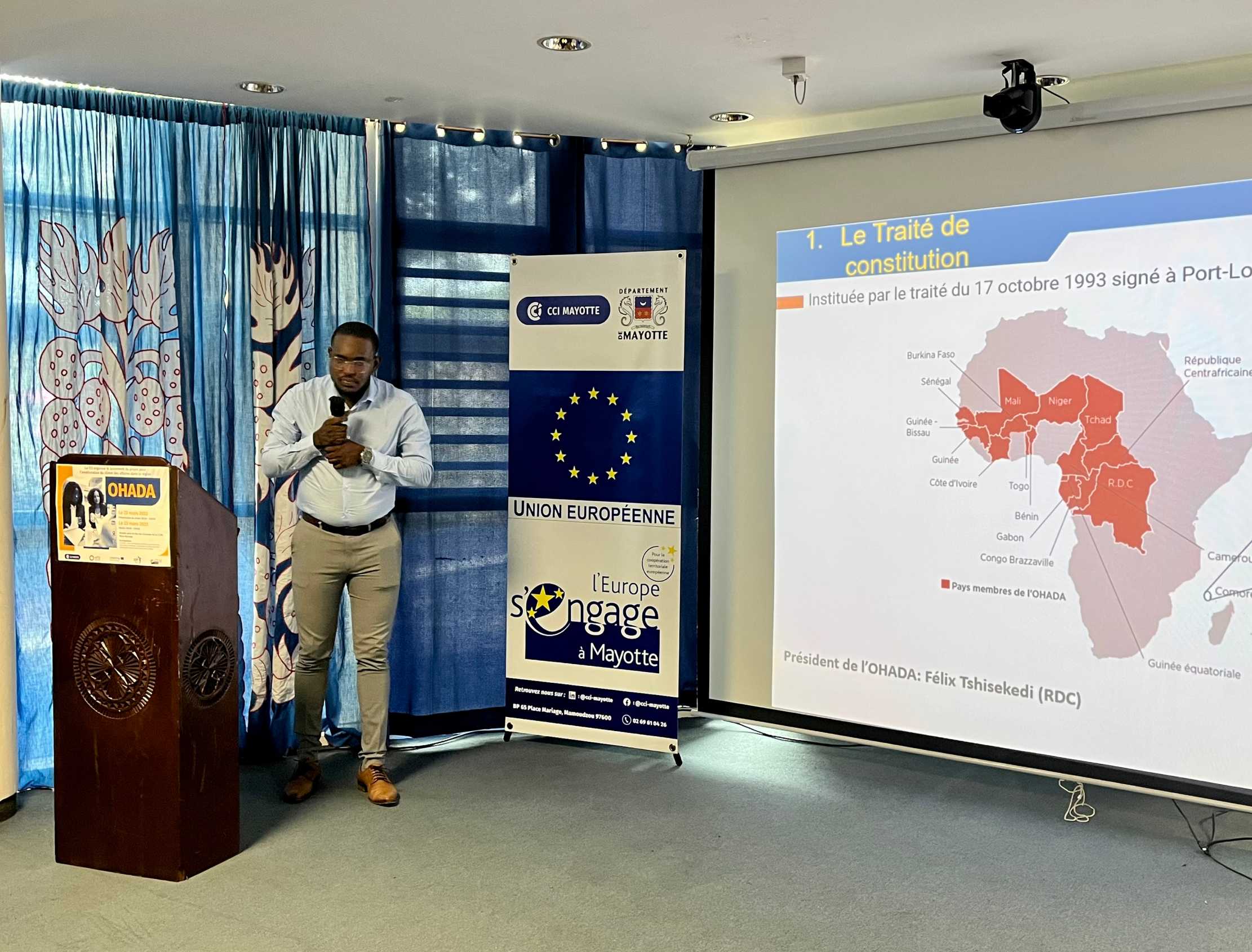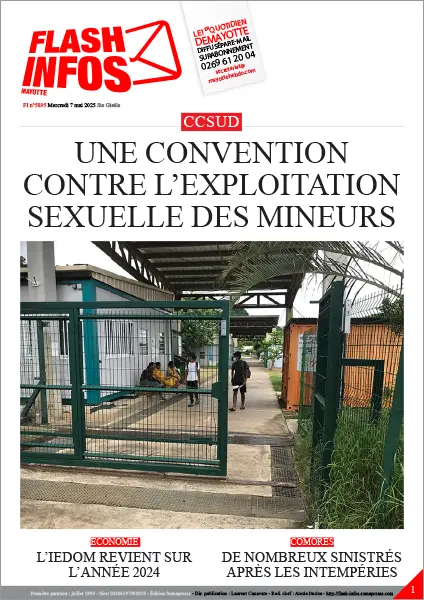Une table ronde de la délégation sénatoriale aux outre-mer s’est tenue ce jeudi matin sur la thématique du foncier agricole à Mayotte. Les acteurs incontournables en la matière – Conseil départemental, Daaf, Epfam, ou encore Capam (voir encadré) – étaient auditionnés pour permettre aux sénateurs de mieux saisir la problématique dans sa globalité et leur permettre d’émettre des préconisations pertinentes. Retour sur les échanges.
« Mes collègues sont édifiés par ce qu’ils entendent ! » Si le sénateur mahorais Thani Mohamed Soilihi a pleinement conscience de la complexité de la problématique du foncier agricole sur son île, ses confrères en prennent – peut-être – seulement la mesure. La question était discutée ce jeudi matin au cours d’une table ronde de la délégation sénatoriale aux outre-mer, faisant intervenir l’ensemble des acteurs locaux impliqués sur le sujet (voir encadré). Plusieurs grands axes se sont dégagés des propos échangés.
L’auto-suffisance alimentaire
« Le développement de l’agriculture professionnelle doit se faire au service de notre souveraineté alimentaire », introduit Philippe Gout, le directeur de la Direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (Daaf) de Mayotte dans son propos liminaire. Voilà donc l’objectif : s’assurer que nous puissions nous nourrir tous seuls. Nos cartes en main : 20.000 hectares de superficie agricole utile (selon le Conseil départemental), dont 7.000 sont effectivement cultivés. Là-dessus : 60 % appartiennent au CD, 30 % au parc privé et 10 % à l’État – grosso modo. Problème, l’occupation illégale d’une grande partie des parcelles entrave l’installation d’agriculteurs professionnels. « Sur les quinze diplômés du brevet professionnel responsable d’entreprise agricole (BPREA), seulement six justifient d’une parcelle. Près de 200 porteurs de projets se sont présentés au PAI (point accueil installation, NDLR) à la recherche d’un foncier », rapporte ainsi Soumaïla Moeva, président du syndicat des jeunes agriculteurs de Mayotte, qui estime que trois à cinq ans sont nécessaires à un agriculteur pour hériter d’un foncier maîtrisé. « Cette situation maintient les agriculteurs compétents et diplômés dans une situation de semi-professionnalisation. Soit ils sont contraints d’exercer sur du foncier non maîtrisé, soit ils ont recours à un emploi alimentaire, reléguant au second plan leur activité agricole », déplore-t-il.
Comment, dès lors, disposer de ce foncier pour favoriser le développement d’une agriculture professionnelle sur l’île ? C’est là tout l’enjeu des discussions du jour. « L’objectif est de rencontrer les occupants et d’identifier leur vocation à devenir ou non des agriculteurs. Si tel est le cas, on les accompagne, sinon on récupère le foncier », résume Yves-Michel Daunar, le directeur général de l’Établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte (Epfam), qui joue sur l’île le rôle de Safer (Société d’aménagement foncier et d’établissement rural), et agit à ce titre en matière de préemption de terrains agricoles. Créé en 2017, l’Epfam est aujourd’hui propriétaire de 75 hectares de foncier, sur lesquels 18 agriculteurs ont été installés. Autre problème : le morcellement des terres. D’une part, il ne favorise pas les projets d’envergure. Pire encore, il serait le symptôme d’une forme de dévoiement du foncier agricole. « La plupart des transactions concerne de très petits terrains : la surface médiane est de seulement 550 m². On en conclut que la majorité des parcelles mises sur le marché n’ont pas vocation à être cultivées », constate Yves-Michel Daunar, qui observe par ailleurs « la création de sociétés agricoles écrans pour éviter la préemption des parcelles ».
La retraite comme levier pour libérer les terrains ?
Le sujet, décidément, transcende l’actualité : les retraites pourraient constituer un levier pour libérer les terrains et favoriser l’installation de jeunes exploitants. Alors que les agriculteurs de l’île vieillissent (43 % sont âgés de plus de 60 ans, et seulement 10 % moins de 40 ans), il n’y a que « quatre retraités agricoles en 2023 à Mayotte », touchant des pensions « comprises entre 64 et 292 euros par mois », informe Yohan Auffret, directeur-adjoint à la Mutualité sociale agricole (MSA) d’Armorique, qui est en charge de la protection sociale des agriculteurs mahorais. « Cela n’incite pas à prendre sa retraite, et donc à libérer le foncier », argue-t-il. Sa directrice, Karine Nouvel, plaide alors pour l’octroi de points gratuits pour ces anciens, qui n’ont pu cotiser avant 2015 – date de la mise en place de la retraite de base pour les agriculteurs mahorais. « Le législateur doit s’emparer de cette problématique », abonde le directeur de la Daaf. « Sans retraite convenable, ils s’accrocheront à leur petit foncier qui constitue un moyen de subsistance minimum » Cela suffira-t-il à libérer les terrains ? « Attention, les Mahorais ont une relation particulière au foncier », modère Naïlane-Attoumane Attibou, le secrétaire général de la Fédération mahoraise des associations environnementales (FMAE). « Les terrains sont destinés à être transmis aux générations suivantes. Il est peu probable que les anciens qui ne sont plus en mesure de cultiver acceptent de les céder à l’extérieur de leurs familles respectives. »
Faut-il regarder plus loin ?
« Aujourd’hui, Mayotte importe principalement de l’hexagone, d’Argentine ou encore du Brésil… On doit s’améliorer là-dessus ! Pourquoi ne pas aller vers un développement régional de l’approvisionnement ? », questionne Stéphane Allard, directeur de la Chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte (Capam), et qui assistait à la table ronde depuis la Tanzanie, qu’il dit « prête à louer des terres agricoles sur lesquelles des agriculteurs mahorais ou tanzaniens pourraient s’installer pour cultiver à destination de Mayotte ». De son côté, le Conseil départemental rapporte travailler « avec Madagascar pour importer des fourrages déshydratés destinés à nourrir le bétail mahorais », et à l’importation de « races pures » pour « améliorer la génétique » des bestiaux locaux.
Une dimension environnementale à prendre en compte
Enfin, les échanges de jour étaient empreints de questions environnementales diverses. Ont été discutés, pêle-mêle, les défis posés par l’agriculture informelle (défrichement, exploitation de parcelles incompatibles – voir situées en zones protégées), l’utilisation de produits phytosanitaires « interdits en France, mais qui se retrouvent quand même dans nos assiettes », selon Soumaïla Moeva, ou encore le changement climatique et ses effets. « Nous approchons de la fin de la saison des pluies et les réservoirs sont vides ! », s’alarme le directeur de la Daaf, qui entrevoit « des temps particulièrement difficiles à passer ».
Du grain à moudre pour la délégation sénatoriale aux outre-mer, donc. « Nous voyons bien la nécessité d’adapter la législation aux spécificités du territoire », analyse Micheline Jacques, la sénatrice de Saint-Barthélémy, qui présidait la table ronde. Après trois heures d’échanges, l’ensemble des intervenants a été invité à transmettre leurs contributions complémentaires par écrit. « Nous émettrons un certain nombre de recommandations, enrichis de vos éclairages », a prévenu Thani Mohamed Soilihi.
Les participants de la table ronde
- Philippe Gout, directeur de la Direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Mayotte
- Enfanne Haffidou, DGA Économie et développement durable du Conseil départemental
- Saitu Said-Halidi, directeur de l’agriculture, des ressources terrestres et maritimes du Conseil départemental
- Yves-Michel Daunar, directeur général de l’Établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte (Epfam)
- Naïlane-Attoumane Attibou, secrétaire général de la Fédération mahoraise des associations environnementales
- Soumaïla Moeva, président du syndicat des jeunes agriculteurs de Mayotte
- Karine Nouvel, directrice générale de la Mutualité sociale agricole (MSA) d’Armorique
- Yohan Auffret, directeur adjoint de la Mutualité sociale agricole (MSA) d’Armorique
- Stéphane Allard, directeur de la Chambre d’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte (Capam)
- Thani Mohamed Soilihi, sénateur de Mayotte
- Vivette Lopez, sénatrice du Gard
- Micheline Jacques, sénatrice de Saint-Barthélémy
Quelques propositions fortes des intervenants
- Mise en place d’une commission de contrôle du morcellement des terres agricoles (Yves-Michel Daunar)
- Octroi de points gratuits pour inciter les agriculteurs à prendre leur retraite. Renforcer les obligations d’affiliation à la MSA (Karine Nouvel)
- Obligation de portage de projet agricole pour les zones faisant l’objet d’une revendication d’occupation coutumière auprès du Conseil départemental (Soumaïla Moeva)
- Création de villages agricoles pour faciliter la viabilisation des parcelles à forte potentialité, en mutualisant les moyens de luttes contre les vols (Soumaïla Moeva)