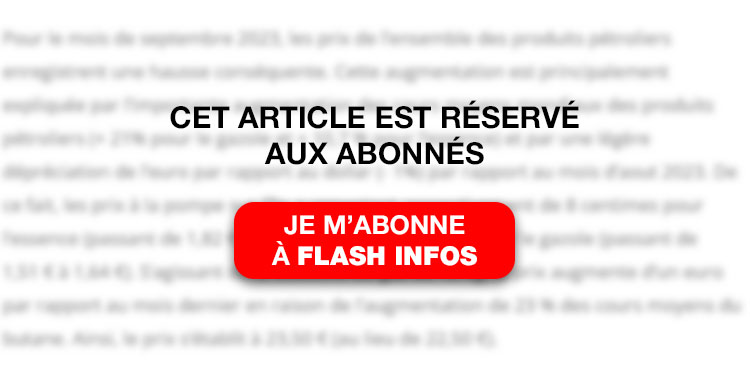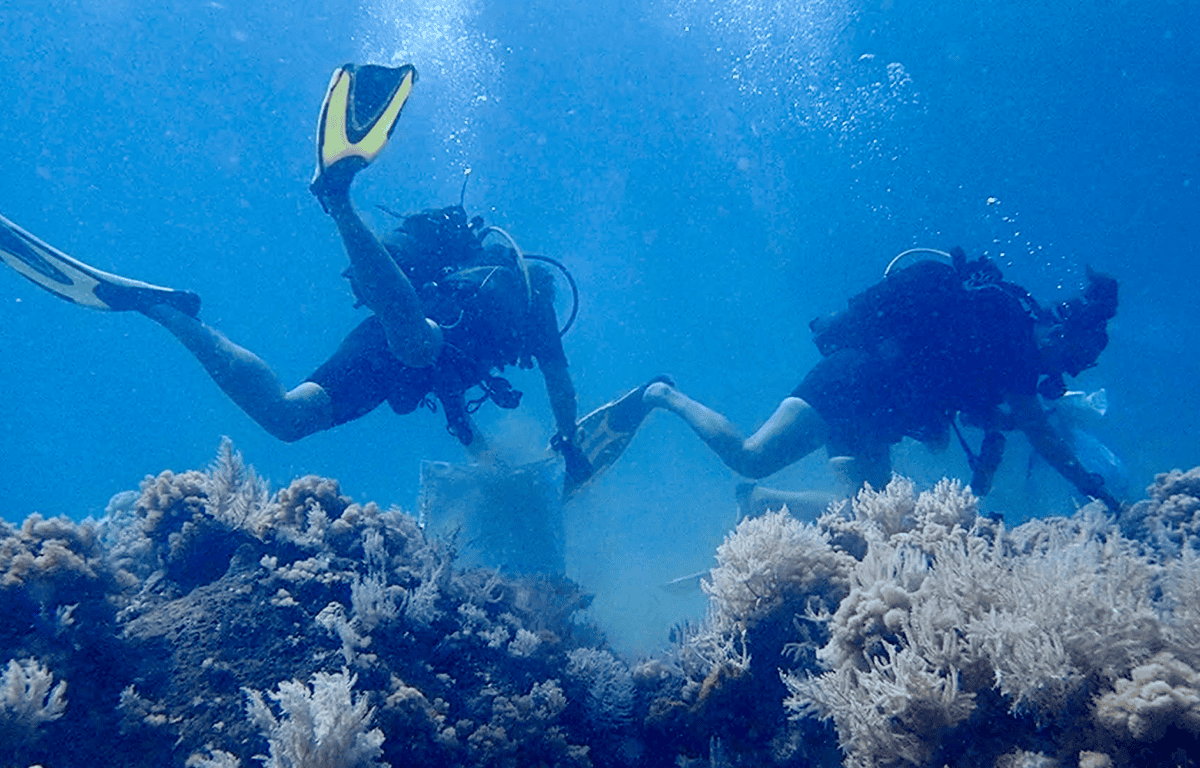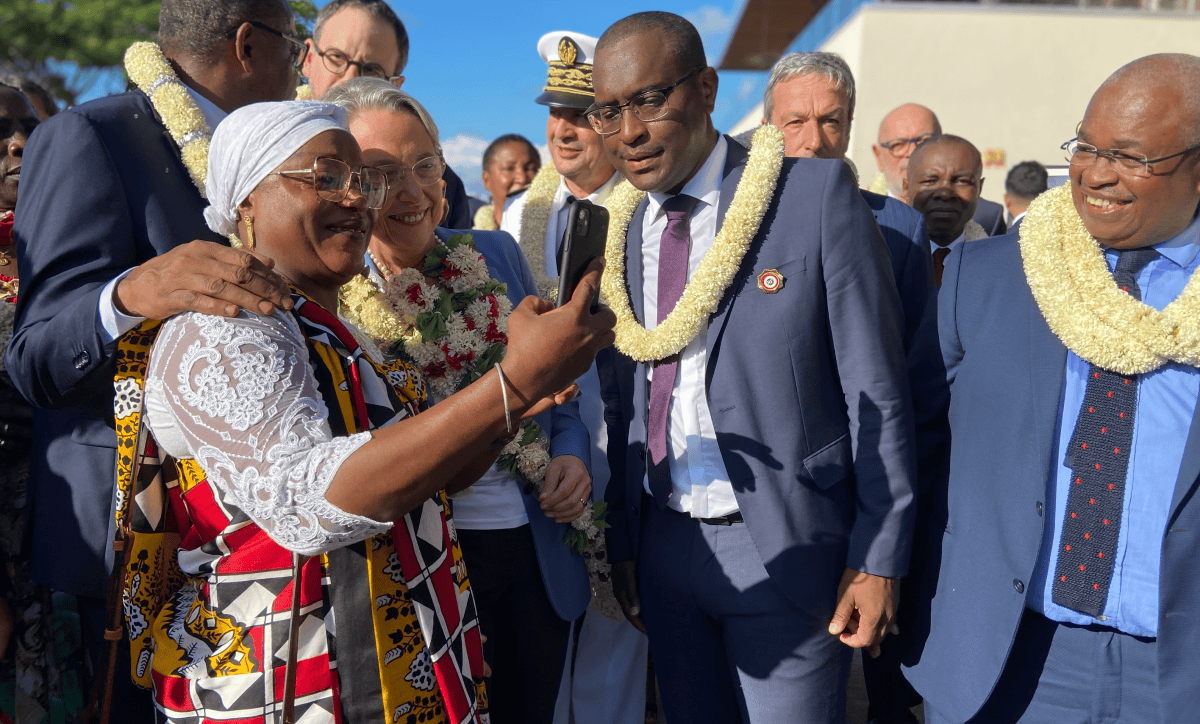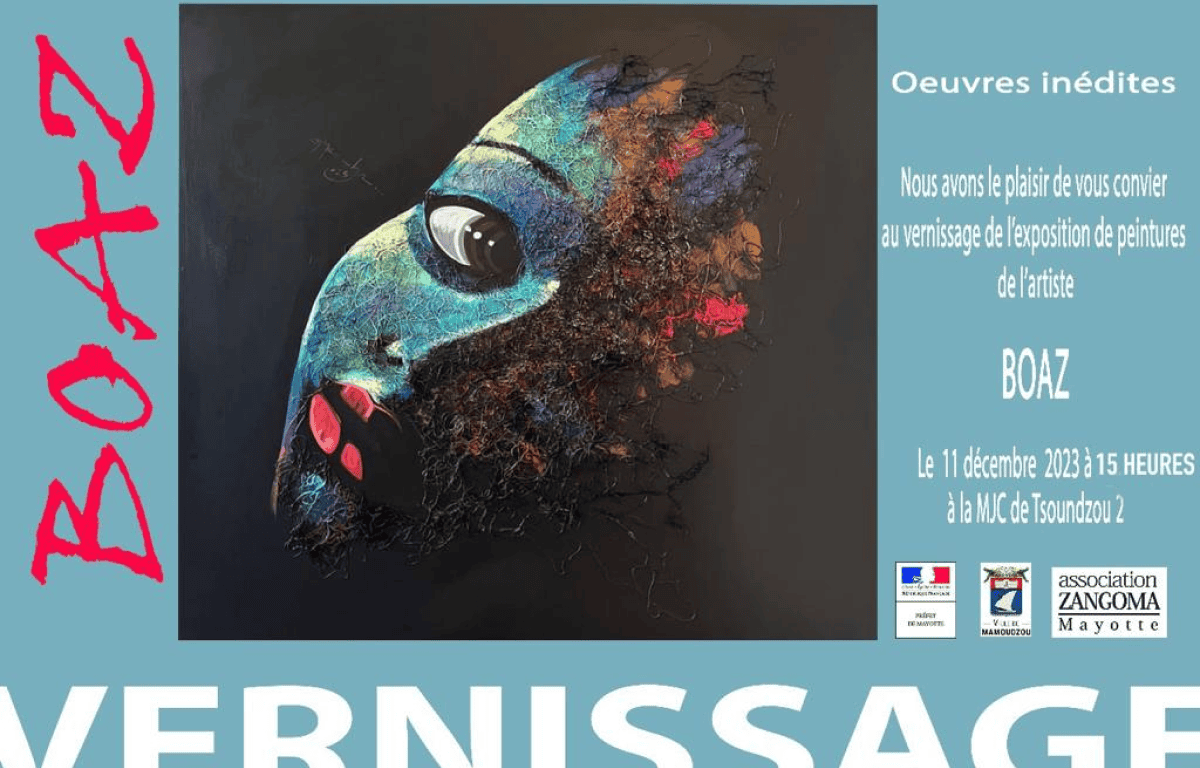Âgé de 23 ans, le jeune homme condamné à douze mois de prison avec sursis, ce mardi matin, par le tribunal correctionnel avait lancé un bâton à la tête d’un gamin de Dembéni, le 28 janvier 2023. La large entaille sur le crâne du garçon avait nécessité son évacuation à La Réunion et quinze points de suture.
Parlant avec aisance de son projet professionnel, le jeune homme présente bien à la barre du tribunal correctionnel de Mamoudzou, ce mardi matin. Pourtant, plutôt qu’être en formation pour devenir animateur, c’est au tribunal correctionnel de Mamoudzou qu’il se retrouve pour des faits datant du samedi 28 janvier 2023, à Dembéni. Ce jour-là, il croise avec ses deux chiens la victime âgée de 11 ans, dans la mangrove. Frêle, celui-ci prend peur et se réfugie dans un arbre. Le prévenu demande au garçon de descendre, ce dernier refusant, il prend alors un bâton d’une longueur d’un mètre et lui jette, le touchant au niveau du crâne. L’intervention d’un tiers va permettre de le sauver. « J’ai entendu des voix crier : [le prévenu], arrête de nous frapper ! », avait indiqué ce témoin, qui a nettoyé avec l’eau de mer le crâne tâché de sang. « Le jeune pleurait, il saignait beaucoup », poursuivait-il.
« Ma fille m’a appelé alors que j’étais au champ. Elle m’a dit que « Dhouli » était blessé », raconte au tribunal la mère du garçon. Pris en charge par les pompiers, il est transporté d’abord aux urgences de l’hôpital de Mamoudzou. Mais devant la gravité de sa blessure, il a été emmené à La Réunion. Il a fallu quinze points de suture pour refermer sa blessure nécessitant un ITT (interruption totale de travail) de 21 jours.
« Je l’ai touché sans le faire exprès »
Le prévenu concède avoir lancé le bâton, mais dément avoir visé la victime. Selon lui, il essayait de faire partir un chien d’une bande qui le menaçait et le bâton a touché le garçon « sans le faire exprès ». Une version que les juges peinent à croire. « Vous comprenez que ce n’est pas très clair. Les déclarations de l’enfant correspondent à celles du témoin », fait remarquer Virginie Benech, la présidente du tribunal correctionnel. Delphine Mousny, substitute du procureur de la République, met en évidence la personnalité du prévenu qui, d’un côté, n’a jamais eu de casier judiciaire, est impliqué dans l’associatif et se destine à la profession d’animateur, et de l’autre, un coup violent qui a emmené un garçon de onze ans à l’hôpital pendant plusieurs jours. Elle requiert douze mois de prison avec sursis, 70 heures de TIG (travail d’intérêt général) et une interdiction de port d’arme pendant cinq ans.
Le tribunal l’a suivie pour la durée de la peine. Il décide cependant que le sursis dépendra d’une obligation de travail, d’indemniser la famille et d’une interdiction d’entrer en contact avec le garçon. Il devra verser 2.000 euros de provisions à la mère de la victi
Affaire de l’Ireps : dix mois de prison avec sursis pour deux personnes
Le 31 octobre dernier, cinq individus comparaissaient devant la justice dans l’affaire de détournement de près d’1,5 millions d’euros octroyés à l’Instance régionale de l’éducation et promotion de la santé (Ireps). Si le chef d’inculpation de détournement de biens publics n’a pas été retenu, deux des cinq prévenus ont néanmoins été condamnés à dix mois de prison avec sursis pour prise illégale d’intérêts. Un premier voit sa peine assortie de 10.000 euros d’amende, d’une inéligibilité de cinq ans, ainsi que d’une interdiction de travailler dans une association pendant trois ans. Le deuxième écope également de 5.000 euros d’amende et d’une inéligibilité de deux ans. Ils devront, de plus, rembourser l’Ireps d’une somme qui sera fixée en juin 2024 lors d’une audience sur les intérêts civils.
Entre 2014 et 2021, 1,47 million d’euros de subventions données par l’Agence régionale de santé (ARS) à l’Ireps auraient été détournés. L’ARS s’était rendue compte de la supercherie en 2017, grâce à un audit réalisé dans le cadre du renouvellement de la subvention annuelle. Ce rapport d’observation montrait un fonctionnement « nébuleux » et de nombreux problèmes au niveau de l’utilisation des fonds : factures non numérotées, égarées, chèques en blanc, conflit d’intérêt ou encore notes de frais anormalement élevées. Les avocats de la défense avaient demandé la relaxe, qualifiant l’enquête de « lacunaire ». En effet, ils estimaient que l’enquête n’apportait pas assez de preuves à l’encontre de leurs clients. La procureure adjointe, Louisa Aït Hamou, était également allée en ce sens, requérant la relaxe pour une partie des cinq prévenus. Trois d’entre eux en ont finalement bénéficié.