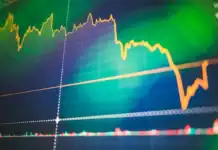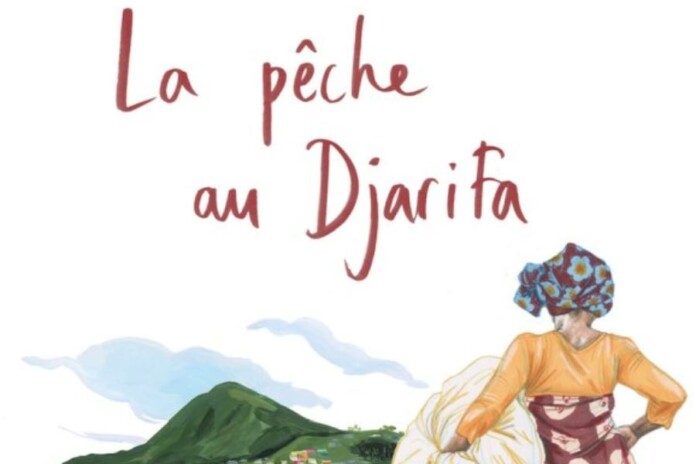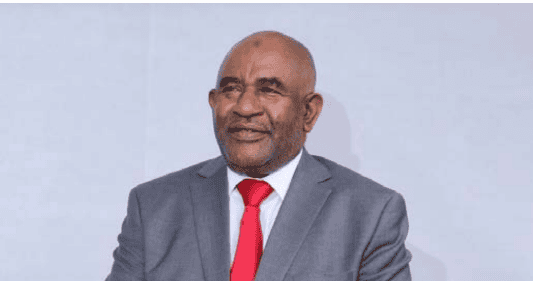La SMAE – Mahoraise des Eaux a dû procéder à une coupure technique de la distribution d’eau ce jour à partir de 11h ce mardi dans les secteurs de Chiconi Village, Ouangani Village, Tsararano, Hajangoua, Hamouro, Kahani, Ongoujou et Sada. Cela en raison des niveaux très bas des réservoirs de tête de ces secteurs. “Cette situation résulte de la mise à l’arrêt de la production de l’usine de l’Ourouveni pour effectuer les entretiens indispensables. Cet arrêt a provoqué la baisse en premier du niveau d’eau dans le réservoir de Chiconi puis le phénomène s’est propagé aux autres réservoirs dont les remplissages en dépendent”, précise la La SMAE – Mahoraise des Eaux dans un communiqué. Pour les villages de Hajangoua, Hamouro, Kahani, Ongoujou et Sada (villages en secteur 3), la réouverture s’est faite à partir de 18h.
Un nouvel appel à projets agricoles
L’Etablissement public foncier et d’aménagement de Mayotte (EPFAM) lance un appel à projet pour l’attribution d’une parcelle agricole de 2,03 hectares située dans la commune de Mamoudzou. Cet appel à projet est ouvert du 17 septembre au 15 octobre 2024. Une visite de la parcelle est prévue le jeudi 19 septembre à partir de 8h30 à la sortie de Passamainty, vers Vahibé, au niveau de l’atelier de menuiserie. Les candidats devront proposer des projets de productions agricoles (végétales et/ou animales) ou des projets en lien avec la production agricole. Le dossier de candidature est à télécharger sur le site de l’EPFAM (www.epfam.fr) ou à retirer en version papier dans les locaux de l’EPFAM (Boulevard Marcel HENRY, Cavani – 97600 Mamoudzou).
Le maire de Mamoudzou en live sur Facebook ce vendredi
Ce vendredi 20 septembre, le maire de Mamoudzou Ambdilwahedou Soumaïla sera en live sur la page Facebook de la Ville de 17h à 18h pour répondre aux questions de la population sur les projets de la collectivité tels que la propreté urbaine, les grands chantiers prochainement livrés, la circulation alternée ou encore l’excellence éducative et sportive. Les usagers ont la possibilité de poser leurs questions, envoyer leurs contributions ou remarques dès maintenant par message ou en commentaires sur les pages Facebook et Instagram Ville de Mamoudzou et par email à contact@mamoudzou.yt.
Référencer ses événements pour la Semaine de l’économie sociale et solidaire
Depuis 17 ans, le mois de l’économie sociale et solidaire (ESS) est devenu « le rendez-vous incontournable des citoyens, des étudiants, des salariés, des acteurs publics intéressés par les pratiques et les valeurs de l’économie sociale et solidaire », souligne la Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire. Il a pour vocation de faire découvrir l’ESS au travers de manifestations les plus diverses : conférences, forums, portes ouvertes, visites de structure, projections de films, formations. Ce mois constitue une vitrine des initiatives des acteurs de l’économie sociale et solidaire. Pour les associations employeuses, mutuelles, coopératives, fondations ou entreprises commerciales d’utilité sociale qui partagent les valeurs défendues par les entreprises de l’économie sociale et solidaire, il est possible d’inscrire ses événements organisés au mois de novembre. Le but : bénéficier ainsi d’une campagne de communication d’envergure nationale. Pour communiquer autour du mois de l’ESS, afficher son appartenance à l’ESS, inscrire un événement, contacter Chadadi Moussa, chargé de communication par téléphone au 06 39 99 18 95 ou par e-mail à : cmoussa@cress-mayotte.org.
Blocage de l’agence Issoufali ce samedi contre les prix des billets d’Air Austral
Ce samedi, une cinquantaine de personnes étaient présentes devant l’agence Issoufali, sur l’ancienne place du marché à Mamoudzou, pour manifester contre les prix jugés trop élevés des billets d’avion d’Air Austral. Vers 10h, les collectifs ayant appelé à cette manifestation ont fermé les locaux de l’agence Issoufali, partenaire de la compagnie aérienne. Ce mouvement a commencé le 14 août, avec une manifestation à l’aéroport. Les collectifs avaient demandé à Air Austral de revenir vers eux avec des propositions le 15 septembre, apparemment sans succès.
Le parquet donne des précisions sur la mort du jeune tué à Labattoir
Ce vendredi soir, le parquet a donné davantage de précision sur les circonstances de la mort du jeune homme décédé ce mercredi à Labattoir suite à une agression. Vers 18h ce jour-là, la brigade de gendarmerie de Pamandzi a été alertée d’une attaque au couteau ayant fait deux victimes, nées en 2009 et 2003, à Dzaoudzi-Labattoir. Une fois sur les lieux, ils ont découvert le plus jeune inconscient, qui a été immédiatement pris en charge et conduit au CHM de Pamandzi. Il est décédé à son arrivée à l’hôpital. Celui né en 2003 a pu rapidement quitter le centre hospitalier. L’enquête a tout de suite été confiée à la brigade de recherche de Koungou. L’identification de l’auteur présumé de l’agression, né en 2007 et inconnu de la justice, a été rendue possible par l’audition des premiers témoins. Le suspect s’est rendu à la gendarmerie et a reconnu avoir porté les coups, prétextant qu’il avait subi un vol et des agressions par les deux victimes. Une information judiciaire a été ouverte ce vendredi et le mis en cause mis en examen des chefs d’accusation de meurtre et de blessures volontaires avec arme ayant entraîné une ITT de moins de huit jours. Il a été placé en détention provisoire à l’issue de son interrogatoire de première comparution. Les investigations se poursuivent pour établir les circonstances exactes dans lesquelles les faits ont été commis.
Le tribunal administratif rejette les recours de Rachadi Saindou
Le tribunal administratif de Mayotte a rejeté les trois requêtes présentées par Rachadi Saindou contre les opérations électorales procédant à son remplacement à la présidence et au conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Dembéni-Mamoudzou (CADEMA), ainsi qu’au conseil municipal de Dembéni. Ayant été condamné à une peine d’inéligibilité de quatre ans en juin, le tribunal considère que le préfet était tenu de le déclarer démissionnaire d’office, chose qu’il a faite le 27 juin 2024 par arrêté. Ainsi, il est considéré que la Cadema et la commune de Dembéni ont pu procéder régulièrement au remplacement de Rachadi Saindou en tant que président, conseiller communautaire et conseiller municipal.
Des coupures d’eau dans le Nord en raison du niveau des réservoirs trop bas
Pour garantir la préservation du niveau du réservoir en tête de zone, la SMAE – Mahoraise des eaux a dû procéder à une coupure d’eau anticipée à M’tsahara, à 12h au lieu de 14h ce lundi. La remise en service se fera ce mardi à l’horaire habituel. Une coupure technique a également été mise en place à 12h à M’tsangadoua et M’tsamboro. La remise de l’eau était prévue le jour même, en fonction de l’état des réservoirs.
Une journée scolaire autour du sport et de l’inclusion ce mercredi
La Journée nationale du sport scolaire se tiendra ce mercredi 18 septembre à 10h30 à Sohoa. Cette rencontre mobilisera quinze établissements du second degré et cinq établissements médico-sociaux de l’île. Cet événement doit voir se dérouler plusieurs moments sportifs et d’inclusion des élèves en situation de handicap. “Nous espérons créer du lien entre les structures et rendre plus fluides les collaborations futures dans ce programme « sport partagé »”, écrit le rectorat dans un communiqué.
La pêche au djarifa à l’honneur des Journées européennes du Patrimoine
A l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, la mairie et la bibliothèque de Chiconi ont choisi de mettre à l’honneur la baie de la commune. Ce lieu est « emblématique de la commune où se pratique la pêche au djarifa, technique traditionnelle de pêche à l’aide d’un tissu en tulle, exclusivement pratiquée par les femmes mahoraises », souligne la Ville.
Des animations autour de cette pratique sont organisées le 21 septembre, la journée débute par un discours de bienvenue à 9 h à la bibliothèque, suivi par une grande pêche au djarifa de 9h30 à 11h30 avant un atelier cuisine poissons pêchés au djarifa et dégustation. A partir de 13h45, une exposition de reportage dessiné par Judith Gueyfier sera présentée ainsi qu’une exposition de photos d’espèces pêchées au djarifa.
En parallèle, un atelier d’écriture a été mis en place par l’Agence régionale du Livre et de la lecture (ARLL) auprès des jeunes. La consigne était d’écrire sur des souvenirs, de l’imaginaire, de la fiction et du fantastique autour de cette pêche. Ils ont été écrits à la fin du mois d’août. Les jeunes auteurs seront récompensés ce 21 septembre, la remise des prix est prévue à 15h. La journée s’achèvera à 15h30 par un moment de contes.
La première déchèterie fixe de Mayotte inaugurée
C’est une première sur l’île : Mayotte possède enfin sa première déchèterie fixe. Inauguré à Malamani, dans la commune de Chirongui, ce nouveau dispositif doit permettre à la population de se débarrasser gratuitement d’une grande variété de déchets.
“Mayotte propre peut être une réalité.” C’est l’espoir que partage Houssamoudine Abdallah avec l’ensemble des personnalités présentes ce vendredi matin, lors de l’inauguration de la première déchèterie fixe de l’île, à Malamani (Chirongui). Après quinze mois de travaux, le président du Syndicat intercommunal d’élimination et de valorisation des déchets de Mayotte (Sidevam) a présenté cette nouvelle installation au public venu en nombre, aux différents élus présents et au préfet de Mayotte, François-Xavier Bieuville. Ouvert six jours sur sept du mardi au dimanche de 8 h à 18 h pour permettre autant aux particuliers qu’aux entreprises de s’y rendre, ce nouveau site peut accueillir une grande variété de déchets en vue d’être traités ensuite par différents éco-organismes partenaires (Citéo, Star, Enzo Technic Recyclage, etc.). Il comporte cinq casiers pour cinq flux : un pour les déchets verts avec un broyeur, un pour la ferraille, un pour les encombrants (canapé, lit, etc.), un pour les déchets inertes comme les gravats, et un autre pour les produits chimiques type solvants, peintures. Mais ce n’est pas tout. La déchèterie comporte également un point de collecte classique (emballage, papier, verre), une benne pour les vêtements, mais aussi un espace pour le réemploi de l’électroménager par exemple.
Éviter les dépôts sauvages
“Avec une telle installation, nous allons pouvoir éradiquer les décharges sauvages”, se félicite le maire de Chirongui, Bihaki Daouda, qui espère que cette installation sera la première d’une série et qu’elle permettra de rendre le geste de tri automatique au sein de la population. “La gratuité de ce service est un symbole fort pour notre population. Cela va encourager le tri sélectif, et éviter les dépôts sauvages. C’est un investissement pour notre avenir et pour les générations futures”, commente le président de la Communauté de communes du Sud de Mayotte, Ali Moussa Moussa Ben.
La fierté est grande parmi l’ensemble des élus, le mot “révolution” est même brandi par le président du Sidevam, qui affirme que cette première étape n’est qu’un début. La construction de sept autres déchèteries est en effet prévue : à Longoni (Koungou), à Tsararano (dans la future ZAC de Dembéni), à Bandrélé, à Badamier (Dzaoudzi), à Hamaha (Mamoudzou), à Combani (Tsingoni) et à Dzoumogné (Bandraboua). “On espère lancer les travaux de la deuxième à Longoni d’ici le deuxième semestre de 2025”, précise Houssamoudine Abdallah, qui espère voir cette dernière sortir de terre avant la fin de son mandat à la tête du syndicat dans deux ans, une installation comme celle de Malamani nécessite six mois de travaux en temps normal sans les barrages. Si ce délai est en effet court, le principal obstacle dans la mise en place de ce type de projet est l’acquisition du foncier nécessaire.
“Une traduction de l’Europe à Mayotte”
Ce projet qui a mobilisé 3 millions d’euros et l’aide du Département qui a donné le foncier gratuitement, a également bénéficié du soutien de l’Union européenne. Un point que n’a pas manqué de souligner le préfet François-Xavier Bieuville lors de son intervention. “On a pu entendre dire que l’Europe ne servait à rien. Or c’est une traduction de l’Europe à Mayotte que nous avons ici aujourd’hui”, déclare-t-il, faisant allusion aux critiques qui ont pu être faites à l’encontre du travail de la Secrétaire générale pour les affaires régionales (Sgar), qui a pour mission de gérer les crédits européens. “Avec cet outil révolutionnaire, Mayotte s’aligne en entrant dans la modernité”, poursuit-il. Tous espèrent que ce nouveau dispositif permettra de développer l’économie circulaire avec le réemploi et d’œuvrer pour le développement durable de Mayotte.
À Sakouli, un premier poste de Maître-Nageur Sauveteur va voir le jour

A Sakouli, la première pierre d’un poste de Maître-Nageur Sauveteur a été posée ce vendredi. Une construction financée par l’Etat et la Communauté de communes du Sud de Mayotte dans le but d’éviter les accidents.
Sur la plage de Sakouli, dans la commune de Bandrélé, la pancarte “Baignade interdite” est bientôt révolue. Ce vendredi 13 septembre, le président de la Communauté de communes du Sud (CCSud) de Mayotte, Ali Moussa Moussa Ben, la 5ème vice-présidente du conseil départemental, Zamimou Ahamadi, et la secrétaire générale pour les affaires régionales (Sgar) au sein de la préfecture de Mayotte, Maxime Ahrweiller Adousso, ont posé la première pierre du futur poste de Maître-Nageur Sauveteur (MNS) afin d’assurer une zone de baignade surveillée. “Un moment historique”, affirme le président de la CCSud. Les travaux devraient s’achever en 2025 et permettre à Mayotte d’avoir son premier MNS.
Un coût avoisinant le million d’euros
Le coût total de la construction de ce poste s’élève à 960.854 euros ; 46% des frais sont apportés par l’intercommunalité et 36% par l’Etat. Ce poste de Maître-Nageur Sauveteur sera aussi accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR). Des locaux qui devraient aussi abriter des sanitaires. Pour donner suite aux travaux de réfection de la voirie en 2022 qui permettent d’accéder plus facilement à la plage, d’autres aménagements sont prévus : des aires de jeu, des farés, des tables de pique-nique ou encore des espaces de voulé. Ces travaux devraient renforcer l’attractivité de la plage.
Éviter des drames
La plage de Sakouli a connu plusieurs drames ces dernières années. En 2020, un homme de 19 ans est mort en tentant de s’y baigner. En 2019, c’est une jeune fille qui s’est noyée en mer. En 2017, un jeune homme parti secourir des enfants à la dérive a perdu la vie. Ali Moussa Moussa Ben admet avoir accélérer l’idée de cette construction après ces pertes successives, en espérant que ce premier poste de Maître-Nageur Sauveteur pourra permettre de sauver des vies.
Les travaux de l’éco-quartier Tsararano-Dembéni ont commencé

Ce vendredi 13 septembre, les travaux de la Zone d’Aménagement concertée qui reliera Tsararano à Dembéni ont été lancés avec la pose de la première pierre. Une cérémonie s’est tenue en présence de Moudjibou Saidi, maire de Dembéni et président de la Communauté d’agglomération Dembeni-Mamoudzou (Cadema), de Raynald Vallée, président du conseil d’administration de l’Etablissement public foncier et d’aménagement de Mayotte (Epfam), d’un représentant du conseil départemental et de François-Xavier Bieuville, Préfet de Mayotte. Le projet comprend 2.600 logements dont 1.500 construits d’ici 2027, trois groupes scolaires, un city-stade pour un budget total de 112 millions d’euros.
La première tranche des travaux débutera en octobre-novembre 2024. Elle verra la construction à Tsararano de 160 logements par Action logement Mayotte, le relogement de 40 familles, une moyenne surface alimentaire et des commerces de proximité, des bureaux, un nouveau terrain de football et un plateau sportif. La seconde tranche démarrera en 2025 sur le secteur de Dembéni.
Comores : Le décès de l’agresseur d’Azali suscite des interrogations

Ce vendredi après-midi, le président de l’Union des Comores, Azali Assoumani, a été la cible d’une agression au couteau. Placé dans une cellule, le suspect a été retrouvé mort le lendemain matin. Le jeune homme mis en cause était âgé de 24 ans, selon le parquet de Moroni, qui a annoncé l’ouverture d’une enquête, dans le but d’élucider notamment les circonstances de la mort de l’assaillant, lequel n’a pas pu être auditionné, avons-nous appris auprès de la justice.
L’archipel est en ébullition après l’attaque visant le président de l’Union des Comores. Dans l’après-midi du vendredi 13 septembre, un homme armé d’un couteau de cuisine s’en est pris à Azali Assoumani, le touchant à la tête, à Salimani Itsandra, localité située à quelques kilomètres de Moroni. L’attaque a été commise alors que le président comorien, dont la réélection en janvier est contestée, prenait part aux funérailles d’un proche du mufti de la République, plus grande autorité religieuse du pays. Au cours d’une conférence de presse tenue samedi matin à la présidence, le gouvernement, par la voix du ministre de l’Energie, a assuré que le chef de l’Etat n’a pas été grièvement blessé. « Il se porte bien et il est hors de danger. Le président se trouve chez lui. Et son état ne nécessite pas une évacuation. S’il part à l’étranger, ce sera pour des missions« , a rassuré Aboubacar Said Anli qui, au passage, a salué la bravoure et le courage du civil qui s’est interposé pour sauver Azali Assoumani.
Sur les réseaux sociaux, cet agent de la Société comorienne des hydrocarbures (SCH), un proche du religieux décédé, a subi plusieurs insultes pour avoir empêché l’agresseur d’atteindre le président de la République, dont la popularité est remise en question par une partie de la population. Les chances de connaître les motivations de l’assaillant s’amenuisent pour ne pas dire qu’elles sont inexistantes. D’après le procureur de la République, Ali Mohamed, qui a animé une conférence de presse samedi 14 septembre depuis son bureau, le jeune homme est décédé durant sa détention. Il s’agit d’un gendarme de 24 ans, originaire de Salimani Itsandra.
“Cette situation soulève des questions”
Sa hiérarchie lui avait accordé une permission de 24 heures, depuis le 11 septembre, mais il n’a jamais repris du service. « Une fois maîtrisé par la sécurité du président, il a été remis aux enquêteurs qui ont décidé de le laisser dans une cellule. Le lendemain, ils l’ont retrouvé gisant au sol, son corps inanimé. Un médecin a été appelé et c’est lui qui a constaté le décès« , a raconté le chef du parquet de Moroni, confirmant que l’agresseur n’a pas pu être auditionné. Le magistrat a enfin annoncé l’ouverture de deux enquêtes. Une première pour découvrir les motivations à l’origine de cette agression. La seconde consiste à élucider les circonstances de la mort du gendarme dans sa cellule. Mais en attendant la fin des investigations, des voix commencent à émettre des doutes quant à la version officielle soutenue par la justice.
Pour une partie de l’opinion, la mort du jeune, moins de 24 heures après son acte, semble suspecte. « Nous condamnons la tentative d’assassinat, qui ne peut en aucun cas être justifiée. Cependant, nous ne pouvons pas ignorer le fait tragique que ce jeune homme âgé de 24 ans est décédé en détention quelques heures après l’incident. Cette situation soulève des questions graves sur le traitement des personnes en détention et l’usage de la force par les autorités« , relève le nouveau parti Ushe, dans un communiqué. Il faut noter que ce n’est pas la première fois qu’un détenu meurt dans des conditions douteuses. En avril 2021, un ancien major de l’armée qui était à la retraite, surnommé Bapale, avait lui aussi rendu l’âme alors qu’il subissait un interrogatoire, dans un camp militaire à Anjouan. On le soupçonnait de faire partie d’un groupe qui voulait déstabiliser le pays. A l’époque, l’actuel directeur de cabinet chargé de la défense, Youssoufa Mohamed Ali, avait nié les accusations de tortures portées contre le régime. Le gouvernement, pour prouver sa sincérité, a dans la foulée promis une enquête. Trois ans plus tard, personne ne sait ce qui est arrivé à Bapale, qui fut garde du corps de l’ex-président Ahmed Abdallah Sambi.
Plusieurs décès suspects en détention
En mars 2023, un jeune de 24 ans, nommé Aymane Nourdine, est également décédé pendant sa garde à vue. Le parquet avait évoqué un malaise. Pourtant, selon des témoins, son corps présentait des traces de sévices corporels. Mais là encore, il n’y a jamais eu de suite. Ces exemples viennent conforter la thèse que défendent de nombreux Comoriens qui considèrent que les circonstances de la mort du gendarme assaillant ne seront probablement pas connues. Aucune audition des enquêteurs qui le surveillaient n’a été annoncée par la justice. En conférence de presse samedi, le gouvernement a dénoncé le comportement de certains internautes qui se réjouissent de l’agression visant le chef de l’Etat, dont la réélection en janvier dernier a entraîné des manifestations qui ont fait un mort.
Depuis juillet, l’ex-putschiste de 65 ans se retrouve au cœur d’une autre polémique après la nomination de son fils aîné comme secrétaire général du gouvernement. Des critiques qui se sont accentuées lorsque le 6 août, un décret est venu élargir les pouvoirs de celui-ci. Mais en dépit du tollé suscité par cet acte, la récente attaque dont il a été victime, n’a pas réjoui tous ses opposants. « La violence politique n’a pas sa place dans notre société car la violence politique n’est jamais acceptable, y compris les forcings antidémocratiques. L’essence et le but de nos démocraties est que nous puissions exprimer nos opinions, débattre de nos désaccords et les résoudre pacifiquement« , a réagi l’ex-candidat à la présidentielle, Mohamed Daoudou. « Cet acte traduit le climat de terreur, de violence qui a atteint un niveau anormalement élevé, inhabituel et préoccupant aux Comores. Il reflète aussi et surtout la situation du désarroi social et psychologique d’une population laissée en déshérence« , accuse l’opposant et avocat Larifou Said, qui appelle à une prise de conscience collective de la situation politique pour espérer un retour à l’esprit d’apaisement. Désormais, le débat public se penche sur la mort de l’assaillant, inhumé entre 17h et 18h ce samedi, dans sa localité natale. A l’heure où nous écrivons ces lignes, le gouvernement n’avait pas réagi au décès suspect qui serait survenu le vendredi soir, selon nos sources.
Le président de l’Union des Comores victime d’une agression à l’arme blanche
Azali Assoumani, le président de l’Union des Comores, a été victime d’une agression à l’arme blanche ce vendredi après-midi, alors qu’il assistait à des funérailles. Pris en charge rapidement par les secours, son pronostic vital ne serait pas engagé. L’auteur des coups à été rapidement interpellé par les militaires.
La Journée du vivre-ensemble ce samedi à Mamoudzou
La Ville de Mamoudzou organise la troisième édition de la Journée du vivre-ensemble ce samedi 14 septembre dans les nouveaux locaux du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). Cet événement a pour but de rassembler les citoyens de Mamoudzou autour de sujets de société. Elle permettra également d’en savoir plus sur l’accès aux droits et les actions en faveur de la solidarité mises en place dans la commune. Différentes activités rythmeront cette journée afin de favoriser la cohésion sociale à travers d’animations culturelles.
Elles se déroulent au bâtiment du CCAS, rue Foundi Moinecha Mognédaho, à 08h00 : accueil du public, 8h30 : discours, 9h00 : visite du nouveau bâtiment du CCAS et présentation de la téléassistance, 10h00 : ouverture des stands sur la thématique de l’accès aux droits.
Sur la place de la République, des chants traditionnels debaa se produiront de 15h à 18 h et un dinahou aura lieu de 20h à 22h.
Marine nationale : Ils ont répondu à l’appel de la mer et au goût de l’aventure
Un contrat de deux ans renouvelable une fois, une multitude de carrières intéressantes possibles au sein des forces armées françaises. Deux jeunes Mahorais de 19 ans ont eu la chance d’intégrer la Marine nationale ce jeudi matin au cours d’une cérémonie solennelle organisée au sein de la base navale de Mayotte à Dzaoudzi où ils ont été accueillis avec leurs parents par le commandant de la place, le capitaine de frégate François-Xavier Pilven.
La base navale de Mayotte (sur le rocher de Dzaoudzi) a vécu un moment intense en émotion ce jeudi matin avec la signature – pour la première fois localement – de contrats d’engagement au profit de deux jeunes Mahorais, Ahamada Nathan Belkassem et Houmadi Farouk (respectivement originaires de Kani-Kéli et Dzaoudzi-Labattoir). Âgés de seulement 19 ans, ils ont officiellement intégré les rangs de la Marine nationale française, à la grande satisfaction du commandant de la base navale, le capitaine de frégate François-Xavier Pilven.
“Un métier qui continuera à vous structurer”
Cette brève cérémonie marque un nouveau point de départ pour notre département car si la Marine nationale compte en son sein de nombreux éléments originaires de son sol, il leur a fallu se trouver dans l’hexagone ou sur l’île voisine de La Réunion pour réussir à se faire recruter. Pour ne prendre que l’exemple de la base navale située sur le rocher de Dzaoudzi, une quinzaine de militaires (sur un effectif total de 50) sont des natifs du territoire qui ont demandé à y être affecté pour se rapprocher de leurs familles ou servir dans leur île natale pendant un certain temps. « Aujourd’hui c’est quelque chose d’un peu inédit, vous ouvrez un petit peu le chemin qui doit inciter, je l’espère, un grand nombre de jeunes Mahorais à s’engager dans les armées, à s’engager dans la Marine », a déclaré le capitaine de frégate aux désormais nouveaux marins.
Aux parents venus accompagner leurs enfants et vivre avec eux cet instant solennel, il leur a adressé ses chaleureux remerciements pour l’éducation structurante qu’ils leur ont offerte et sans laquelle ils n’auraient pas choisi cette voie. « Un métier qui continuera à vous structurer quel que soit votre avenir. Là, vous mettez un premier pas dans l’institution, dans la Marine, dans les forces armées, ça va être pour vous une occasion de découvrir un métier extraordinaire, ou un métier ordinaire dans un cadre extraordinaire ». Une manière pour le commandant de la base navale de Mayotte de faire comprendre aux deux futurs quartier-maîtres qu’ils auront la possibilité d’apprendre des métiers existants dans le civil ou d’autres plus spécifiques aux forces armées.
L’espoir d’une carrière militaire
Pour Ahamada Nathan Belkassem, c’est avec une très légère pointe de regret qu’il tourne la page de sa vie civile. L’appel de la mer et le goût de l’aventure ont su motiver sa décision d’intégrer la Marine nationale, soutenu dans cette démarche par sa mère. Il désire embrasser une longue carrière de mécanicien et pourquoi pas se donner les moyens de suivre les formations en vue de gravir les échelons pour devenir un jour officier. Houmadi Farouk attendait impatiemment de pouvoir parapher son contrat d’engagement. Lui, à l’inverse de son collègue, a connu un parcours qui l’a tout naturellement conduit à choisir de devenir marin. Il a fréquenté deux années durant le centre de formation maritime à Dzaoudzi, ce qui lui a procuré une envie d’approfondir ses connaissances en apprenant un autre métier dans la Marine. Son rêve est de se retrouver un jour sur la passerelle d’un bateau entouré d’instruments de navigations high-tech. Il désire ardemment commander un navire au cours de sa future carrière militaire. Les deux jeunes marins prendront l’avion ce samedi pour Paris, d’où ils rejoindront la grande base navale de Toulon (Var) avant d’intégrer dès dimanche soir le pôle école Méditerranée à Saint-Mandrier pour quatre semaines de formation initiale préalable à une affectation.
Semaine de l’innovation : “Mettre en lumière les initiatives innovantes sur le territoire”

Du 17 au 20 septembre, la Semaine de l’Innovation revient après une première édition réussie en 2023. Cette année, l’accent est mis sur la transition écologique. Les projets les plus innovants pourront à nouveau recevoir un accompagnement, grâce au concours Innov’action 976.
Pas d’innovation sans transition écologique
La Semaine de l’Innovation revient pour une deuxième année consécutive sur le territoire mahorais. Organisée par l’Agence de développement et d’innovation de Mayotte (Adim), cet événement se tient du 17 au 20 septembre. Cette édition étant placée sous le thème de la transition écologique, le mardi sera consacré à la présentation de projets innovants notamment dans le domaine de l’énergie, de 9h à 16h, au siège de la CCI (Chambre de commerce et d’industrie) à Mamoudzou, sur invitation. “On a souhaité faire un gros focus sur la transition écologique, car on n’envisage pas le développement économique sans le respect de l’environnement”, déclare Soumaya Soulaimana, responsable innovation à l’Adim, qui est en charge de la semaine. Les programmes de financement pour les initiatives novatrices et dans le sens du développement durable seront également présentés. Plusieurs tables rondes auront lieu pour favoriser les échanges. “Le but de cette semaine est vraiment que les différents acteurs se rencontrent, qu’ils puissent faire écosystème, et favoriser aussi les partenariats publics privés”, développe l’organisatrice.
Le concours Innov’action 976 de retour
Les 18 et 19 septembre et la matinée du 20 septembre seront notamment consacrés au concours Innov’action 976. La compétition se déroulera au Pôle d’excellence rurale (PER) de Coconi, à Ouangani. À partir de 13h, le mercredi, les différents candidats présenteront leurs projets. De 8h à 16h le jeudi, les participants présélectionnés seront coachés par des experts et des entrepreneurs pour affiner leurs projets. De 9h à 12h le vendredi, ils devront présenter leurs pitchs finaux et cinq lauréats seront sélectionnés. Ils bénéficieront d’un accompagnement par des experts de Schoolab pendant six mois pour développer leurs idées. Chacun recevra une subvention de 10.000 euros. “Nous voulons mettre en lumière les initiatives innovantes sur le territoire”, insiste Soumaya Soulaimana. Les inscriptions pour le concours sont ouvertes jusqu’au samedi 14 septembre à minuit, sur la plateforme du conseil départemental, qui soutient l’événement.
Les portes de la Technopole de Dembéni s’ouvrent
Le vendredi après-midi, de 14h à 16h, sera consacré aux portes ouvertes de la Technopole de Dembéni, dans le but d’offrir aux visiteurs un aperçu des services, équipements et projets de recherche voués à être hébergés sur le site. Une nouveauté pour cette deuxième édition. Ce lieu est en effet destiné à accompagner des entreprises mahoraises en mettant à leur disposition du matériel et des laboratoires pour renforcer leur potentiel technologique. Une incarnation architecturale de cette semaine dédiée à l’innovation.
Infos pratiques : Mardi 17 septembre : 9 h à 16 h à la CCI de Mamoudzou. Mercredi 18 septembre : à partir de 13h au PER de Coconi. Jeudi 19 septembre : de 8h à 16h au PER de Coconi. Vendredi 20 septembre : de 9h à 12h au PER de Coconi et de 14h à 16h à la Technopole de Dembéni. Pour s’inscrire au concours Innov’action 976, il faut se rendre sur le site : https://lecd976soutientmonprojet.fr. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au samedi 14 septembre 2024 à minuit.
Un multirécidiviste condamné à douze ans de prison pour tentative de meurtre

La cour d’assises de Mayotte a prononcé, ce jeudi 12 septembre, une peine de douze ans de prison à l’encontre d’un homme, auteur multirécidiviste de violences, pour tentative de meurtre en 2020 à Cavani. Aujourd’hui âgé de 23 ans, il avait roué de coups au visage un ressortissant burundais, provoquant des lésions au cerveau et une infirmité permanente chez la victime.
Une peine de douze ans de prison ferme a été prononcée à l’encontre de Fahadi Abdou Chef, ce jeudi 12 septembre. Depuis mercredi, cet homme de 23 ans comparaissait devant la cour d’assises de Mayotte pour tentative de meurtre et violences en réunion sur un individu né au Burundi. Le 11 septembre 2020 dans la soirée, un groupe de cinq personnes jettent des pierres sans raison apparente sur deux Burundais dans le quartier de Cavani (Mamoudzou). L’un d’eux tombe au sol, Fahadi Abdou Chef lui porte alors des coups répétés à la tête et lui écrase le visage avec le talon. La victime se retrouve gisant dans une flaque de sang, les premiers témoins de la scène le croient mort. Ces blessures provoquent un traumatisme crânien grave chez la victime, qui souffre aujourd’hui d’une infirmité permanente.
Fahadi Abdou Chef était donc jugé mercredi et jeudi pour tentative de meurtre et violences en réunion. Le jury a décidé de le condamner à douze années d’emprisonnement, avec interdiction de porter une arme pendant cinq ans et interdiction de quitter le territoire français.
« L’intention de commettre un homicide ressort clairement »
Une peine qui correspond aux réquisitions de l’avocat général, Yann Le Bris. Dans son réquisitoire, ce dernier a insisté sur « l’agression incompréhensible qui a saccagé la vie de la victime en quelques minutes. Le 11 septembre 2020, cette dernière, âgée de 33 ans, avait des projets, des espoirs, des amis. Le 12 septembre, tout cela s’est envolé. Désormais, il vit au ralenti en ayant perdu toute vitalité physique ».
« L’intention de commettre un homicide ressort clairement », selon le représentant du ministère public, à la fois « dans la répétition des coups, dans leur violence et aux endroits où ils ont été portés. » Il analyse l’agression de ce soir-là « presque comme une suite logique » dans le parcours de l’individu, « comme un refus de prendre en compte les avertissements judiciaires » alors qu’il a été condamné à sept reprises. Des condamnations très proches dans le temps. En août 2018, il est jugé pour vol avec violence, en septembre 2018 pour vol en réunion, en novembre 2018 pour violence sur personne chargée de l’autorité publique, en novembre 2018 encore pour violence aggravée par deux circonstances etc. L’avocat général estime que la prison ferme est la réponse la plus adaptée au comportement de l’individu : « Dans le cas de profils comme ce garçon, quand la justice leur a tendu la main, ils ont pu avoir la capacité de se transformer ».
« La seule école qu’il a connue c’est la rue »
De son côté, Maître Soumetui Andjilani, l’avocat de la défense, considère que l’intention de perpétuer un homicide n’est pas clairement établie. « Voulait-il le tuer ? Non, moi je veux répondre « non » à cette question. Il n’y a pas assez d’éléments dans le dossier qui permettent de prouver cela ». Dans sa plaidoirie, il décrit un jeune garçon qui a connu « l’hostilité du quartier de Cavani », son profil lui rappelle celui de nombreux autres jeunes également « entrés dans le moule de la délinquance ». « Fahadi Abdou Chef n’avait pas assez d’argent pour se nourrir, alors il a rejoint la bande de Cavani », justifie-t-il. A la mort de sa grand-mère, alors qu’il avait 13 ans, « la seule école qu’il a connue, c’est la rue ». Tandis que l’intéressé se trouve en détention provisoire depuis quatre ans, son avocat déclare « c’est déjà beaucoup. La prison ne construit pas un homme ». Du fait des quatre années déjà purgées, il reste aujourd’hui huit années de prison à Fahadi Abdou Chef.
Comores : Six passeurs de migrants jugés devant le tribunal correctionnel
Deux passeurs sont poursuivis pour homicide involontaire après le décès de passagers qui voulaient rejoindre Mayotte. Une seconde affaire implique en revanche des prévenus qui auraient participé à l’hébergement de ressortissants d’Afrique des Grands Lacs que l’Etat s’apprête à expulser. Le délibéré pour les deux dossiers sera connu le 10 octobre prochain.
Le tribunal correctionnel de Moroni a jugé six personnes ce jeudi 12 septembre, poursuivies pour des faits de trafic illicite de migrants. La première affaire concerne quatre Comoriens accusés d’avoir aidé des continentaux à entrer illégalement sur le territoire de l’Union des Comores. Le 22 août, 24 migrants qui seraient originaires essentiellement du Burundi et de la République Démocratique du Congo, ont été débarqués sur une plage de Vanamboini, une localité située à plus de 10 km de la capitale, Moroni.
Selon le chef du parquet, Ali Mohamed Djounaid, ce n’est qu’une semaine plus tard que les autorités apprennent leur arrivée. D’où la comparution des quatre personnes soupçonnées d’avoir porté assistance à ce groupe de personnes qui voulaient rejoindre Mayotte. A la barre se trouvaient le propriétaire de la maison qui les accueille jusqu’alors, mais aussi celui qui est allé demander les clés de la résidence sise à la plage, et l’autre prévenu anjouanais qui était en contact avec le boss burundais. Ce dernier a reconnu devant les jurés avoir reçu un coup de fil depuis le Burundi pour partir à la recherche de migrants arrivés à la Grande Comore. « J’ai ainsi exigé que l’on m’envoie treize personnes, seulement des hommes. Je ne voulais pas d’enfants ni de femmes dans le contingent. Ils sont venus à Anjouan et j’ai trouvé un endroit où les héberger. Et le quatrième jour après leur venue, j’ai été arrêté« , a-t-il indiqué, devant le tribunal.
“Je suis juste venu en aide à des personnes en détresse”
Le même homme, inculpé pour trafic illicite de migrants a admis qu’il a reçu 3.000 euros (1,5 million de francs comoriens) pour accomplir le travail. Il a utilisé une partie de cet argent pour l’achat de moteurs, lesquels ont été confisqués, d’après lui, par les forces de l’ordre. Ce passeur anjouanais dit avoir aussi accepté la mission pour subvenir aux besoins de sa famille. Pour le moment, le reste des migrants est pris en charge par l’Etat qui cherche un moyen de les renvoyer chez eux, à en croire le parquet de Moroni.
Devant les jurés, le père de famille qui s’est approché en premier des migrants s’est défendu de toute implication en tant que complice et a juré qu’il n’a touché aucun argent en contrepartie. « Je suis juste venu en aide à des personnes en détresse, parmi lesquelles des enfants âgés entre 3 et 7 ans« , a-t-il martelé. Un argument repris par son avocat, Maître Youssouf Imani, qui a mis en avant le côté humanitaire de son client, pour réclamer sa relaxe, après la prononciation des réquisitoires du parquet. Le ministère public a en effet cité la nouvelle loi sur le trafic illicite de migrants votée en juin dernier et promulguée un mois plus tard, pour demander la condamnation des prévenus. Le parquet s’est appuyé sur près de quatre dispositions qui répriment le trafic lui-même, mais également toute complicité, fait qui inclut l’hébergement de personnes entrées illégalement sur le territoire. Le ministère a ainsi requis des peines de trois ans de prison ferme pour les quatre prévenus, assorties d’une amende de 20 millions de francs comoriens, soit 40.000 euros chacun. Le délibéré est attendu le 10 octobre prochain. C’est ce jour-là que le sort de deux autres passeurs qui comparaissaient ce jeudi sera connu.
Un trafic de cigarettes
Les deux hommes risquent jusqu’à 10 ans de prison ferme, si le tribunal suit le réquisitoire du parquet. A l’origine de leur inculpation, les décès survenus en 2019 et 2021 de passagers (des Comoriens) qu’ils transportaient à Mayotte. Ce n’est pas tout. D’autres charges concernant du trafic de cigarettes et de stupéfiants les visent également. Pour les traversées, les deux hommes ont d’abord nié avoir aidé à conduire depuis 2011 des passagers à Mayotte, a précisé l’un d’eux. « La deuxième fois c’est au début de 2024 quand le président de l’assemblée, Moustadroine Abdou, m’a sollicité pour faciliter le transport de quatre personnes à Mayotte, dont un blessé lors d’un accident de circulation dans le cadre des travaux de réfection des routes à Anjouan« , a clarifié le père de dix enfants. Son coaccusé, a reconnu pour sa part qu’il lui est arrivé de rechercher de temps en temps des clients en particulier ceux de son village pour les confier à des commandants de kwassa-kwassa.
Au terme des débats, le ministère public a demandé des peines allant de 5 à 10 ans de prison et une amende de 5 millions de francs comoriens (10.138 euros) pour chacun. Dans leurs plaidoiries, les avocats de la défense, dont Maître Fahmi Saïd Ibrahim, ont jugé les réquisitoires sévères. « La qualification est erronée car on ne peut pas parler de trafic pour le transport des Comoriens vers Mayotte. Vous savez, depuis l’indépendance, il y a eu cinq constitutions, elles stipulent toutes que Mayotte est comorienne. A cela s’ajoutent 22 résolutions des Nations Unies qui abondent dans le même sens. Il faut être cohérent. Je suis choqué que le parquet, gardien de droit, poursuive des Comoriens pour un trafic de personnes« , a déploré l’avocat Fahmi Saïd.
Céta’Maoré organise un comptage de baleine dimanche
L’association mahoraise de protection des mammifères marins Céta’Maoré en appelle aux bénévoles ce dimanche 15 septembre pour participer à une journée synchronisée de comptage des baleines à bosse. Le rendez-vous est donné à deux points stratégiques de l’île : au bord du lac Dziani de Petite-Terre pour couvrir l’Est ou au Mont Chiconi pour couvrir l’Ouest. L’évènement, organisé avec IndoCet Consortium, peut durer toute la journée en fonction du nombre de bénévoles. Pour les conditions de participation, se rendre sur la page Facebook de l’association à l’adresse suivante : https://www.facebook.com/cetamaore.