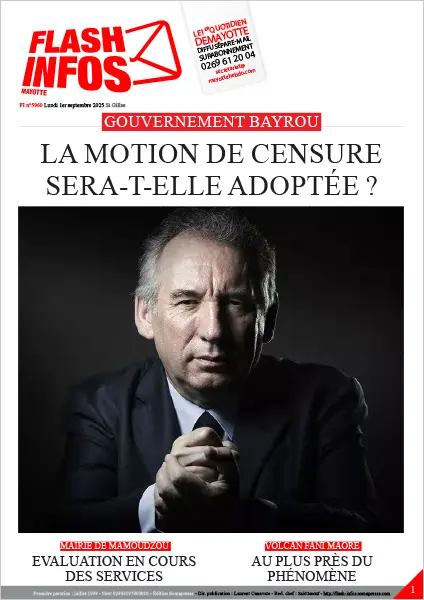Les parents d'élèves de l'école primaire Combani 2 à Miréréni ont exprimé leur ras-le-bol mercredi matin en cadenassant l'entrée de l'école. Alertés par l'équipe enseignante et la femme de ménage, les parents se sont élevés contre la mairie de Tsingoni au sujet du manque de matériel dont souffre l'école. Si les fournitures scolaires de base – cahiers, stylos – sont arrivées deux semaines après la rentrée, l'école manque en revanche de livres scolaires, dont la fameuse méthode de lecture pour CP "Azad et Laura", élaborée par le vice rectorat, mais aussi de produits d'entretient. "Nous n'avons pas assez de fichiers d'exercices pour les élèves, il nous faut donc faire des photocopies, seulement notre photocopieuse ne marche pas… A ceci s'ajoute le problème sanitaire dû à l'inexistence de produits d'entretient", explique un membre de l'équipe enseignante. La mairie a pourvu récemment l'école d'une photocopieuse neuve, mais la société vendeuse a refusé de leur donner l'encre, attendu que la mairie a plusieurs factures impayées.
L'inspectrice de la circonscription, après être venue sur place, a informé le vice rectorat du problème, mais la responsabilité du matériel des écoles reste celle de la commune. Dans la matinée, une personne de la mairie s'est présentée et a promis à l'école une photocopieuse pour après les vacances. "C'était un technicien, pas un élu", déplore notre interlocuteur, qui espère toutefois que cette manifestation de colère fera avancer les choses. En effet, alors que la mairie a été alertée plusieurs fois par l'école, c'est la première fois que quelqu'un s'y déplaçait. "Nous avons le sentiment d'être laissés pour compte. Nous ne pouvons pas faire du travail correct dans ces conditions." Les cours doivent reprendre normalement ce jeudi.