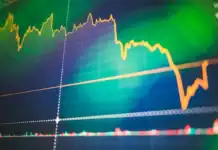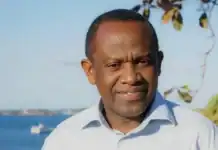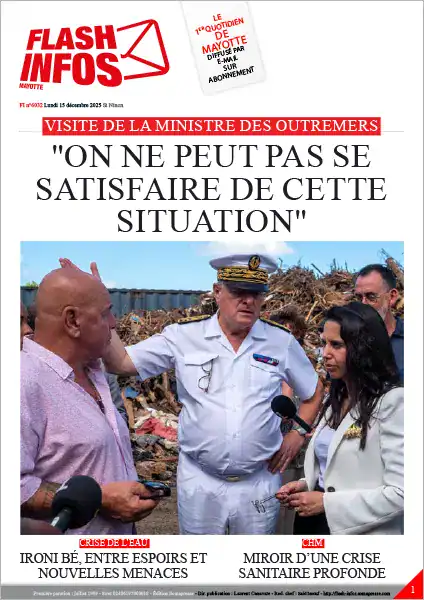L’association EFA 976 (Enfance et familles d'adoption de Mayotte) organise ce dimanche 28 février une nouvelle journée de rencontre postulants/adoptants à Kangani. 10h : accueil et réunion d’information, 11h30 : Assemblée générale, 12h30 : repas (pique-nique tiré du sac, apéritif et café offerts), suivi d'un après-midi d'échanges. Cette rencontre est gratuite et ouverte à toute personne intéressée par l'adoption. Renseignements et inscription : Patricia Jarach au 0639 69 49 09.
26/02/2010 – Tribune libre : Bacar Ali Boto
{xtypo_dropcap}L{/xtypo_dropcap}a concrétisation d’un idéal porté par plusieurs générations fait naître ainsi un immense espoir de la part des Mahorais. Mais très rapidement le doute s’installe. Les Mahorais s’interrogent et s’inquiètent. Des certitudes tombent. La Chambre territoriale des comptes annonce un déficit de plus de 72 millions d’euros, puis de 92 millions pour la Collectivité départementale. "Déficit", ce mot barbare et insaisissable pour les personnes qui ne sont pas initiées aux jargons comptables et financiers est perçu par une grande majorité de la population comme synonyme de faillite, de banqueroute et détournement de fonds publics.
L’image du conseil général, jadis emblème de la réussite économique et sociale par excellence, s’effondre brutalement. Les interventions et déclarations publiques insuffisamment préparées, voire maladroites, de certains élus accentuent la déception et le scepticisme de la population. Les échanges au sein de l’hémicycle Younoussa Bamana entre la majorité et l’opposition donnent l’impression de privilégier les querelles de personnes au détriment du débat d’idées et des enjeux réels du développement de l’île. Un sentiment général de rejet de toute la classe politique s’installe au sein de la population.
Ce peuple, anciennement profondément croyant, respectueux des institutions et de leurs représentants respectifs, du droit d'ainesse et de la hiérarchie sociale, devient fatalement plus réactif, contestataire, méfiant, pessimiste et sceptique au point de ne plus faire confiance à ses dirigeants.
Les électeurs ne croient plus aux promesses des candidats. Ils ne votent plus pour un bilan ni pour un projet et encore moins pour les compétences et la qualité de ces derniers. Ils considèrent désormais que le mandat politique n’est plus le moyen de défendre la population, mais constitue plutôt une promotion sociale et économique pour la personne élue. Le résultat est qu’on constate au fil des élections qu’un nombre de plus en plus important de citoyens attribuent leur voix soit aux membres de leur famille, soit à leurs amis, soit tout simplement aux candidats susceptibles de répondre au préalable favorablement à leurs besoins immédiats. Ce triste constat provoque de ma part de nombreuses interrogations.
Comment Georges Nahouda, Zaina Mdéré, Marcel Henry, Younoussa Bamana et leurs compagnons, des hommes et des femmes dont le niveau scolaire le plus élevé atteignait à peine le baccalauréat, ont réussi le détachement de Mayotte des Comores et l’ancrage définitif de celle-ci dans la République malgré un contexte géopolitique international et national très défavorable ?
C’était effectivement l’époque des mouvements de libérations nationales et des indépendances dans les empires coloniaux. La revendication départementaliste de nos leaders historiques était considérée alors comme un combat rétrograde, d’arrière garde, anachronique et contraire au sens de l’Histoire de l’Humanité. Et comment ont-ils pu se maintenir au pouvoir paisiblement jusqu’en 2004 ?
Pourquoi, depuis 2OO4, les hommes et les femmes de ma génération dont la plupart sont diplômés des universités de France, voire des grandes écoles nationales, semblent assurer difficilement la succession de l’héritage légué par nos anciens ? Comment n’arrivent-ils pas à maintenir la cohésion sociale et à garantir une bonne gouvernance pour notre Collectivité départementale ?
Et surtout, quelles actions mener pour permettre à nos concitoyens de croire à nouveau à la vertu de la politique; recommencer à espérer; et reprendre en main leur destin commun afin de bien réussir la départementalisation prévue en 2011 ? Cette départementalisation est perçue par l’ensemble des autochtones comme génératrice d’un développement économique, social et culturel susceptible de garantir le bien-être et l’épanouissement de la population de notre île.
Pour répondre à ces interrogations, j’essaie de remonter le temps avant de me propulser vers l’avenir. Quand j’étais au collège à Mamoudzou, j’avais un professeur de français, Monsieur Guéret, avec qui j’avais de très bonnes relations. Celui-ci me filait après lecture les journaux et magazines qu’il faisait venir de Métropole. J’appréciais plus particulièrement le magazine Jeune Afrique, mais je lisais également les autres titres tels que le Point, Paris Match, le Nouvel Observateur, le Monde diplomatique.
Les évènements qui m’ont marqué le plus sont : le courage de Yasser Arafat et de son peuple face à la puissance militaire d’Israël et de ses alliés; la révolution au Burkina Faso, anciennement Haute-Volta, lancée par Thomas Sankara; la résistance et le sacrifice de Nelson Mandela et des Noirs d’Afrique du Sud face à l’Apartheid. Un peu plus tard, j’ai découvert à travers l’Histoire et mes diverses lectures : Lénine, Staline, de Gaule, Adolphe Hitler, Mahatma Gandhi, Ché Guevara, Fidel Castro, J. F. Kennedy, Martin Luther King, pour ne citer que ceux-là.
Ces Grands Hommes, au delà de la diversité de leur personnalité, de leur style et de leur idéologie, partageaient des valeurs communes : l’amour de leur peuple, le sens du désintérêt et de l’honneur, la volonté de marquer l’Histoire de leur pays, voire l’Histoire du monde. Une capacité incommensurable de susciter ou d’imposer l’adhésion de leur peuple à leur cause.
Georges Nahouda, Zaina Mdéré, Marcel Henry, Younoussa Bamana et leurs compagnons partageaient eux aussi ces valeurs. En plus, les fondateurs du Mouvement populaire mahorais (MPM) avaient conscience de leurs manques et de leurs handicaps. Ils savaient écouter et apprécier les conseils de leurs amis experts et responsables politiques de Métropole et d’ailleurs. Ils avaient le sens de l’anticipation et de la projection à moyen et long terme.
Ils ne travaillaient pas contre tel ou contre quelque chose, mais pour un idéal : celui d’offrir une vie meilleure et digne à leurs concitoyens. Mais il faut reconnaître également qu’après l’indépendance des trois autres îles, le multipartisme était quasi absent à Mayotte. Le MPM régnait en maître absolu. Mayotte ne connaissait pas encore la société de consommation et ses malédictions. Les tentations étaient par conséquent très limitées.
Par ailleurs, la société mahoraise était encore très codifiée et respectueuse des traditions et de la religion musulmane. Le droit d'ainesse primait partout, y compris en politique. On était "jeune MPM" à cinquante ans, alors que l’espérance de vie des Mahorais atteignait à peine cinquante-cinq ans. On pouvait avoir la tête bien pleine et bien faite, mais on devait attendre son tour sinon faire preuve d’une docilité exemplaire et exceptionnelle pour espérer gravir les marches plus rapidement.
C’est ainsi que les cadres du Club Georges Nahouda ont été sacrifiés. A part quelques rares exceptions, ils n’ont jamais pu accéder au pouvoir. En effet, avant que leur "tour" arrive, le système s’est désintégré en 1999 avec la scission du MPM en deux fractions (MPM, "canal historique" et MDM – Mouvement départementaliste mahorais).
Les conséquences de cette scission sont multiples. Elle a favorisé l’émergence de nouvelles formations ou implantations politiques dont le Mouvement des citoyens (MDC) crée par des Métropolitains et présidé par Jean-Claude Mahinc, ancien professeur de philosophie. Localement, j’étais le premier Mahorais à avoir rejoint le MDC de Jean-Pierre Chevènement. J’ai été élu président de ce celui-ci en 2000.
Aux élections cantonales d’avril 2001 le Rassemblement pour la république (RPR, ancêtre de l’UMP) devient le plus grand parti de l’île. Mais aucun parti politique ne pouvait à lui seul disposer de la majorité absolue à l’assemblée territoriale. Une coalition présidée par le regretté Younoussa Bamana et composée de MPM, RPR, MDC et du conseiller général de Dzaoudzi-Labattoir, sans étiquette, a inauguré l’ère des cohabitations et des instabilités politiques à Mayotte. En 2002, en désaccord avec la politique de la majorité du conseil général, ma formation politique, le MDC, a décidé de rejoindre l’opposition.
Aux élections de 2OO1, seuls les maires de Bandrélé et Dembéni ont pu garder leur siège. Tous les autres ont été balayés. Des personnes dont la plupart étaient, jusqu’à cette date, inconnues politiquement et peu expérimentées accèdent à la tête des conseils municipaux grâce à des coalitions diverses et variées souvent formées à la hâte entre les deux tours. Dès les premières années de leur mandat, de nombreux conseils municipaux ont enregistré des taux d’absentéisme records. Plusieurs municipalités ont connu des dysfonctionnements sans précédent…
Le summum de l’inconscience et de la bêtise politiques est atteint en 2004 lorsque mes amis des Frap (Forces de reconstruction et d’alliance pour le progrès, une fédération composée du MDM, MDC, Sorodat et les Verts) et moi-même, en ma qualité de président de la structure, avons décidé de confier la présidence du conseil général au seul sans étiquette de l’assemblée, Said Omar Oili.
Auparavant, pendant des mois nous avons sillonné Mayotte pour expliquer aux Mahorais le projet que nous souhaitions mettre en place une fois que les Frap auront acquis la majorité au conseil général. Hélas la perte des cantons de Pamandzi, Koungou et Kani-Kéli, considérés par nos stratèges comme faciles à acquérir, nous a privé de la majorité absolue à l’assemblée. Les sièges étaient répartis comme suit : Frap 9, UMP 9 et sans étiquette 1.
C’est alors que nous avons décidé unanimement de proposer la présidence à un membre de la coalition sortante de l’époque. Pour nous, un président choisi de cette façon ne pouvait qu’appliquer la politique définie par notre fédération. Nous avons pensé prioritairement à Said Omar Oili car il nous semblait le plus fragile. En effet, il était sans étiquette et n’obéissait à aucune discipline de parti. Il était en quelque sorte "à vendre".
Celui-ci et son état-major ont mené des négociations parallèles à la fois avec les Frap et avec l’UMP. Au terme de trois jours de négociations marathon et stressants, il a décidé in extremis de quitter ses amis de jadis pour rejoindre les Frap. Comme convenu, nous l’avons élu président du conseil général le 2 juin 2004. Je suis devenu son 1er vice président.
A partir de cette date, ce fut tout sauf ce que notre fédération avait prévu de mettre en place durant le mandat correspondant. En mettant de côté la gestion courante de la Collectivité départementale, dont l’autopsie nécessitera plusieurs chapitres, j’ai retenu essentiellement les résultats suivants : l’implosion des Frap, de l’UMP, du PS, ainsi que de tous les autres partis existants de 2004 à 2008.
Tous les membres des Frap qui l’ont soutenu et qui l’ont porté au pouvoir n’ont pas été réélus. Tous les conseillers généraux sortant de l’UMP, susceptibles de briguer la présidence de l’assemblée départementale ont été battus en 2008. Une autre coalition encore plus hétéroclite (UMP, MDM – devenu Nouveau Centre – et PS) que la précédente a formé une nouvelle majorité que préside Ahamed Attoumani Douchina. Said Omar Oili, ex-président du conseil général, reste l’un des chefs de file de l’opposition.
La suite vous la connaissez. Les Mahorais et les citoyens de cette île n’ont jamais étaient aussi inquiets, tristes et perdus qu'aujourd’hui. Et pourtant les solutions existent. C’est pourquoi je pense qu’il est vraiment temps de se ressaisir avant qu’il soit trop tard. Mayotte a les potentialités nécessaires pour la réussite de son développement économique et social. Au niveau local, il y a suffisamment d’hommes et de femmes compétents capables d’assumer avec efficacité des responsabilités dans les différents domaines.
Le problème qui se pose est que ces compétences sont souvent méconnues, ignorées ou dispersées. En effet, la société mahoraise prise dans sa globalité reste encore très cloisonnée et sectaire. Les différentes communautés se croisent sans jamais se rencontrer. Cette situation, non seulement ne favorise pas les échanges interculturels, mais surtout génère des méfiances et des a priori des uns envers les autres. Chacun imagine le pire chez l’autre.
Pour se protéger on évite de communiquer, de peur que l’autre s’enrichisse en vous appauvrissant. Les relations de cette nature sont omniprésentes dans l’ensemble des secteurs sociaux, économiques et politiques.
Or Mayotte est en train de négocier un tournant capital de son histoire. Le passage de la Collectivité départementale à la départementalisation. Pour une grande majorité de Mahorais, il s’agit tout simplement d’un saut vers l’inconnu. Ce moment d’incertitudes et d’inquiétude généralisées impose l’instauration d’un dialogue sincère et transparent entre nous Mahorais, et entre les Mahorais, les Métropolitains et l’ensemble des communautés qui ont choisi notre île comme terre adoptive.
Le moment est venu pour nous tous d’oublier nos complexes, de nous débarrasser de nos séquelles du passé, de faire la paix entre nous et de donner une chance à un avenir meilleur. Dans ce vaste chantier, les acteurs politiques, économiques et socioprofessionnels ont un rôle majeur à jouer.
A ce titre, je propose à l’ensemble des partis politiques locaux d’accepter l’instauration d’un moratoire de 5 ans interdisant les affrontements entre nous; de mettre en place un comité de pilotage composé des présidents de chaque formation politique. L’objectif est de rendre possible l’Union sacré de tous les partis politiques de l’île, de droite comme de gauche.
La finalité consiste à faire élire aux élections cantonales, sénatoriales, législatives et municipales respectivement de 2011, 2012 et 2014, les hommes et les femmes les plus compétents et les plus efficaces pour manœuvrer le pays durant cette période de turbulences de tous genres. Cette idée n’est ni neuve ni utopique. Je l’avais déjà proposée en 2004 au secrétaire fédéral de l’UMP, Ahamed Attoumani Douchina, lors d’une négociation secrète. En plus, elle a déjà été expérimentée, dans une version moins large et pour des périodes très courtes, en 2000 et récemment en 2009.
Les résultats étaient à chaque fois très satisfaisants. Cette proposition est réalisable car à Mayotte les notions "droite-gauche" n’ont pas de sens. Les frontières idéologiques entre la gauche et la droite sont quasi inexistantes, voire inconcevables, pour les Mahorais.
Pour l’anecdote, lors des dernières élections cantonales partielles de Tsingoni, mes amis des forces progressistes et moi avons soutenu le candidat socialiste contre celui de l’UMP. Or, nous savions pertinemment que quelle que soit l’issue de cette élection, la personne victorieuse allait au conseil général compléter la majorité conduite par un président UMP. Surréaliste ? Non ! Cela fait partie du dépaysement et du charme de Mayotte.
Bacar Ali Boto
Ancien 1er vice président du conseil général
Président de l’Alliance pour un développement maîtrisé et solidaire
26/02/2010 – Tribune libre : Association des organismes de formation de Mayotte
{xtypo_dropcap}N{/xtypo_dropcap}ous n’avons pas vocation à joindre notre voix à ce concert d’intelligences mobilisées pour que l’avenir soit plus rose, nous n’en avons ni les qualités ni les compétences. Non, nous ne sommes que des ouvriers de la formation professionnelle, comme se plaisait à le dire feu Gino Salimbéni qui a tant fait pour la formation des jeunes à Mayotte. Des ouvriers qui constatent sur le terrain depuis 10 ans que trop de jeunes sortent encore du système scolaire sans maîtriser ce qu’il est convenu d’appeler les compétences de base.
Des ouvrier qui constatent que les appels d’offres du conseil général en matière de formation professionnelle des demandeurs d’emploi accumulent retard sur retard, d’année en année, faute de capacité politique à mettre en oeuvre des choix stratégiques à moyen et à court termes. Des ouvriers qui constatent, à la lecture d’appels d’offres émanant d’institutions nationales établies à Mayotte, que la pédagogie est encore une discipline ignorée de certains décideurs, plus soucieux de poudre aux yeux que d’une réelle efficacité formative. Comment, par exemple, prétendre faire progresser sérieusement la capacité de lire et écrire en français pour ceux qui ne le maîtrisent que très peu, voire pas du tout, en 2 jours ?
Des ouvriers qui constatent que les organismes de formation dignes de ce nom et soucieux d’offrir des prestations de qualité, supportent patiemment les aléas de l’absence de politique volontariste en la matière, tout comme des difficultés de trésorerie liées à des modes de paiement, des retards et des irrégularités invraisemblables.
Des ouvrier qui constatent que régulièrement quelques parachutés à Mayotte s’improvisent formateurs en pensant sans doute qu’il suffit de "savoir" pour exercer ce métier et que, attirés par le brillant et les apparences policées de ce qui vient d’ailleurs, certains décideurs s’empressent de les écouter doctement.
Des ouvriers qui constatent les difficultés rencontrées par les structures en charge d’accueillir et d’orienter les jeunes et les demandeurs d’emploi par manque de moyens humains suffisants (Mission locale et Pôle emploi).
Ah, quel tableau pessimiste nous dira t on !
Que l’on se rassure, il y a des constats positifs :
– La prise de conscience progressive et collective de l’impérieuse nécessité de travailler à réduire le degré d’illettrisme, nous en voulons pour exemple et comme signe tangible les efforts et l’engagement des services de l’Etat en ce domaine, même si le chantier est immense.
– La prise en compte de plus en plus fréquente, par les chefs d’entreprises, de l’utilité et de la nécessité de la formation continue.
– La mise en ordre de marche de l’organisme collecteur des fonds de la formation professionnelle auprès des entreprises.
– L’utilité de structures oeuvrant en amont ou en aval des actes de formation (Centre de bilan de compétences, Ladom par exemple).
– La motivation des jeunes fréquentant assidument les centres de formation et leur désir d’apprendre et de progresser.
– Les efforts faits par les organismes de formation pour s’équiper, pour former leurs personnels, afin de mieux répondre aux besoins locaux ainsi qu’aux exigences de la mobilité.
– La capacité de l’appareil de formation local à s’adapter aux nouvelles réglementations et aux évolutions sociales et économiques si rapides de Mayotte.
– Les résultats positifs et dignes d’éloges obtenus par ces mêmes organismes de formation avec des moyens largement inférieurs à ceux des organismes métropolitains ou bien du GSMA.
– La multiplicité des domaines de compétences couverts par ces mêmes organismes, du bâtiment au secteur sanitaire et social, notamment les préparations aux concours de la fonction publique hospitalière, des métiers du tertiaire aux métiers de l’hôtellerie restauration, du droit du travail et droit commercial au management, des métiers de la mer aux métiers du commerce, de l'informatique et de la bureautique, etc.
Arrêtons-là une énumération qui n’a pas pour objet de faire plaisir à qui que ce soit ou de mettre au pilori tel autre. La formation professionnelle est une affaire trop sérieuse, aux enjeux trop importants pour que l’on ne tienne pas compte des avis et des compétences de ceux qui ont une culture et une pratique de la pédagogie, dont c’est le vrai métier et qui connaissent Mayotte.
Quant à ce qui se passe sur le terrain, c’est l’affaire des pédagogues, de ceux qui travaillent au quotidien avec sérieux avec les jeunes, les demandeurs d’emploi, les personnels d’entreprise.
C’est l’affaire des vrais "ouvriers de la formation professionnelle". Il est temps de les écouter davantage, il est temps de comprendre qu’ils connaissent et maîtrisent leur métier, il est temps de leur donner les moyens d’être encore plus utiles à la société mahoraise pour accompagner les évolutions socio-économiques majeures auxquelles notre île doit faire face.
Pour l’Association des organismes de formation de Mayotte
Le président, Pascal Rolland
26/02/2010 – Shama Puedza : Bambo kayak raid 2010
{xtypo_dropcap}L{/xtypo_dropcap}es bras ont bossé dur, très dur dimanche matin pour les pagayeurs d'un jour ou de toujours. Plus de quatre kilomètres de course de kayak au départ d'une des célèbres plages du sud, c'était le défi à relever proposé par l'association Shama Puedza. A Musical plage, cinquante sept personnes ont voulu relever le défi. Quelques uns en double, la plupart d'entre eux en solitaire.
La toute première consigne donnée au micro par Jean-Luc Canal, avant le lancement du Bambo kayak raid 2010, est aussi simple que fondamentale : "Si un kayak se renverse, le participant le plus proche doit porter secours à cette personne en difficulté, voire en danger, sous peine d'être non seulement disqualifié, mais ça peut aller plus loin… Le temps qu'il aura perdu lui sera décompté, on lui fera confiance s'il nous dit qu'il s'est arrêté pendant cinq ou dix minutes".
Le BKR est une compétition comme les autres, mais pour l'association organisatrice, le message est clair : la priorité des priorités c'est la sécurité. Ceci annoncé, d'autres instructions sont rapidement données avant de lancer les amateurs de sports aquatiques dans l'eau. Les plus jeunes, avec leurs gilets de sauvetage se mélangent aux plus âgés, aux plus expérimentés. Le coup d'envoi est le même pour tous, bien que des catégories sont définies (voir encadré). 10h27 : ça y est c'est parti et les pagayeurs se précipitent à toute allure dans l'eau chaude de Musical.
La course en tête pour Inamoto et Jack
Après un kilomètre de course, Idrissa Ouirdani dit Inamoto et Jack Zoulaidhidine Daoudou se détachent des autres participants. Avec le mont Choungui et la fabuleuse richesse forestière mahoraise au second plan, tous balaient la mer un coup à droite, un coup à gauche pour se rapprocher de l'îlot Bambo, le mi-parcours du BKR.
A chacun son rythme, on peut voir au loin les derniers pagayeurs apprécier le panorama sudiste, son lagon, son île au sable blanc, sa plage de Musical vue d'un angle tout à fait différent… déguster le moment présent. Cet état d'esprit, les poursuivants d'Inamoto ne l'ont peut-être pas.
Ils abordent très rapidement la dernière ligne droite, mais ne rattraperont pas la machine à gagner. Car après s'être distingué dans les différentes épreuves de course à pied organisées sur l'île (11 km de Bouéni, Cross caporal, Triathlon), Idrissa Ouirdani démontre qu'il peut également rafler des victoires dans des compétitions où les jambes ne sont pas les seules à être d'une grande utilité, comme le Bambo kayak raid.
Il remporte la course en 40 minutes et 48 secondes. Suivent à plus d'une minute derrière, Jack (41'50"), Serge Harter (42'11"), Patrick Baillif (42'19"), JP Platon (42'29") et Marc François (42'40") qui atteignent la ligne d'arrivée à moins d'une minute d'intervalles. Mariate Ali Bacar, 13 ans, clôture la course en 1h01'40". Elle n'était pas la plus jeune.
2011 menacé à Shama Puedza
Cadette de la course, Perrine Guegan, qui fêtera ses douze ans le 3 mars a eu droit à une jolie coupe, tout comme l'ainé du BKR 2010, Serge Harter, 57 ans et troisième du classement général tout de même, qui plaisante : "je ne récupère pas ma coupe si vous me qualifiez de plus vieux, je ne suis pas vieux !". Et à Jean-Luc Canal de se reprendre : "le moins jeune de la course"…
Cette atmosphère bon enfant a perduré bien après la remise des récompenses, où les courageux participants se sont retrouvés autour d'un buffet-voulé pour raconter leur matinée, et converser. "C'était trop difficile", nous confie Ismaël Houlali, "surtout à la fin, je ne pouvais presque plus pagayer, heureusement qu'il y avait mon collègue Sergent. Si on n'était pas en double, j'aurais fini plus loin encore c'est sûr".
Pour cette édition, aucun abandon n'est enregistré, aucun incident n'est à déplorer. Juste les conditions d'organisation de plus en plus difficiles : "Aujourd'hui on bénéficie de tout le travail réalisé par Laurent Godonaise (ancien président de Shama Puedza, ndlr) ces dernières années, mais sans subvention ni aide extérieure, et avec les partenaires qui répondent de moins en moins, nos activités pourraient ne pas se poursuivre en 2011", déplore l'actuel président.
Des activités qui ont, rappelons-le, pour finalité de "participer à l'évolution du nautisme, mais surtout à la promotion du lagon de Mayotte" (Interview de JLC, MHS n°48). Pour l'heure, deux rendez-vous sont déjà pris : le 11 km de Bouéni dimanche 11 avril à la base nautique de Hagnoundrou et le Festy Voile le dimanche 13 juin au même endroit. "Avec toujours plus de monde on l'espère."
Ichirac Mahafidhou
Classement final par catégorie
Simple Seniors 1 (entre 1/2/80 et 31/1/92) : Idrissa Ouirdani (1er, 40'48"), Jack Zoulaidhidine Daoudou (2nd, 41'50"), Bruno Lemarchand (3ème, 51'11") et Anastazia Baco Moussa (4ème, 51'58"). Simple Seniors 2 (entre 1/2/70 et 31/1/80) : Alexandre Colin (1er, 43'19"), Joyce Pierret (2nd, 45'). Simple Vétérans (entre 1/2/60 et 31/1/70) : Patrick Baillif (1er, 42'19"), Fabrice Guérin (2nd, 45'27"), Elisabeth Baillif (3ème, 47'50") et Annick Urschelleer (4ème, 1h01'37"). Simple Super Vétérans (avant le 31/1/60) : Serge Harter (1er, 42'11"), JP Platon (2nd, 42'29"), Marc François (3ème, 42'40"), Frédéric Robert (4ème, 44'58") et Wari Mana (5ème, 47'09"). Simple Super Vétérans femmes : Catherine Cauchoix (1ère, 54'10"), Claudine Lazib (2nde, 56'01") et Dominique Goek (3ème, 57'51"). Podium Simple Juniors (après 31/1/92) : Robin Chartier (1er, 43'19"), Yahaya Combo (2nd, 44'45") et Hafidhou Moustoiffa (3ème, 44'52"). Podium Simple Junior filles : Hadhuirati Hamidouni (1ère, 49'57"), Houriati Saïd (2nde, 53') et Perrine Guegan (3ème, 54'13"). Double Seniors 1
Sergent Mahamoud et Ismaël Houlali (1er, 46'32"), Anchiate Ousseni et Haifaou Madi (2ème, 1h18". Double Senior 2 : Sylvain Beguin et David Courtin (1er, 43'57"), Dorothée et Julien Prentout (2nd, 50'02"). Double Vétérans : Stéphane Groleas et Bernard Baille (1er, 47'32"), Samuel Chauveau et Brigitte Fouraste (2nd, 50'13"), Olivier et Eve-Marie Puccini (3ème, 52'21").
26/02/2010 – Sport / Football : Portrait
{xtypo_dropcap}A{/xtypo_dropcap} Passamaïnty, le football est une affaire sérieuse. Houdhouna Assani joue au football depuis sa plus tendre enfance et aujourd’hui encore, il fait tout pour se présenter aux 4 entraînements hebdomadaires concoctés par le duo d’entraîneurs N’daka et Camara. “Ne vous inquiétez pas, il sera là, il n’y a pas de joueurs qui aiment autant s’entraîner que lui”, nous ont d’ailleurs fait remarquer les dirigeants de Rosador mardi soir.
En effet, quelques minutes après Houdhouna arrive et se colle immédiatement des tours de terrain avant de rejoindre ses coéquipiers dans une séance consacrée à l’efficacité devant le but. A la fin de l’entraînement, il fait du rab' en effectuant des abdominaux et des étirements. “Mon point fort, ça a toujours été de cadrer mes frappes”, reconnaît l’attaquant des Verts.
Les buts, il les a accumulés avec l’AS Rosador, mais aussi le club rival du FCM et à la Réunion à l’AS Chaudron et à l’Excelsior où il a côtoyé Djardji Nadhoime, originaire de Mzouasia. En 1993, il débute en DH et décroche le premier titre de champion de l’histoire du club. Aujourd’hui, il en a 11 en poche et compte bien en ajouter un nouveau à l’issue de la saison 2010.
“Je suis un gagneur, je m’entraîne sérieusement en semaine, ce n’est pas pour jouer uniquement pour le plaisir, mais aussi gagner le week-end”, explique Houdhouna. Parmi ses meilleurs souvenirs figurent le triplé championnat, coupe de Mayotte et coupe de France réalisé en 1994 avec l’AS Rosador, ainsi qu’un match joué contre le champion de Madagascar.
Une médaille de bronze inespérée
Il n’oublie pas non plus la médaille de bronze remportée aux Jeux des îles de l’océan Indien en 2007 avec la sélection de Mayotte, dont il était le capitaine. Les moments difficiles restent aussi gravés dans sa mémoire. Il y a d’abord les incidents de 2005 survenus en Coupe de France contre l’AS Sada à Passamaïnty.
“Ce match, quel que soit le résultat sur le terrain, nous l’aurions gagné car l’ASS avait fait jouer des joueurs suspendus. Je regrette que les dirigeants n’aient pas calmé les supporters les plus perturbateurs. A l’issue de ce match, j’ai aussi passé une garde à vue parce que j’aurais soi-disant agressé quelqu’un avec un chombo, alors que les joueurs étaient à l’écart des troubles. Ca m’a vraiment fait mal.”
Son passage de Rosador au FCM a aussi été incompris à Passamaïnty. “L’équipe avait été reléguée, j’avais laissé un salaire équivalent à 3 fois le Smig mahorais à la Réunion pour revenir ici. Je ne me voyais pas rester ici pour ne pas gagner des titres, moralement c’était dur. Je suis même reparti à la Réunion en laissant mes coordonnées à ma mère qui a fait office d’agent en quelque sorte. Les dirigeants du FCM m’ont contacté et j’ai accepté le challenge, même si c’était dans le village rival."
FCM, un choix personnel et assumé
"Personnellement, il fallait que je sorte d’une situation où j’étais au chômage et mon premier enfant venait de naître. J’ai pensé d’abord à ma famille et non plus au village.” Excellent des deux pieds, Houdhouna a aussi une facilité déconcertante à éliminer ses adversaires directs par sa vivacité et sa vitesse ballon au pied. Aujourd’hui, certains le traitent de vieux, mais au vu de certaines prestations comme contre l’AS Sada à Tsingoni l’an dernier, le "vieillard" peut rendre dingue les défenseurs les plus aguerris.
“Aujourd’hui, je ne suis plus obnubilé par le but, je suis autant heureux de donner un caviar à un coéquipier que de marquer moi-même. Mais au football, on se met au service du collectif. On ne peut pas s’en sortir tout seul, on le fait grâce aux partenaires, même si un match peut être débloqué par une individualité”.
Leader technique des Verts, Houdhouna est aussi un modèle pour les plus jeunes. Cependant, celui-ci observe que les temps changent. “Les jeunes n’ont plus envie comme nous l’avions auparavant. Il faut travailler et certains de mes anciens coéquipiers qui ont arrêté de jouer à 27 ans se demandent comment je fais pour jouer encore aujourd’hui. J’ai envie, je travaille beaucoup et je me donne à fond. Avec mon expérience à la Réunion, à la Coupe des Dom et lors des compétitions régionales, j’ai appris des choses que je peux transmettre à mes coéquipiers et qui me servent beaucoup.”
Faïd Souhaïli
Palmarès de Houdhouna Assani
11 fois champion de Mayotte : 1993, 1994 ,1995, 1997, 1999, 2000, 2001 et 2009 avec l’AS Rosador, 2006, 2007 et 2008 avec le FC M’tsapéré
4 fois vainqueur de la coupe de Mayotte : 1994, 1998, 1999 et 2009 avec l’AS Rosador
5 fois vainqueur de la coupe de France régionale : 1994, 1996, 1997, 1998 et 1999 avec l’AS Rosador
Médaillé de bronze des Jeux des îles de l’océan Indien en 2007 avec la sélection de Mayotte
26/02/2010 – Education : Don du Rotary Club

{xtypo_dropcap}"P{/xtypo_dropcap}récieux". C'est ainsi que Marc Feyeux, principal du collège de Kawéni, a qualifié l'initiative du Rotary club de Mayotte, en recevant de leurs mains un chèque de 2.727€. Résultat d'une collecte organisée par le Rotary et d'un dont du Crédit agricole de Mayotte, ce chèque permettra à 124 élèves de sixième de bénéficier d'une collation à 10 heures pendant deux trimestres. Les élèves bénéficiaires de ce don ont été choisis par l'administration du collège, parmi les plus défavorisés socialement.
"Mes enfants ont été scolarisés dans ce collège", se souvient Eric Rouget, trésorier du Rotary. "Ils me racontaient que nombre de leurs camarades n'avaient pas de goûter et regardaient manger dans la cour ceux dont les parents ont les moyens de leur fournir un repas." L'an dernier déjà, le Rotary avait fait un don qui avait permis à une centaine d'élèves d'avoir une collation pendant un trimestre. "Nous avons eu des retours très positifs des professeurs qui voient une réelle différence dans l'attention et la motivation de l'élève qui a pu manger en cours de journée", poursuit M. Rouget.
"Nous avons ici beaucoup d'élèves défavorisés, ce geste est important pour eux", confirme Marc Feyeux, rejoint par Saïd Assiandi et Saboor Shayan, les représentants des élèves qui sont venus réceptionner le chèque. Le montant du chèque offert a été relevé par la participation du Crédit agricole qui, comme de nombreuses grandes entreprises, a une enveloppe par an consacrée au mécénat. La banque a été sollicitée par le Rotary pour participer à cette action.
La semaine prochaine, un second chèque sera remis, cette fois au collège de M'gombani à qui le Rotary club Ste-Marie Roland Garros (la Réunion) offre 1.460€, permettant à 70 élèves de sixième de bénéficier d'une collation pendant deux trimestres.
26/02/2010 – Assemblée Générale de la JCE
{xtypo_dropcap}L{/xtypo_dropcap}e président Madi Abbou N'tro a pour sa part fait un bilan de son déplacement à la conférence des présidents des Jeunes chambres économiques française (JCEF) à Château-Gontier. Réunissant plus de 200 congressistes, les présidents ont été formés à la gestion de leur "organisme local membre" (OLM) et à la maitrise des outils de communication. Ce rassemblement fut aussi l'occasion de présenter aux présidents des Jeunes chambres territoriales le plan d'actions national 2010.
"Cette année, nous aurons plus que jamais à cœur de porter nos valeurs. Même si la Jeune chambre économique de Mayotte, et d'une manière générale la Jeune chambre internationale (JCI) ne porte pas d'action politique, elles restent des forces de proposition pour les gouvernants. Les JCE locales portent des actions économiques, culturelles, éducatives, environnementales, de développement durable, humanitaire, des actions qui visent à améliorer la vie dans la cité", a déclaré M. Abdou N'tro
Ainsi, le training job café lancé l'an dernier sera maintenu. Le but de cette action est de former des jeunes actifs aux techniques d'entretien d'embauche sous le principe du "speed dating", à la rédaction de CV et de lettre de motivation, afin d'optimiser leurs chances de succès dans la recherche d'emploi. La JCEM devrait de nouveau solliciter la participation de cadres et chefs d'entreprises de l'île, qui s'étaient gracieusement prêtés au jeu l'an passé.
Autre bonne nouvelle, grâce au "Train de la formation", Mayotte pourrait avoir l'honneur d'accueillir une délégation du bureau national JCE à Mayotte, afin de resserrer les liens du jeune OLM avec la maison mère. La JCEM, conformément aux directives nationales, devrait réaliser en 2010 une cartographie aérienne complète de l'île et proposer les plus beaux clichés au fil d'une exposition. Enfin, le mois de mars verra le retour de l'action "Les nuits du cinéma", avec la projection d'un ou plusieurs films dans une commune de l'île. La prochaine assemblée générale est fixée au 2 mars.
26/02/2010 – La nécessité de faire de Mayotte une Rup
{xtypo_dropcap}A{/xtypo_dropcap}près le Livre vert de juin 2008, la Commission européenne a adopté le 6 novembre 2009 une communication précisant sa vision du nouveau partenariat entre l’Union européenne et les PTOM, dans la perspective du remplacement de l’actuelle décision qui prend fin le 31 décembre 2013.
De ce fait, Mayotte, qui entre pleinement dans un premier temps, dès 2011, dans le régime national de droit commun conformément à l’évolution de son statut interne dans la France, souhaite poursuivre, en second lieu et dans la continuité, son ancrage dans l’espace européen en devenant une Région ultrapériphérique, elle qui est aujourd’hui inscrite dans la catégorie des PTOM. Cette évolution est rendue possible par le Traité de Lisbonne.
Ainsi, l’enjeu est plus que symbolique, car après la départementalisation, le statut de Rup viendra s’adapter aux nouvelles conditions politiques, aux réalités économiques actuelles ainsi qu’aux enjeux sociaux et environnementaux futurs auxquels Mayotte doit faire face, et ce, en étant inscrite dans la prochaine programmation des fonds structurels (2014-2020).
Ces fonds permettront à Mayotte de soigner ses nombreux handicaps, notamment en matière structurelle, de mieux être nourrie pour faire face aux droits sociaux, de permettre une meilleure mobilité des jeunes dans le domaine de la formation et de l’emploi, de donner aux collectivités territoriales les crédits nécessaires à leur fonctionnement ainsi qu’à leurs investissements, etc. Mais devenir Rup sous-entend aussi et surtout le respect de certains principes communautaires.
Le statut de Rup et l’article 73 de la Constitution française, régissant les départements d’Outremer et dans lequel est inscrite Mayotte, seront ainsi deux garanties de taille afin d’éviter un bouleversement brutal et profond de la société mahoraise, puisque ces deux cadres juridiques reconnaissent la spécificité des départements et des Rup, de ce fait la nécessité d’adaptation des politiques nationales et communautaires aux réalités propres de chaque territoire.
I) Bilan de l’action européenne à Mayotte (1975-2013)
En tant que PTOM, Mayotte bénéficie des aides européennes depuis le 4e Fed (Convention de Lomé I : 1975-1980) et successivement, avec une enveloppe qui a triplé en 20 ans, l’investissement européen à Mayotte a permis de financer plusieurs opérations de base telles que l’adduction d’eau, l’électrification rurale, le reboisement, la construction de la station d’épuration des eaux usées, la construction d’Aquamay (Coopérative d’aquaculture de Mayotte), le développement de la filière aquacole, l’aménagement et le développement durable, la protection du lagon, etc. Depuis 2004, avec le transfert des compétences et des ressources, le Fed est géré par la Direction des affaires européennes du conseil général de Mayotte.
Le nouveau statut de Rup offrirait à Mayotte les outils nécessaires à son rattrapage et à son développement économiques, en complément de l’engagement national, avec des instruments financiers tels que les Feder (Fonds européens de développement régional), les FSE (Fonds structurels européens) ou encore des programmes d’aides complémentaires spécifiques à l’éloignement et à l’insularité comme le Poseidom, programme destiné aux départements français d’Outremer.
Cela permettra aussi de rattraper les retards qu’accuse l’île en matière d’infrastructures et d’équipements collectifs, le respect des droits sociaux, plus de soutien aux collectivités territoriales avec les crédits de l’octroi de mer ou son équivalent après la réforme, l’assurance de voir sauver les langues maternelles locales avec l’application de la Charte européenne des langues et des cultures régionales, etc.
L’accession de Mayotte à ce statut sous-entend le respect de plusieurs conditions préalables notamment la bonne gestion des crédits du Fed et le respect des bases, normes et valeurs européennes.
II) Les conditions préalables à l’accession de Mayotte au statut de Rup
1) La bonne gestion du Fed
L’une des conditions majeures et non négligeables de cette évolution statutaire demeure la consommation et la bonne gestion des crédits du Fed alloués à Mayotte, puisque le 9e Fed (2000-2007) s’est vu octroyer une enveloppe de 15,2M€ auxquels ont été ajoutés près de 9,5M€ représentant des crédits non consommés issus des précédents Fed, mais au final, seul un peu plus d'1M€ a été consommé. Des études démontrent les raisons de cette consommation "partielle" des crédits, qui concernent en particulier les 8e et 9e Fed dont les reliquats ont été portés sur le 10e Fed.
2) Le respect des bases, normes et valeurs européennes
L’accession de Mayotte au statut de Rup nécessite des préalables qui portent essentiellement sur le respect de l’ensemble des acquis communautaires représentant près de 14.500 actes normatifs. Voici une liste non exhaustive de ce que pourrait exiger l’UE :
– La première des conditions est celle fixée par le Traité de Lisbonne dans les "Déclarations relatives à des dispositions des Traités" : la France devra notifier au Conseil européen et à la Commission européenne si "l’évolution en cours du statut interne de l’île le permet", en clair la départementalisation est un préalable ;
– Tirer les leçons de la mauvaise gestion des 7e et 8e Fed en consommant les crédits et surtout en respectant les procédures et les délais. Le 10e Fed en cours pourrait être la base de cette nouvelle approche dans la gestion européenne des crédits, ce qui nécessite que l’on garantisse les moyens nécessaires à la maîtrise des procédures du code de marché national et européen ;
– Le respect de la Convention européenne des Droits de l’Homme et notamment l’égalité entre l’homme et la femme, le droit d’asile, le droit d’entrée et de séjour des étrangers. Même si pour le moment, la loi DSIOM classe cette matière comme réservée à la spécialité législative et même si l’article 73 de la Constitution de 1958 et le régime juridique des Rup permettent une adaptation des mesures nationales et communautaires selon la situation de chaque territoire, il n’en demeure pas moins que l’Europe imposera un minimum de règles dans ce domaine, reste à définir lesquelles ;
– L’application du principe de la libre circulation des idées, des hommes et des marchandises, et la libre concurrence, etc.
III) Un cadre politique propice à cette évolution statutaire
1) Les différents engagements politiques depuis 2000
Si la position des représentants politiques sur la "rupéisation" de Mayotte a évolué et s’est confirmée au fil du temps, c’est parce qu’elle a été nourrie, maintenue et même promise par les gouvernements successifs et par des engagements politiques de poids :
– Déjà dans l’Accord du 27 janvier 2000, dit Accord Oudinot, en vue de la transformation du statut de Collectivité territoriale de Mayotte en Collectivité départementale, cette idée de Mayotte-Rup a été évoquée, même si aucun cadre juridique n’en portait la garantie ;
– Suite à cet accord, la loi du 11 juillet 2001, instituant la Collectivité départementale de Mayotte, a repris ce projet tout en l’inscrivant dans la continuité de la départementalisation ;
– Un engagement confirmé par la Ministre de l’Outremer elle-même, Brigitte Girardin qui, en septembre 2002 soutenait : "Il faut permettre à Mayotte de changer de statut vis-à-vis de l’Europe et de quitter la catégorie des PTOM, éligible aux Fonds européens de développement pour intégrer celle des Rup et avoir ainsi accès à de nombreux programmes européens tels Interreg ou le Feder";
– En 2007, avant de quitter l’Elysée, l’ancien Président de la République, Jacques Chirac voyait dans son "ambition pour l’Outremer", la transformation de Mayotte en Dom mais également en Rup ;
– Le Pacte pour la départementalisation proposé par le Président de la République, Nicolas Sarkozy, le 16 décembre 2008 reprend l’idée, en mentionnant même, et pour la première fois, une date : "L'Etat engagera très rapidement une démarche auprès des institutions communautaires pour que la transformation de Mayotte en région ultrapériphérique intervienne dans des délais compatibles avec l’accès aux financements européens disponibles à partir de 2014", d’où la nécessité de veiller à ce que Mayotte soit dans le train de la prochaine période de programmation des Fonds structurels (2014-2020) et non pas inscrite dans la nouvelle législation devant encadrer les relations futures entre l’Europe et les PTOM.
2) L’action de Marie-Luce Penchard sur ce dossier
En conséquence, cette nouvelle ambition du gouvernement de faire de Mayotte une Rup est portée par la Ministre chargée de l’Outremer, Marie-Luce Penchard. De ce fait :
– Les 14 et 15 octobre 2009, à l’occasion de la Conférence des Présidents de Rup qui s’est tenue aux Canaries, la Ministre a évoqué, entre autres, le dossier de Mayotte. A l’issue de la conférence, les Ministres et Présidents de Rup ont pris l’engagement de présenter à la Présidence espagnole de l’UE, avant le 5 mai 2010, un "mémorandum conjoint" présentant une "feuille de route commune" de ce que devront être les futures relations entre l’Europe et les Rup. Un espoir pour Mayotte qui souhaite voir inscrite son ambition européenne parmi les priorités de l’Europe ;
– Quelques jours plus tard, le 19 octobre, la Ministre a défendu le dossier de Mayotte à Bruxelles et a de ce fait "présenté à M. Karel de Gucht les conditions du passage de Mayotte au statut de Rup et lui a rappelé que le commissaire en charge des régions avait d'ores et déjà désigné un service "référent" pour faciliter la procédure";
– Interrogée par votre sénateur, qui fixe le renforcement du statut européen de Mayotte comme une des priorités de la période d’après-départementalisation qui s’ouvre, à l’occasion de la discussion du Projet de loi de finances pour 2010 au Sénat le 26 novembre 2009, la Ministre a confirmé que le dossier de Mayotte sera déposé à Bruxelles dès 2011 ;
– Enfin, lors du premier Conseil interministériel de l’Outremer à l’Elysée le 7 novembre 2009, le Président de la République a annoncé la création d’un "Pôle Outremer" au sein de la représentation permanente de la France à Bruxelles, lequel pôle a été mis en place en décembre 2009. Parmi les priorités de ce nouveau bureau figure, entre autres, le projet de transformation en Rup.
"Le statut de Rup de l’UE consolidera à jamais la position des Mahorais"
En tant que PTOM, Mayotte bénéficie depuis 1976 de l’action cruciale de l’Europe au service de son développement mais elle souhaite aller plus loin avec l’Europe. La priorité était d’abord de voir le statut de l’île évoluer au sein de la France, gage de sécurité et de développement. Mais au-delà du rattrapage économique, Mayotte veut viser l’excellence : être présente de manière déterminante et responsable dans l’Océan indien, mener des actions de coopération et de développement avec ses voisins, offrir une mobilité à sa jeunesse, être présente dans le monde dans un contexte de globalisation, relever les défis du XXIe siècle passant par l’éradication de la pauvreté, la maîtrise des outils de développement pour un monde plus juste, solidaire et durable etc. Toute cette ambition suppose deux bases essentielles : être ancrée profondément dans la République, ce qui est le cas depuis le 29 mars 2009, mais surtout être une priorité pour l’Europe en devenant Rup.
Car en devenant Rup, les avantages pour Mayotte seront, sans commune mesure, nombreux et déterminants. Mais Mayotte, tout comme l’ensemble de l’Outremer français, est aussi une chance pour l’Europe : elle représente une zone économique exclusive très importante, dispose de ressources halieutiques non encore exploitées, est dotée d’un parc naturel marin propice à la préservation des espèces rares et aux études de pointe en matière environnementale, compte comme un point d’ancrage essentiel dans la route maritime du Canal de Mozambique, pouvant devenir un appui stratégique non négligeable avec l’autre Rup de l’Océan indien, la Réunion, dans une zone comprise entre l’Afrique de l’Est et Madagascar, une zone à forte navigation maritime vers le Golfe et l’Asie du Sud, etc.
Mais l’Europe, c’est plus qu’une chance pour Mayotte. C’est vital. Le statut de Dom-Rom garantit notre ancrage dans la République. Le statut de Rup de l’UE consolidera à jamais la position des Mahorais et écartera définitivement toute crainte liée aux revendications territoriales d’un pays étranger et sera une force pour endiguer devant la communauté internationale les condamnations injustes et injustifiées liées à la présence légitime de la France à Mayotte.
Récapitulatif des Fed à Mayotte (1975-2013)
|
Période |
Montant |
Programmes principaux |
|
4e Fed (1975-1980) |
ND |
– Adduction d’eau |
|
5e Fed (1980-1985) |
ND |
– Adduction d’eau |
|
6e Fed (1985-1990) |
4,75M€ |
– Electrification rurale – Renforcement de la centrale électrique |
|
7e Fed (1990-1995) |
6,7M€ |
– Adduction d’eau |
|
8e Fed (1995-2000) |
10M€ |
– Assainissement des eaux usées – Traitement des déchets |
|
9e Fed (2000-2007) |
15,2M€ 24,15M€ (Avec le transfert des Fed précédents) |
– Gestion des eaux pluviales – Reboisement – Financement du Centre de traitement des déchets -Financement de l’Unité technique de gestion |
|
10e Fed (2008-2013) |
22,092M€ (Allocation territoriale) |
– Volet territorial : transport, environnement, tourisme -Volet régional : études et recherche sur la biodiversité |
Source : Direction des affaires européennes – Conseil général de Mayotte
26/02/2010 – Transports en commun de Mamoudzou
{xtypo_dropcap}"{/xtypo_dropcap}Le projet est là, il n'y a plus que quelques détails à régler avec les partenaires pour le financement, c'est pourquoi l'essentiel des informations ne seront pas dévoilées", a déclaré laconiquementDjanfar Saïd Mohamed, DGA chargé de l'aménagement et des déplacements à la mairie de Mamoudzou, avant d'annoncer que la conférence de presse était annulée. Dans le communiqué envoyé à la presse, on peut lire qu'il devait être question "de maîtriser l'étalement urbain, créer une ligne express de transports en commun performante, capable de constituer une alternative à l'automobile et favoriser la multimodalité".
Ce projet a été évalué à 5M€, 25% à la charge de l'Etat et 75% à celle de la CDM. La mairie de Mamoudzou l'a conçu en deux phases : elle a d'abord lancé un appel d'offres pour une étude d'optimisation de la circulation sur l'axe RN1-RN2, pour mener des actions "flash" fin 2010-début 2011, afin de décongestionner le trafic le plus rapidement possible. La mairie est actuellement en train de sélectionner un bureau d'études pour réaliser cette première phase.
Pour la deuxième phase, la mairie est en train de finaliser le cahier des charges pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la réalisation de la ligne de bus proprement dite, qui doit s'étaler de Tsoundzou II à Majicavo. L'étude permettra de savoir le nombre d'arrêts nécessaires, les intervalles entre les bus, s'il leur faudra une voie de circulation propre, etc. Mais tout le projet est bloqué à cause du désengagement financier du conseil général…
Une politique des transports sans aucune cohérence
"Nous aurons un blocage total de la circulation dans Mamoudzou dès la rentrée prochaine. C'est une bombe à retardement. Nos élus sont-ils réellement conscients des enjeux des déplacements urbains pour le développement économique de l'île ?", s'interroge une source proche du dossier, qui constate que la mairie n'a aucune garantie que le conseil général va délibérer pour débloquer les crédits nécessaires. "C'est la population qui va pâtir du comportement des élus, car ne pas pouvoir circuler, c'est tuer les activités et les services !"
Le conseil général vient pourtant de lancer le Schéma régional des infrastructures des transports (SRIT), ainsi que l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la création d'une ligne interurbaine de transport collectif. "C'est un paradoxe et un danger, car on s'était mis d'accord sur un mode intermodal pour ceux qui laisseraient leur véhicule dans des parkings à l'entrée de Mamoudzou : cet effort ne servira pas à grand-chose sans transport en commun dans le Grand Mamoudzou", constate notre source. "Si vous partez de Sada et que vous vous arrêtez à Tsoundzou, à quoi ça sert de prendre un bus si le trafic est congestionné ? C'est une politique sans aucune cohérence."
"C'est tout le développement économique de Mayotte qui est compromis dès la rentrée prochaine"
La mairie de Mamoudzou aspire à devenir une Autorité organisatrice de transport urbain (AOTU), c'est pourquoi ni le conseil général ni l'Etat ne peuvent planifier cette compétence communale. Sans la ville de Mamoudzou pour y participer, la politique de transport interurbain du conseil général n'aura aucune portée et le Schéma de déplacement deviendra inopérant.
Les motifs seraient politiques, à la veille des élections de 2011… "Sans la participation financière du conseil général, la population doit savoir qu'elle va être punie durablement", souligne notre source. "Cet enjeu dépasse la politique, ce n'est pas seulement les habitants de Mamoudzou qui vont en pâtir, mais c'est tout le développement économique de Mayotte qui est compromis dès la rentrée prochaine, quand on sait que chaque jour 5 nouveaux véhicules sont mis en circulation."
Les véhicules représentent 54% des gaz à effet de serre produits à Mayotte. Alors que partout ailleurs sur le territoire national, l'Etat encourage à utiliser le moins possible la voiture pour se déplacer, à Mayotte il semble que la politique du conseil général incite à faire le contraire. "On veut devenir un département, mais on ne tient pas compte de la loi sur l'air ou du Grenelle de l'environnement… C'est en contradiction avec ce que veulent les gens ! Mais ce sont des choses qu'on n'ose pas dire ouvertement ici", déplore notre source.
"Chaque jour compte et cela risque de coûter cher, alors que les infrastructures routières continuent de se dégrader et que les trottoirs n'existent pas". Le projet prévoit en effet également des "liaisons douces" pour les déplacements à pied, en vélo, voire en roller…
"Comme pour la "piscine de Kawéni", il faut savoir enterrer la hache de guerre, arrêter de se renvoyer la balle et prendre ses responsabilités", avant que des citoyens ou des chefs d'entreprises indignés bloquent la zone industrielle, peut-être la seule solution pour réparer très rapidement cette route qui appartient au conseil général, comme le plan du cadastre le confirme.
Malheureusement, il semblerait que ce projet structurant de gestion raisonnée des déplacements ne fasse pas partie des priorités du conseil général, qui n'a prévu cette année d'investir que 30 M€, alors que son engagement financier devrait normalement s'élever à 75 M€, si l'on s'en réfère aux engagements initiaux du Contrat de projet.
Julien Perrot
26/02/2010 – Etude sur la productivité et les conditions de travail

{xtypo_dropcap}D{/xtypo_dropcap}ans l'introduction de son rapport, l'Arvise déplore que les préconisations qu'elle avait faites en 2006 pour accompagner le processus de convergence du Smig mahorais vers le Smic national n'aient pas été prises en compte par les partenaires sociaux. Selon elle, le recul de l'emploi, notamment des emplois peu qualifiés au profit d'emplois qualifiés du tertiaire et de l'encadrement, le tassement de la productivité individuelle, la baisse de rentabilité économique dans les plus petites entreprises et l'accroissement de la pression salariale dans un contexte de réduction d'activité confirme une "absence totale de pilotage" depuis la signature de l'accord il y a 4 ans.
Aujourd'hui, les positions des partenaires sociaux sur la mise en œuvre de ce processus sont très contrastées. Pour les représentants des salariés, "la convergence a eu des effets positifs en termes de motivation et d'implication des salariés dans la productivité des entreprises" et constitue pour eux "une première étape de la fin des spécificités mahoraises qui, selon eux, sont un réel frein au développement économique et social de ce territoire".
Mais quelques voix se font entendre sur les risques d'une évolution mal maîtrisée, ne correspondant pas aux enjeux réels du territoire et susceptibles de créer des clivages entre une minorité ayant un emploi et une majorité laissée pour compte, notamment parmi les jeunes, les sans-emplois non productifs et les retraités disposant de revenus faibles à cause du plafonnement actuel des pensions de retraite.
Pour le patronat, "les évolutions en matière de culture d'entreprise ne vont pas aussi vite que celles des salaires"
Pour les représentants patronaux en revanche, "l'accord sur la convergence a été conclu à une époque pour "acheter" la paix sociale, mais les signataires ne pouvaient imaginer à cette époque que les entreprises auraient à traverser une crise aussi désastreuse que celle qu'elles viennent de vivre".
Selon eux, "la plus grande prudence serait de mise pour les futures négociations, car les évolutions en matière de culture d'entreprise, de culture de la promotion sociale, de culture de la valeur ajoutée, ne vont pas aussi vite que celles des salaires. Dans cette course à la rentabilité et à la productivité, les salariés les plus faiblement qualifiés et les Mahorais les plus âgés risquent d'être les premiers perdants, mais aussi les petites entreprises".
D'après les représentants des salariés, la recrudescence du travail illégal et de l'immigration clandestine est un effet pervers du dispositif. Même si l'accord s'est appliqué partout, ils constatent que dans les secteurs du commerce et du gardiennage, les salaires ont tendance "à se niveler par tassement des écarts entre les salaires minima et les niveaux intermédiaires, ce qui crée le mécontentement des salariés des niveaux intermédiaires".
Les syndicalistes demandent un plan d'adaptation des compétences à l'échelle du territoire, constatant que "les entreprises ont une démarche productiviste très accentuée" : comme les jeunes arrivent sur le marché du travail avec des qualifications plus élevées, elles se séparent plus facilement de leurs salariés les plus anciens et âgés. En outre, "les petites entreprises faiblement structurées souffrent de la faiblesse de la formation de leurs dirigeants".
Pour la Cisma-CFDT, la grande majorité des Mahorais non salariés subit les conséquences de l'augmentation du Smig sur le coût de la vie
Tous les représentants des salariés demandent une convergence rapide du Smig mahorais vers le Smic national, à l'exception notable de Boinali Saïd, secrétaire général de la Cisma-CFDT, qui "attache davantage d'importance à la parité entre le coût du travail et le coût de la vie, au rapport entre le prix accordé à la main d'œuvre et l'ensemble de la structure des prix". Pour lui, la convergence a 4 effets pervers : premièrement, l'élévation massive du "salaire plancher" affecte directement le coût de la vie, or le Smig ne concerne qu'une faible partie de la population, la grande majorité des Mahorais subissant les conséquences sur le coût de la vie.
Le second constat de M. Saïd est que toutes les entreprises ne sont pas logées à la même enseigne : l'augmentation du coût de travail dans les grandes entreprises qui interviennent sur le marché public engendre un renchérissement de la dépense publique supportée d'une manière ou d'une autre par la collectivité, alors que les petites et très petites entreprises artisanales, agricoles ou de services doivent retrouver leur rentabilité auprès du consommateur final, qui subit alors de plein fouet l'augmentation du coût de la vie, que ses revenus aient augmenté en tant que salariés rémunérés au Smig ou non.
Quelle richesse supplémentaire a été générée par l'accroissement du coût du travail ?
Son troisième grief est que la convergence telle qu'elle est appliquée est une conception étatique d'aide au salaire qui occulte sa dimension économique et la nécessaire création de richesse. Il se demande ainsi quelle richesse supplémentaire a été générée par l'accroissement du coût du travail. Enfin, les processus de convergence et d'égalité en matière de couverture sociale ont selon lui "tendance à occulter une grande part des véritables enjeux socioéconomiques de Mayotte au profit d'une égalité sociale qui n'est pas aujourd'hui la priorité telle qu'elle est révélée par les Etats généraux de l'Outremer, à savoir la cherté de la vie".
De son côté, le patronat souligne que les entreprises ont supporté une progression rapide du coût du travail et de nouvelles augmentations de charges, alors que le dispositif d'exonération des charges prévu ne s'applique pas encore. Quand les partenaires sociaux ont signé l'accord sur la convergence, ils espéraient que la croissance et les grands projets structurants leur permettraient d'assumer l'accroissement du coût du travail, "mais les entreprises ont fait les frais de la crise financière, de la crise dans le BTP, le retard dans le démarrage des projets structurants pour l'économie mahoraise", notamment ceux inscrits dans le Contrat de projet, sans oublier les retards de paiement qui constituent une plaie pour l'économie locale.
Pour le patronat, l'accroissement du Smig peut menacer l'emploi
"Les entreprises existantes ont fait un effort pour conserver, autant qu'elles le pouvaient, leurs effectifs, mais la perspective d'accroissement de la charge salariale avec les futures négociations peut faire craindre des menaces sur l'emploi", prévient le patronat. Selon lui, il y a également un risque de tensions avec les salariés lorsque des prélèvements supplémentaires seront effectués sur leurs salaires pour accroître la couverture sociale.
La culture du travail doit aussi être davantage ancrée dans l'esprit des salariés : "Il manque une prise de conscience de la création de richesses nouvelles. Le travail ne peut pas être qu'une occupation, il faut qu'il en résulte une rentabilité pour satisfaire les besoins d'égalité sociale auxquels les travailleurs de Mayotte aspirent".
Le patronat constate ainsi qu'"alors que le niveau d'exigences est de plus en plus élevé de la part des donneurs d'ordres, le niveau de productivité et de qualité ne suit pas en entreprise". D'autant qu'à l'avenir, "les salariés peuvent également craindre la mise en compétition avec la main d'œuvre européenne, notamment celle des pays de l'Est".
Selon le patronat, l'augmentation des salaires minimaux a eu très peu de répercussions sur la consommation des ménages. Pour lui au contraire, les conséquences sur l'emploi sont "désastreuses" et l'économie mahoraise est "en chute libre" car "les entreprises ont dû compresser leurs effectifs pour maîtriser leur masse salariale", la seule mesure de gestion qu'elles pouvaient prendre avant de développer de la productivité par l'activité.
Entre 2007 et 2009, les effectifs ont baissé de 3,36%, notamment dans les petites et grandes entreprises
Pour avoir une approche macro-économique, l'étude de l'Arvise a retenu comme indicateur de gestion la valeur ajoutée dégagée par chaque salarié, qui correspond très précisément à la richesse produite à travers l'activité propre à l'entreprise. "L'avantage de cet indicateur est qu'il est calculé de la même façon quel que soit le secteur d'activité", précise le rapport.
Entre 2007 et 2009, les effectifs en équivalent temps plein ont globalement baissé de 3,36%. De manière détaillée, l'étude relève toutefois des disparités importantes : si 42% des entreprises ont effectivement réduit leurs effectifs, 12% sont stationnaires et 46% les ont augmentés de manière continue.
Des disparités qui se retrouvent en fonction de la taille des entreprises : les entreprises de moins de 20 salariés et celles de plus de 150 salariés, subissent une baisse de 15 à 60% de leurs effectifs, alors que la plupart des entreprises de la tranche intermédiaire (plus de 20 et moins de 150 salariés) ont vu leurs effectifs progresser.
Aujourd'hui, plus de 6 salaires sur 10 se situent au-dessus du Smic net
L'analyse détaillée de l'évolution des effectifs par fonctions fait apparaître que les effectifs de production ont baissé de 4,8% (soit 190 équivalent temps plein en mois), ceux de logistique et ceux d'administration et gestion ont crû respectivement de 3,2 et 5,4% (soit 6 et 12 équivalents temps plein), traduisant une progression importante des emplois tertiaires dans les entreprises. Par type d'emploi, l'analyse détaillée révèle que si les effectifs d'ouvriers ont baissé de 14%, notamment dans les grandes entreprises, la fonction d'encadrement est par contre en progression dans les entreprises de taille intermédiaire.
L'effet de la convergence du Smig net vers le Smic net a fait passer les effectifs dont le salaire est supérieur au Smic net de 1.041 à 1.513 équivalent temps plein sur un effectif total de 2.360, soit 45% d'augmentation : aujourd'hui, plus de 6 salaires sur 10 se situent ainsi au-dessus du Smic net.
Avec un indice 100 en 2007, les données économiques générales des entreprises font apparaître "une baisse d'activité, avec un chiffre d'affaires global en baisse de 14 points en 2009 par rapport à 2008, avec peut-être l'impact conjoncturel de la crise financière de 2009, mais aussi une croissance de 9 points par rapport à 2007, sous l'effet sans doute de l'augmentation du pouvoir d'achat des ménages".
Si la masse salariale a augmenté de 13 points, la productivité apparente du travail (le rapport entre la masse salariale et la valeur ajoutée) s'est aussi améliorée de 7 points, étayée par une progression des résultats d'exploitation de 60 points. Enfin, le coût moyen d'un emploi passe de 18.400€ en 2007 à 21.600€ en 2009. Ces chiffres font ainsi dire à l'Arvise que "les gains de productivité semblent donc avoir été trouvés".
Les petites et moyennes entreprises moins bien armées dans la quête de productivité
Mais si on réexamine la situation en occultant les données de 4 grandes sociétés (qui emploient les deux tiers des effectifs de l'échantillon), les résultats sont nettement différents, révélant un résultat d'exploitation en baisse de 38 points et une valeur ajoutée en recul de 12 points. Si les petites et moyennes entreprises subissent la crise financière et enregistrent un renchérissement du coût du travail de la même manière que les grandes, "elles sont moins bien armées dans la quête de productivité", souligne l'étude.
Rapportée à la productivité individuelle (la valeur ajoutée totale divisée par l'effectif moyen), ces chiffres font ainsi apparaître que le niveau moyen de productivité par salarié a globalement progressé de 10,9%, passant de 36.407€ en 2007 à 40.377€ en 2009, il a en revanche baissé de 4,8%, passant de 25.327€ à 24.116€ si on occulte les 4 plus grandes sociétés. Les craintes exprimées par les syndicats et le patronat sur la survie des plus petites entreprises seraient ainsi confirmées par ces données.
La productivité individuelle inférieure de 8.000€ par rapport à la moyenne nationale
En 2007, ce niveau avait déjà été estimé comme étant inférieur de 8.000€ à celui de la productivité moyenne par salarié au plan national. En comparant les chiffres de l'étude avec ceux publiés par l'Insee le 27 janvier 2010 dans son "Panorama des secteurs" s'appuyant sur la base de données Alisse, il apparaît que la productivité individuelle des travailleurs mahorais est très nettement inférieure à la moyenne nationale, à l'exception du secteur "commerce et réparation automobiles" qui est supérieure de 22% (voir tableau).
Ce tableau est cependant "à prendre avec beaucoup de précautions", souligne le rapport, car les indicateurs de Mayotte ne portent au maximum que sur 2 cas d'entreprises et dans la majorité des cas ils ne reflètent la situation que d'une seule entreprise. L'Arvise a également constaté que de nombreuses entreprises mahoraises sont encore très réticentes à divulguer leurs chiffres (voir encadré).
L'absence de mesures d'accompagnement a empêché la relance keynésienne de l'économie
En conclusion, l'étude souligne que "l'absence de mesures d'accompagnement semble constituer le point d'achoppement d'un processus qui misait sur une spirale vertueuse de la relance de l'économie par l'augmentation du pouvoir d'achat (effet keynésien)". Réalisée sous la contrainte réglementaire, l'augmentation du pouvoir d'achat n'a pas été suivie par "un développement de secteurs clé d'activité, de formation des hommes et de développement des compétences des entreprises, d'amélioration des conditions de travail".
C'est pourquoi l'Arvise recommande, pour la dernière étape du processus, c'est-à-dire la négociation collective de l'ajustement du calendrier pour les 15% restants, "une sorte de synchronisation entre le rattrapage du Smic net et éventuellement de la couverture sociale d'une part, et d'autre part les facteurs de productivité du travail (formation, organisation et conditions de travail)", afin d'"enrayer le phénomène de destruction d'emplois et des capacités de production des entreprises qui semble s'être mis en route, sous l'effet de la crise financière".
Enfin, l'Arvise déplore que cette étude ne vienne pas éclairer un "réel projet collectif" construit à partir des visions de développement du territoire des organisations syndicales et patronales.
Julien Perrot
Des entreprises encore très réticentes à divulguer leurs chiffres
La méthodologie de la deuxième phase de l'étude de l'Arvise s'est basée sur une double approche : quantitative sur un panel d'entreprises volontaires, et qualitative auprès des représentants de salariés et d'employeurs (CGT-Ma, UTFO, CFE-CGC, Cisma-CFDT, Medef), ainsi que quelques dirigeants d'entreprises (Sodifram et BDM) et des acteurs socio-économiques (Caisse d'assurance chômage, Tifaki Hazi, Opcalia).
Pour l'analyse quantitative, l'Arvise a diffusé auprès des entreprises sélectionnées dans un échantillon représentatif du tissu économique de Mayotte, une grille de recueil de données sociales et économiques sur les exercices 2007, 2008 et 2009 (prévisions). 90 entreprises figuraient dans le panel d'entreprises contactées, mais seulement 30 ont répondu, représentant environ 3.000 salariés, malgré plusieurs relances.
Après la présentation du rapport provisoire de son étude devant la commission consultative du travail du 20 janvier 2010, l'Arvise a consulté à nouveau les entreprises qui avaient participé à l'enquête "pour lever des doutes sur certaines incohérences qui étaient apparues entre leurs indicateurs de masse salariale et d'effectifs employés". Elle leur a demandé de préciser les effectifs en équivalent temps plein et d'indiquer la masse salariale en incluant les charges sociales, mais seulement la moitié des entreprises ont bien voulu répondre.
L'Arvise constate également que sur les 30 entreprises du panel retenu, 6 n'ont pas complètement rempli les grilles, "ne voulant manifestement pas dévoiler leur chiffre d'affaires, la valeur ajoutée de leur activité, leur résultat d'exploitation ou leur masse salariale". L'analyse quantitative de cette étude s'est donc basée sur 24 entreprises réparties dans 20 secteurs d'activité.
La collecte des données a été pour l'Arvise "une rude affaire à réaliser", car les entreprises mahoraises "ne remplissent pas encore toutes et de manière correcte leur liasse fiscale de résultat d'exploitation" ou plus vraisemblablement parce que "nombre d'entre elles ont délibérément occulté ces données" lorsqu'elles lui ont retourné la grille de collecte.
25/02/10 – Le CG encore une fois aux abonnés absents du Contrat de projet
Mercredi à la mairie de Mamoudzou, une conférence de presse sur le projet de création d'une ligne de transport en commun dans le Grand Mamoudzou, a été annulée à la dernière minute, au grand dam des médias présents et de la vingtaine de personnes invitées à cette réunion, conseillers municipaux de la majorité et représentants des taximen. En cause, le financement du conseil général qui n'a pas été finalisé, alors que cette nouvelle ligne de bus capable de constituer une alternative à la voiture s'inscrit dans le cadre du Contrat de projet 2008-2014. Encore une fois donc, le conseil général est aux abonnés absents pour un grand projet structurant indispensable au développement économique de l'île… Ce projet a été évalué à 5M€, 25% à la charge de l'Etat et 75% à celle de la CDM. La mairie de Mamoudzou l'a conçu en deux phases : elle a d'abord lancé un appel d'offre pour une étude d'optimisation de la circulation sur l'axe RN1-RN2, pour mener des actions "flash" fin 2010-début 2011 afin de décongestionner le trafic le plus rapidement possible.
La mairie est actuellement en train de sélectionner un bureau d'études pour réaliser cette première phase. Pour la deuxième phase, la mairie est en train de finaliser le cahier des charges pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la réalisation de la ligne de bus proprement dite, qui doit s'étaler de Tsounzou II à Majicavo. L'étude permettra de savoir le nombre d'arrêts nécessaires, les intervalles entre les bus, s'il leur faudra une voie de circulation propre, etc. Mais tout le projet est bloqué à cause du désengagement financier du conseil général… "Nous aurons un blocage total de la circulation dans Mamoudzou dès la rentrée prochaine. C'est une bombe à retardement. Nos élus sont-ils réellement conscients des enjeux de déplacements urbains pour le développement économique de l'île ?" s'interroge une source proche du dossier, qui constate que la mairie n'a aucune garantie que le conseil général va délibérer pour débloquer les crédits nécessaires. "C'est la population qui va pâtir du comportement des élus, car ne pas pouvoir circuler, c'est tuer les activités et les services !".
Le conseil général vient pourtant de lancer le Schéma régional des infrastructures des transports (SRIT), ainsi que l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la création d'une ligne interurbaine de transport collectif. "C'est un paradoxe et un danger, car on s'était mis d'accord sur un mode intermodal pour ceux qui laisseraient leur véhicule dans des parkings à l'entrée de Mamoudzou : cet effort ne servira pas à grand-chose sans transport en commun dans la Grand Mamoudzou", constate notre source. "Si vous partez de Sada et que vous vous arrêtez à Tsoundzou, à quoi ça sert de prendre un bus si le trafic est congestionné ? C'est une politique sans aucune cohérence". La mairie de Mamoudzou aspire à devenir une Autorité organisatrice de transport urbain (AOTU), c'est pourquoi ni le conseil général ni l'Etat ne peuvent planifier cette compétence communale. Sans la ville de Mamoudzou pour y participer, la politique de transport interurbain du conseil général n'aura aucune portée et le Schéma de déplacement deviendra inopérant. Les motifs seraient politiques, à la veille des élections de 2011… "Sans la participation financière du conseil général, la population doit savoir qu'elle va être punie durablement", souligne notre source. "Cet enjeu dépasse la politique, ce n'est pas seulement les habitants de Mamoudzou qui vont en pâtir mais c'est tout le développement économique de Mayotte qui est compromis dès la rentrée prochaine, quand on sait que chaque jour 5 nouveaux véhicules sont mis en circulation".
25/02/10 – Deux députés et deux circonscriptions
La loi n°2010-165 du 23 février 2010 ratifiant l'ordonnance n°2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés, vient d'être publiée au Journal officiel du 24 février. Cette loi confirme un nouveau député de plus pour Mayotte, avec la création de deux circonscriptions pour les élections législatives du 19 juin 2012 : au Nord avec les cantons de Mamoudzou I et II, Koungou, Dzaoudzi-Labattoir et Pamandzi, Bandraboua, M'tzamboro, Acoua et M'tsangamouji et au Sud avec les cantons de Mamoudzou III, Tsingoni, Chiconi, Sada, Ouangani, Chirongui, Bouéni, Kani-Kéli, Bandrélé et Dembéni.
24/02/10 – Lancement officiel du 4ème concours talents Mahorais
Créateurs, créatrices, à vos bulletins d'inscription ! La quatrième édition du Concours talents mahorais de la création d'entreprise est officiellement ouverte. Depuis onze ans au niveau national, trois ans à Mayotte, ce concours récompense, dans trois catégories différentes – talent des services, talent du commerce et de l'artisanat et talent des dynamiques rurales -, les initiatives des créateurs d'entreprises de tous âges, qui ont été accompagnés dans leur projet par des structures d'aide à la création (Boutique de Gestion, Adie, CMA, Capam et CCI). A partir d'aujourd'hui donc, et jusqu'au 30 avril 2010, peuvent s'inscrire tous les entrepreneurs qui se sont lancés entre le 1er janvier 2009 et le 31 mars 2010 (Kbis à fournir). Le dossier de candidature est disponible auprès des structures d'accompagnement ou téléchargeable sur le site www.concours-talents.com
Pour chacune des trois catégories, les dotations des prix s'ordonnent comme suit : 5.000€ pour le lauréat, dont le dossier est envoyé à Paris pour participer au concours national, 3.000€ pour le prix spécial du jury, 1.500 euros pour les coups de coeurs du jury et 1.000€ offert par les trois chambres consulaires pour le meilleur jeune artisans (CMA), le meilleur commerçant (CCI) et l'initiative agricole de l'année (Capam). La Boutique de gestion, organisatrice de l'événement avec le soutien de la préfecture (qui assure la plupart des financements), a su pérenniser de solides partenariats, puisque cette année encore le Rotary club, la Poste, la BFC et le Crédit Agricole devraient se positionner comme de véritables partenaires en offrant une partie des dotations financières aux vainqueurs.
Les jurys des trois catégories sont composés d'acteurs locaux de la création et du soutien au développement économique mahorais, et retiendront comme critères le parcours du candidat (capacité à entreprendre, à développer et à adapter son projet, motivation), la viabilité économique et les démarches de créations (études de marché préalables, élaborations des prévisionnels, cohérence des choix). Pour cette édition 2010, les organisateurs espèrent que les talents mahorais renoueront avec les distinctions nationales, comme en 2007 et 2008, et que les candidatures seront encore plus nombreuses qu'en 2009 (48 dossiers comptabilisés).
24/02/10 – Stabilité des prix en janvier
Selon la dernière lettre d'information de l'Insee Mayotte, au mois de janvier 2010, l'indice des prix reste stable (+0,0%). Sur un an, il a augmenté globalement de 0,6%. Les prix du poste "produits alimentaires et boissons" augmentent ce mois-ci de 0,2%, principalement en raison de la hausse des prix des "boissons alcoolisées", des "produits céréaliers" et des "produits frais", (respectivement + 1,7%, + 1,5% et + 1,3%). Cette hausse est atténuée par la baisse des prix des postes "viandes et volailles" et "oeufs et produits laitiers" (respectivement – 0,8% et – 0,5%).
L'indice des prix du poste "produits manufacturés" est en hausse de 0,1%. Ce sont les prix du poste "meuble" qui augmentent le plus (+ 1,2%), suivi du poste "véhicules" (+ 1,0%) dont l'augmentation est due à des fins de promotions. Les prix des postes "audio-visuel, photo et informatique" et "habillement et chaussures" sont en baisse (respectivement de – 1,5% et – 0,6%). Sur un an, les prix des "produits manufacturés" ont augmenté de 0,4%. Toujours selon l'Insee, les prix de "l'énergie" et du "tabac" restent stables, et ceux des "services aux ménages" enregistrent une diminution de 0,3% en janvier. Ce sont essentiellement les prix du poste "transports et communications" qui sont en baisse (- 1,0%), du fait de la baisse de certains tarifs aériens. Toutefois, l'augmentation sur un an dans le secteur des "transports et communications" reste importante (+ 7,5%).
24/02/10 – Le Snuipp revient sur l’indexation
Suite à l'envoi de son appel à la grève pour le mardi 23 mars, jour de mouvement national, le syndicat majoritaire de l'enseignement primaire sollicite des négociations avec le vice recteur et le préfet de Mayotte au sujet de l'indexation des salaires des enseignants du premier degré, un des points de revendications les plus importants. "Le Snuipp Mayotte revendique un taux d'indexation des salaires qui ne peut être en dessous du taux fixé dans les Dom (entre 40% et 50%), qui tient compte du taux de l'indemnité d'éloignement accordé aux agents détachés à Mayotte (environ 95%) et qui se base sur l'arrêté d'avril 1972 (115%)", précise le courrier envoyé à MM. Cirioni et Derache, qui comprend pas moins de 12 arguments en faveur de cette indexation réclamée depuis plusieurs années.
23/02/10 – 3 barges sur 4 ne peuvent plus naviguer
Depuis vendredi, le trafic des barges est fortement perturbé et les horaires ne sont plus respectés. En cause, l'état déplorable des barges, dont 3 sur 4 n'ont plus de certificat de navigabilité. En effet, vendredi a eu lieu une visite de contrôle des Affaires maritimes pour vérifier que les prescriptions qu'elles avaient émises en novembre 2009 pour des défauts de maintenance et de gestion à bord, ont bien été respectées. Il s'est avéré que non seulement ces recommandations n'ont pas été suivies d'effets, mais que d'autres défauts de maintenance ont également été découverts, nous confirme la préfecture, le conseil général et la direction du STM ayant refusé de répondre à nos questions. Heureusement, un des deux amphidrômes a été réparé ce week-end… Il n'y a donc plus qu'une seule barge et deux amphidrômes pour assurer les rotations, qui se font au coup par coup, quand le nombre de passagers maximum est atteint.
23/02/10 – La Cisma-CFDT se restructure autour de ses 11 branches
La semaine dernière, une session de formation de 5 jours dirigée par Jean-Jacques Manach, délégué aux Dom-Tom auprès du secrétariat confédéral de la CFDT, a permis à la Cisma- CFDT d'engager un travail de restructuration autour des secrétaires de ses 11 branches. "Aujourd'hui, le fonctionnement de notre syndicat tend à faire prédominer la relation à un seul chef", explique Boinali Saïd, le secrétaire général, en parlant de lui-même. "Bientôt, chaque secteur aura son identité et vocation à signer des conventions collectives ou des protocoles d'accord dans chaque branche professionnelle. Nous allons nous efforcer de distribuer les responsabilités mais c'est un apprentissage, pour mettre en place une démocratie à l'intérieur de notre syndicat pour qu'il n'y ait plus qu'une seule personne qui décide. Cette spécialisation des militants permettra d'augmenter la richesse syndicale", se félicite M. Saïd. Grâce à cette restructuration, les chefs de chaque secteur pourront contacter directement leurs fédérations à Paris pour négocier les aspects techniques avec les différents ministères.
Des partenariats et des conventions professionnelles et interprofessionnelles pourront ainsi se nouer plus facilement avec leurs homologues métropolitains. "L'enjeu est que les secrétaires des 11 syndicats s'approprient les dossiers et s'émancipent du chef, avec des méthodes partagées", explique M. Manach. "On veut arriver au modèle réunionnais qui fonctionne ainsi depuis une quarantaine d'années", sachant que le premier Congrès de la
Cisma-CFDT de Mayotte ne remonte qu'à 1994. "L'appui technique au niveau des ministères permettra de renforcer notre capacité d'intervention et d'interpeller l'extérieur", précise Boinali Saïd, qui a insisté pour que la formation soit aussi axée sur la fiabilité des comptes et la transparence financière de chaque syndicat. L'objectif est d'atteindre ce nouveau mode de gouvernance d'ici la fin de l'année, avant le prochain Congrès qui doit se tenir en février 2011.
23/02/10 – Festival de l’image sous-marine : les concours sont lancés
Le Festival de l’image sous-marine débutera le 28 mai prochain, mais d’ores et déjà les différents concours sont ouverts, et ce jusqu’au 25 mai.
Comme chaque année, un concours de dessin est ouvert aux scolaires. Le dessin retenu deviendra l’affiche officielle du festival de l’image sous-marine 2011 et les 15 meilleurs dessinateurs se verront offrir une journée nautique à la plage de Trévani avec baptême de plongée offert par Mayotte Lagoon.
Il y a aussi les concours de films (de 4 à 52 minutes), photographies (diaporama de 6 minutes maximum ou portfolio de 10 photos) et enfin musique (composition libre et inédite de 6 minutes maximum).
Pour s’inscrire, il suffit de retirer un dossier auprès de la Dilce (service culturel rue Mamawé).
Rappelons que le film "Les remparts d’Atlantis", primé l’année dernière à Mayotte, a remporté le Prix de l’insolite lors du Festival mondial de l’image sous-marine à Marseille.
23/02/10 – Les Editions du baobab vendent en ligne
La maison d’édition mahoraise propose désormais la vente en ligne de ses ouvrages via son site internet : www.editionsdubaobab.com. Un catalogue d’une cinquantaine d’ouvrages est proposé en ligne, quant à ceux qui ne figurent pas encore dans cette liste, ils doivent faire l’objet d’une demande par mail.
"Les Éditions du baobab œuvrent depuis plus de 10 ans à la promotion de l'île de Mayotte, de ses auteurs et à la protection et la transmission du patrimoine mahorais par l'édition d'ouvrages dans des domaines très diversifiés (guides, roman, beaux livres, nouvelles, poésie, scolaire, jeunesse) ayant pour sujet principal l'île de Mayotte et sa proche région", indique le site internet.
Une belle vitrine pour la littérature mahoraise.
22/02/10 – Fin de la grève au Centre Hospitalier de Mayotte
Au terme de près d'une semaine de grève, un protocole d'accord a été signé vendredi entre la direction du Centre hospitalier de Mayotte et les formations syndicales CGT-Ma, Cisma- CFDT, UTFO et CFE-CGC. Ainsi, il a été acté que les contractuels non renouvelés en début d'année seront réembauchés à compter du 1er mars pour une durée de 6 mois. Pendant la durée de ce contrat, chaque salarié bénéficiera d'un accompagnement personnalisé pour définir un projet professionnel en vue d'aboutir à un emploi durable. Cet accompagnement pourra être assuré par Pôle emploi ou tout prestataire spécialisé. Le CHM et la DTEFP signeront prochainement une convention afin de financer les actions de formation qui seront considérées comme utiles pour la réalisation du projet professionnel de chacun des bénéficiaires. Un comité de suivi de cette opération a été constitué, il se réunira tous les deux moi
La demande de réalisation d'une étude sur l'organisation service de lingerie et de restauration, avec possibilité de les intégrer à l'hôpital a été acceptée. Les conclusions de cette étude devront être présentées pour avis aux représentants du personnel et à toutes les instances délibérantes. Comme annoncé dans les propositions de la direction et de l'Etat, le Comité de gestion des œuvres sociales est attendu pour 2011. De même, la question de la majoration Outremer relève des travaux gouvernementaux dans le cadre de la départementalisation et ne peut être décidée pour le secteur hospitalier seul. Enfin, le protocole d'accord stipule qu'aucune sanction ne sera prise à rencontre des personnels grévistes, les jours de grève seront retenus sur le traitement des grévistes dans la limite de trois journées. Les retenues pourront être étalées dans le temps.