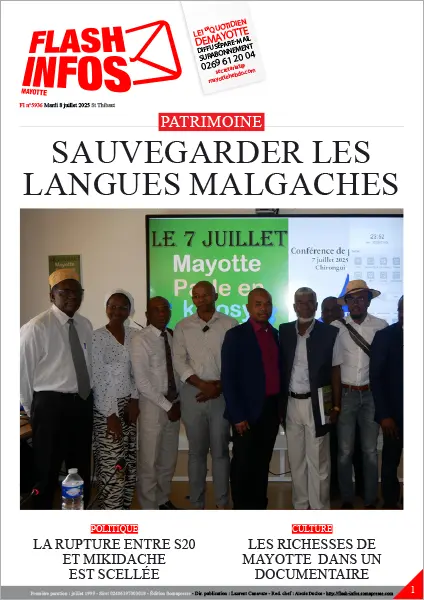Le groupement du Service militaire adapté de Mayotte organise sa 14e journée « portes ouvertes » le dimanche 13 juin 2010 à Combani.
De 09h00 à 18h00, une multitude d’activités à partager en famille ou entre amis. En se promenant dans les allées du GSMA, un cadre féérique se dévoile. Le village du GSMA présentera ses 15 filières de formation. Sur le marché des exposants, une cinquantaine d’entrepreneurs et d’artisans présenteront leurs savoir-faire et tenteront les visiteurs par leurs produits. Les stands « détente » permettront aux petits comme aux grands de jouer et « s’éclater » voire de faire un baptême de plongée en piscine.
Des animations, Break dance, salsa, danses traditionnelles, arts martiaux mais également démonstrations d’engins de travaux publics et tout-terrain, ainsi que mise en valeur des savoir-faire de la gendarmerie et des pompiers ponctueront cette journée.
Des stands de restauration et des buvettes seront au service des visiteurs tout au long de ce « voyage ».
Cette année la tombola est exceptionnelle avec 2 voitures à gagner : une Citroën C3 et une Renault Kangoo offertes par nos partenaires SMCI et RENAULT SOMIVA mais également un scooter offert par TECMA et de nombreux autres lots. Le tirage est prévu à 18h00.
Pour clore cette extraordinaire journée, la municipalité de Tsingoni offre Lathéral et Bo Houss en concert sur le stade de Combani à 20h00.