Mayotte… Aaaaah Mayotte ! On la connait pour de nombreuses choses. Mayotte : la bonne dernière, l’île à la traîne, l’île en retard, etc. Mais Mayotte, c’est aussi des performances à la pelle. Démographie impressionnante, immigration, équipements sportifs, difficultés scolaires ou encore réussite aux examens. Retournons le classement, et nous ne sommes plus derniers, mais premiers !
Pour décomplexer un peu la situation de notre île, Mayotte Hebdo a donc choisi cette semaine d’inverser le baromètre et de vous parler, non de Mayotte la dernière, mais de Mayotte qui arrive première.
En ligne de mire : une volonté de faire bouger les lignes en magnant l’ironie, mais aussi celle de faire la lumière sur tous ces points qui entravent ou contribuent à bloquer le développement tant attendu de l’île. L’occasion aussi, peut-être, de mettre le doigt sur des solutions : après tout, dans cet état de fait pour le moins compliqué, Mayotte n’est-elle pas capable de construire un collège et demi par an? N’a-t-elle pas une croissance économique record en France? N’obtient-elle pas des résultats scolaires en hausse? Mayotte, au fond, n’est-elle pas en train de combler son retard ?
[IMMIGRATION] Loin devant la métropole toute entière

C’est sans doute le record que tout le monde connait de Mayotte : le nombre de migrants qui arrivent sur son territoire. Alors que la métropole s’affole de la « Jungle de Calais », l’île aux parfums, elle, fait course en tête: presque la moitié de sa population est étrangère.
À Mayotte, 40% de la population est étrangère : en termes d’immigration, aucun autre département français ne saurait – et d’ailleurs ne voudrait – rivaliser avec Mayotte. C’est une performance sans commune mesure. En comparaison, la Guyane, pourtant elle aussi sujette à des flux migratoires importants compte 35% d’étrangers, et la Seine-Saint-Denis, département qui en accueille le plus en métropole, culmine à 21 petits pourcents. En somme : loin, très loin, derrière nous.
Parmi cette population étrangère, une partie est en situation irrégulière et peut donc être reconduite à la frontière. Là aussi, les chiffres parlent d’eux-mêmes : en 2015, la métropole a expulsé de force un peu plus de 15000 étrangers en situation irrégulière sur le territoire. À Mayotte, ils étaient cette même année près de 20000. À nous tout seuls, petit caillou de 370 km2 isolé dans le canal du Mozambique, peuplé de 212000 habitants (au dernier recensement) nous pouvons donc nous targuer d’infliger une véritable gifle à l’hexagone, ses 575000 km2, et ses 64,5 millions de métropolitains. Pas mal n’est-ce pas? Notons que ce chiffre devrait, selon toutes vraisemblance, augmenter encore cette année : fin août, 14000 reconduites avaient déjà eu lieu, soit 20% de plus que l’année dernière à la même période.
Et n’abordons pas la problématique des mineurs isolés étrangers, estimés à 8000 en métropole par l’association France terre d’asile, et qui sont tout aussi nombreux rien qu’à Mayotte.
Évidemment, dans la catégorie « immigration », notre île détient le palmarès du nombre de personnes qui transitent par son centre de rétention administrative : 17461 en 2015.
→ Des comportements « tolérés »
Cette pression migratoire intense, couplée à un vraisemblable désintérêt de l’État français sur la question, débouche automatiquement sur des phénomènes incontrôlés. Ainsi, l’île aux parfums a pu faire parler d’elle ces derniers mois grâce à ce qui est communément appelé désormais « décasages », l’expulsion forcée des étrangers de leurs habitations en dehors de tout cadre légal. Des comportements qui, ailleurs en France, auraient suscité l’émoi et l’indignation de la classe politique. Ce ne fût pas le cas ici, ou à moins ampleur.
Le record de Mayotte en ce qui concerne l’immigration ne se limite donc pas qu’à des chiffres. Elle suscite également parmi ses habitants une exaspération… record.

[SANTÉ] Le plus grand désert médical

Dans son indicateur de développement humain (IDH), Mayotte est certainement le département de France dans lequel il existe le plus grand désert médical, et son corollaire, le manque d’attractivité.
Le chiffre qui illustre le mieux le paradoxe, petit territoire mais désert médical géant : 58. Il s’agit du nombre de médecins généralistes présents à Mayotte pour 100.000 habitants.
Par comparaison, en métropole ce chiffre atteint les 156 médecins pour 100.000 habitants, et 136 pour 100.000 à La Réunion.
En dehors des généralistes, le nombre de spécialistes est lui aussi révélateur du manque de l’offre de soin. On ne trouve que 40 spécialistes pour 100.000 habitants à Mayotte contre 183 en métropole et 136 à La Réunion. Pour certaines spécialités comme les audioprothésistes ou les orthoptistes, c’est même pire, ces spécialités n’existent pas à Mayotte. Idem pour les dermatologues ou les stomatologues.
Et l’offre de soins privés est très peu répandue : il n’existe qu’un seul établissement de soin, le Centre hospitalier, là où La Réunion dispose de 10 hôpitaux, alors même que le différentiel de population n’est que de un habitant à Mayotte pour 4 (plutôt trois en tenant compte de l’évolution de la démographie depuis le recensement de 2012) à la Réunion.
Mais Mayotte peut aussi compter sur son réseau d’une douzaine de dispensaires, relativement bien équipés, hormis en personnel médical.
Dans certains domaines néanmoins, le retard de Mayotte est criant. L’ile au lagon a peu de capacité d’accueil en milieu hospitalier. Les lits disponibles au quotidien ne dépassent pas les 313 contre plus de 1700 pour La Réunion, et encore en comptant 109 lits réservés à la gynécologie obstétrique. Dans le domaine de la psychiatrie, il n’existe qu’une dizaine de places et aucune pour les enfants.
Le seul domaine médical dans lequel on peut affirmer que Mayotte est bien pourvue, reste la médecine périnatale. Même si le nombre de lits tend rapidement à arriver à saturation, Mayotte compte près de 158 sages-femmes contre moins de 400 à La Réunion, ce qui correspond à une densité deux fois supérieure en sages-femmes à celle de la métropole.
Les causes de cet écart entre Mayotte et les autres départements tiennent à la fois à un retard historique et un rattrapage qui n’a jamais été efficient. « On court après les urgences et on fait du provisoire », expliquait récemment encore un médecin.
Mais on peut aussi mettre l’absence de personnel médical sur le compte du manque d’attractivité, qui est une conséquence de phénomène plus récents comme la délinquance, mais aussi du sous-équipement (manque d’établissement privé dans le second degré, manque d’activités de loisirs, coûts des déplacements hors territoire). Les incitations financières qui sont conséquentes suffisent à peine à remplir le quota minimum nécessaire pour assurer les soins
Enfin, les données ne prennent pas en compte le recours à la médecine traditionnelle à laquelle a encore recours une couche importante de la population. Même si l’impact de la médecine traditionnelle est difficile à quantifier en termes de statistiques, il semble que nombre de pathologies soient ainsi soignées en amont.
[DÉMOGRAPHIE] La plus grande maternité de France

La maternité de Mamoudzou détient le record de France du nombre annuel de naissances.
On a dénombré en 2015 plus de 9000 naissances au Centre hospitalier de Mayotte et on table sur plus de 10.000 pour l’année en cours. Cette augmentation fait suite à une baisse importante à partir des années 2007 où, après un pic record à 7941 naissances, on était repassé sous la barre des 7000 naissances en 2011, 2012 et 2013 (6644 naissances).
Le compteur s’est à nouveau emballé par la suite. Dans le lot, environ 400 à 500 naissances se produisent hors des centres de soins de Mayotte chaque année.
A ces chiffres, déjà bien connus, on peut ajouter le nombre de grossesses adolescentes qui arrivent à leur terme, supérieures à 300 chaque année, dont une quarantaine concerne des jeunes filles âgées de moins de 15 ans. De même, le nombre de naissances prématurés (1,6%) est égal à celui de La Réunion, mais plus important qu’en métropole (0,7%).
Mayotte est par conséquent championne pour les naissances avec un taux de fécondité de 164 pour 1000 femmes âgées de 15 à 49 ans. Ce qui signifie que près de 1 femme sur 6 en âge de procréer accouche chaque année.
Officiellement, le recensement de la population en 2012 a dénombré 212 645 habitants. Un nombre contesté par la population et par les chiffres eux-mêmes, puisque la différence entre le nombre de naissances et de décès de 2007 à 2012 laisse apparaitre un accroissement naturel bien supérieur à 30 000 personnes sur la période (et donc une population supérieure aux 212 645 habitants annoncés), hors flux migratoires.
Un nombre auquel il convient d’ajouter les fonctionnaires métropolitains dont la quantité augmente chaque année, suivant les besoins dans l’enseignement et dans les services de santé. L’immigration est, elle aussi, en constante augmentation sur la période.
Le prochain recensement total de la population qui aura lieu cette année, et dont les résultats seront connus en 2017, permettra peut-être de rectifier les inexactitudes relevées par l’Insee en 2012.
A noter que Mayotte bat aussi deux autres records, celui de la population la plus jeune (50% de la population est âgée de moins de 20 ans) et celui du plus faible taux de mortalité de France qui est une conséquence directe de la jeunesse de la population (le chiffre s’établit à 3,1 décès pour 1000 habitants, contre 5,1 à La Réunion et 8,7 en Métropole).
Concernant l’espérance de vie, il se situe à 73 ans en 2015, soit 7 points en dessous de l’espérance de vie à La Réunion et 9 points en dessous de celle de la Métropole. A noter que l’écart d’espérance de vie des hommes et des femmes à Mayotte est très faible (moins de 2 ans) par rapport à la Métropole ou encore à La Réunion (6 à 7 années d’écart).
[ÉDUCATION] Des records à la pelle

Classes surchargées, illettrisme impressionnant, taux d’échec record : en matière d’éducation, Mayotte atteint elle aussi des records. De quoi donner envie de tout faire pour que bougent enfin les lignes. Revue.
Le chiffre des naissances à Mayotte est bien connu : 9000 en 2015. Et cette année il devrait franchir sans mal la barre des 10000. Pour assurer l’éducation à venir de toute cette jeunesse, il faudrait construire une salle de classe par jour. Un premier record qui nous emmène à la triste mise en place du système des rotations en primaire, les 180 écoles existantes ne suffisant pas. Un système pourtant oublié partout ailleurs. Dans ces conditions ingérables, il est difficile de remédier à un des problèmes numéro des jeunes de Mayotte : l’illettrisme.
Si les départements d’outre-mer sont traditionnellement plus touchés que l’Hexagone par le sujet, c’est Mayotte qui remporte la palme de l’illettrisme avec un taux de 50,9%, tous âges confondus. En cause : la prévalence du shimaoré dans de nombreuses familles. Si la pratique du français tend à se généraliser dans les foyers, le problème pèse encore sur les jeunes Mahorais.
Dans une étude réalisée en 2015 lors de la journée d’appelle à la défense, et publiée par le quotidien national Le Parisien*, on apprend que le taux de jeunes en difficultés de lecture est de 74,6% à Mayotte – là encore un record – alors qu’il n’est « que » de 48,2% en Guyane (département d’outre-mer qui sert souvent d’élément de comparaison avec Mayotte pour les problèmes équivalents qu’elle connait), 34,6% en Martinique et 16,73% dans l’Aisne, département métropolitain le plus touché.

→ Dernier au baccalauréat
Forcément, cet état de fait joue sur la réussite de nos jeunes. Ainsi, si le taux de réussite du brevet des collèges dépasse cette fois-ci pour la première fois celui de la Guyane (80% à Mayotte contre 75,5% en Guyane), il n’en va pas de même pour les résultats du baccalauréat pour lesquels Mayotte se classe bonne dernière cette année encore : 69,7% chez nous, pour un taux de réussite moyen national de 88,5%. En somme : presque 20 points de retard, et quinze sur la Guyane.
Alors, on pourrait se dire que malgré ces chiffres, les jeunes diplômés ont toutes leurs chances une fois acquis le précieux sésame. Malheureusement, ce n’est pas le cas. Le taux de réussite des jeunes mahorais en première année d’études supérieures en métropole est de moins de 15%. Autant dire très faible, et très handicapant.
Souhaitons donc que la situation s’inverse dans les années à venir, notamment grâce à deux autres records : celui du rythme des constructions scolaires – on construit par exemple un collège et demi par an -, et le fait que Mayotte soit le seul département de France à être entièrement classé en zone d’éducation prioritaire. Ah, et nous allions oublier un dernier record : le nombre d’enseignants contractuels, qui représente environ un tiers des effectifs chez nous, contre seulement 7 à 8% en métropole.
[ÉCONOMIE] Mayotte, championne du taux de croissance du PIB

Depuis une quinzaine d’années, Mayotte peut se targuer d’une croissance économique supérieure à la métropole et aux autres départements d’outre-mer (DOM). De quoi se réjouir? Pas vraiment. Car en dépit du rattrapage économique en cours, l’écart est encore important.
Produit intérieur brut : +6,8%. Le taux de croissance du PIB de Mayotte enregistré en 2012 par l’INSEE est largement supérieur à celui de La Réunion (+2,4%) et de la métropole (+1,5%).
Sur la période 2008-2013, la croissance (+4,2%) est plus dynamique que dans toutes les autres régions françaises. Elle est 10 fois supérieure à la croissance annuelle moyenne française (+ 0,4%) et 4,5 fois plus rapide qu’à La Réunion.
De 2000 à 2008, la croissance économique est très forte à Mayotte (+ 9,3 % par an en moyenne). Elle est plus de 5 fois supérieure à celle de la France (+ 1,7 %) et plus de 2 fois supérieure à l’ensemble des DOM. Sur la même période, le PIB progresse en volume de 4,5% par an en Guyane, de 4,2 % par an à La Réunion, de 3,7 % en Guadeloupe et de 2,5 % en Martinique.
La crise de 2008 est un tournant économique pour l’ensemble du territoire français mais l’impact est différent selon les régions. À Mayotte, l’activité ralentit nettement, passant à + 4,2 % par an entre 2008 et 2013. La croissance mahoraise est pourtant restée bien plus dynamique que dans toutes les autres régions françaises. Elle était 10 fois supérieure à la croissance annuelle moyenne française (+ 0,4%) et 4,5 fois plus rapide qu’à La Réunion.
Ces dernières années, Mayotte a donc bénéficié d’une croissance dynamique, qui illustre le rattrapage économique en cours par rapport à la France métropolitaine et aux autres DOM.
Un gros bémol est toutefois à apporter : l’écart reste important. Le PIB par habitant (7940 euros en 2012) reste ainsi très éloigné des autres régions françaises. Il est quatre fois plus faible que dans le reste de la France (31 100 euros par habitant) et deux fois et demie plus faible que dans les autres DOM (19 400 euros).
En outre, le niveau de vie médian des ménages mahorais en 2011 était de 384 euros par mois, contre 1 599 euros pour la France métropolitaine.
Le dernier élément qui montre que Mayotte est encore à la traîne en termes de développement économique est le seuil de pauvreté. En 2011, 84 % de la population mahoraise vivait sous le seuil bas de revenus national (959 euros par ménage), contre 16 % en France métropolitaine.

[SPORT] Infrastructures sportives : Mayotte, dernière… évidemment

Tous les Mahorais s’accordent à dire que le potentiel du sport et des sportifs locaux est considérable. Mais, sans piscine municipale, dojo, ni stade territorial homologué, l’île manque cruellement d’infrastructures sportives nécessaires pour le développement. Ce potentiel tant loué est de fait difficilement exploitable.
En 2016, quel département de France n’a aucune piscine municipale, aucun dojo, aucun stade homologué ? Mettons de côté les Dom-Tom. Si l’on se concentre sur la métropole, nous pouvons aller plus loin encore en posant la question suivante : quelle ville de France n’est pas dotée de l’une de ces trois infrastructures sportives ?
Nous pourrions chercher longtemps, il serait difficile de trouver. Une étude du site Info-Pharma.org datant de mai dernier identifie les grandes villes sportives de France. Avec 43,3 salles de sports pour 100 000 habitants, Angers est en tête, devant Grenoble (41,8), Nantes (39,9), Bordeaux (38,6) et Reims (37,8).
Les 150 000 Angevins jouissent de six piscines municipales, 15 pistes d’athlétisme, 54 courts de tennis, 42 terrains de football équipés de tribunes et de vestiaires, un centre régional de judo, quatre terrains de rugby, 40 salles spécialisées ou encore de 23 gymnases ! Mayotte est donc à des années lumières d’Angers, alors qu’il s’agit d’une ville et que nous sommes… tout un département ! Zéro piscine municipale, zéro dojo, zéro stade territorial digne de ce nom.
« Nos mauvais résultats sont dus à l’absence de lieux de pratique permanents »
Il faut se rendre à Chiconi pour trouver trace d’un stade équipé de vestiaires. A ce jour il est le seul et l’unique sur l’île. Concernant les halles de sports, les milliers de sportifs doivent se partager deux gymnases : un en Petite-Terre et un en Grande-Terre. Difficile ainsi de pratiquer et développer des sports de salle, comme le regrette Toumbou Ambdillah, président de la ligue de tennis de table de Mayotte. Il l’explique : « Nos mauvais résultats aux Jeux des îles et aux Jeux de la CJSOI sont dus à deux choses principalement : notre manque de cadres techniques et l’absence de lieux de pratique permanents. Nous avons un gymnase à nous partager avec des milliers d’usagers et forcément, notre temps de pratique est insignifiant comparé au besoin. Un créneau, deux créneaux par semaine : c’est évidemment trop peu pour progresser et être au niveau de nos adversaires lors de compétitions régionales. »
Football, basket-ball, handball, volley-ball, rugby, tennis, sports de combat, etc. : peu importe la discipline, le constat est le même. Si, en termes de formations de cadres, les choses se mettent doucement en place dans certains sports, les sportifs mahorais manquent tous cruellement d’infrastructures dignes de ce nom.
En février dernier, le Conseil départemental de Mayotte a lancé l’un des plus gros travaux sportifs depuis longtemps : la rénovation du stade territorial de Kavani. Une pelouse synthétique, une piste d’athlétisme, un parking, des tribunes, des vestiaires vont pousser d’ici fin 2017. Une fois achevé, le stade sera homologué et Mayotte pourra accueillir des matchs et autres meetings régionaux, voire nationaux.
Il n’empêche, dans ce domaine, notre île a encore un retard fou à rattraper comparé aux autres départements : le manque d’infrastructures sportives. Si, comme partout ailleurs, les sportifs mahorais aspirent à être numéro un, voici là un titre qu’ils remportent haut la main… mais dont ils se passeraient bien.








































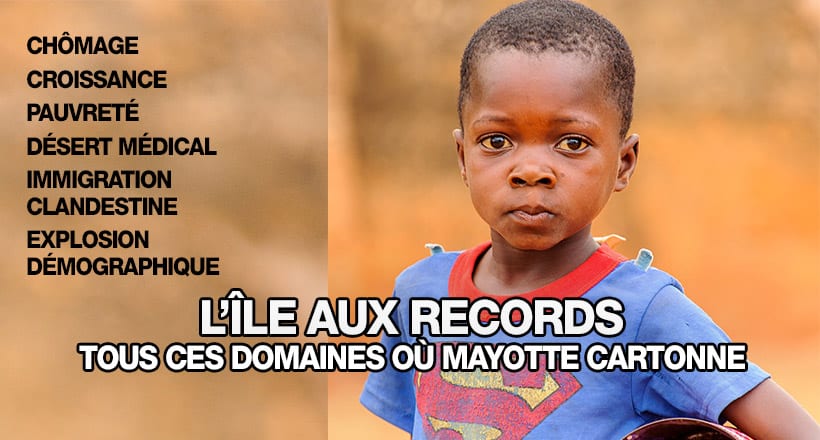











.jpg)


















