Les votes sont ouverts !
Ce vendredi, la Société mahoraise de presse lance la neuvième édition des Trophées Mayotte Hebdo du Sportif de l’année. Cet événement a vocation a récompensé celles et ceux ayant marqué l’année sportive 2017, de par leurs performances ou leur engagement dans leurs disciplines respectives. Pour cela, un jury composé de dix membres s’est réuni en novembre dernier pour piocher dans les 66 présélectionnés et retenir 40 nominés, que voici :
Nominés dans la catégorie SPORTIF DE L’ANNEE
Abdallah Abacar, Mamoudzou VTT Club : vainqueur du tour de Mayotte.
Ahmed Saïd Salim, Vautour Club Labattoir puis Basket Club M’tsapéré : champion de Mayotte, vainqueur du trophée des champions, vainqueur de la coupe de France régionale, vainqueur de la finale zone océan Indien du Trophée coupe de France.
Anli-Oireou Madi, ASC Tsingoni (handball) : champion de Mayotte.
Faïze Ali Charif, Football Club M’tsapéré : champion de Mayotte, vainqueur de la coupe de Mayotte.
Mouhtar Madi Ali, Football Club M’tsapéré : champion de Mayotte, vainqueur de la coupe de Mayotte.
Nominées dans la catégorie SPORTIVE DE L’ANNEE
Dhoimrati Salim Abdallah, Rugby Club Mamoudzou.
Hamidati Ahamadi Abdillahi, Combani Handball Club : championne de Mayotte.
Kouraïchia Ali M’changama, All Stars Petite Terre (volley-ball) : championne de Mayotte, vainqueur de la coupe de Mayotte.
Layla Dina, AS Jumelles M’zouasia (football) : championne de Mayotte, vainqueur de la coupe de Mayotte.
Maïmoune M’dahoma, Vautour Club Labattoir (basket-ball) : championne de Mayotte.
Nominés dans la catégorie MAHOPOLITAIN DE L’ANNEE
Anzize Saïd Omar, Stade Olympique Chambéry (rugby).
Djassim Ahamada, ECO-CJF Athlétisme (saut en longueur).
Kadri Moendadzé, Orléans Loiret Basket.
Kévin Oumar, Red’s Team FR (kick boxing).
Marius Randriantseheno, Grenoble SMHGUC (handball).
Nominées dans la catégorie MAHOPOLITAINE DE L’ANNEE
Camille Tanne, Tarbes Gespé Bigorre (basket-ball).
Fayzat Djoumoi, Centre Fédéral de Basket-Ball : championne d’Europe.
Jeanine Assani Issouf, Limoges Athlé (triple saut) : championne de France en salle, championne de France plein air.
Nadjma Mahamoud, Olympique de Coubervoie (patinage artistique).
Simane Magoma, Tennis Club Sainte Memmie.
Nominés dans la catégorie ENTRAINEUR DE L’ANNEE
Rachadi Madi, TC Koropa puis TC Kavani (tennis).
Frédéric Louvier, Poutou Bébérou Mamoudzou (tennis de table).
Kolo N’daka, Ecole de Football Daka Kani-Kéli.
Marc Laffargue, Mayotte Boxing Majicavo (boxe, kick boxing).
Rudolphe Méchin, ASJJCM Kawéni (judo).
Nominés dans la catégorie DIRIGEANT DE L’ANNEE
Catherine Mkadara, présidente du All Stars Petite Terre (volley-ball).
Daoulab Ali Charif, président du Basket Club M’tsapéré.
Mohamed Boinariziki, président de la Ligue mahoraise de football et vice-président de l’Union des fédérations de football de l’océan Indien.
Nicolas Fraisse, président du Tennis Club Koropa Ascugre.
Sébastien Rière, président du Comité Territorial de Rugby de Mayotte et vice-président de la Fédération Française de Rugby, en charge de l’Outremer.
Nominées dans la catégorie EQUIPE MASCULINE DE L’ANNEE
Association Sportive et Culturelle Tsingoni (handball) : champion de Mayotte.
Basket Club M’tsapéré : vainqueur de la coupe de Mayotte, vainqueur du trophée des champions, vainqueur de la coupe de France régionale, vainqueur de la finale zone océan Indien du Trophée coupe de France.
Football Club M’tsapéré : champion de Mayotte, vainqueur de la coupe de Mayotte.
Association des Jeunes Handballeurs de Tsimkoura (handball) : vainqueur de la coupe de Mayotte.
Racing Club Petite Terre (rugby) : vainqueur de la coupe de Mayotte à VII, champion de Mayotte à XV.
Nominées dans la catégorie EQUIPE FEMININE DE L’ANNEE
All Stars Petite Terre (volley-ball) : championne de Mayotte, vainqueur de la coupe de Mayotte.
Association Sportive des Jumelles de M’zouasia (football) : championne de Mayotte, finaliste de la coupe de Mayotte.
Basket Club M’tsapéré : vainqueur de la coupe de Mayotte, vainqueur du trophée des champions, vainqueur de la coupe de France régionale.
Combani Handball Club : championne de Mayotte.
Vautour Club Labattoir (basket-ball) : championne de Mayotte.
Nominés dans la catégorie ARBITRE DE L’ANNEE
Mirhane Abdallah (Ligue mahoraise de football)
Chakrina Baharissoiffa et Bacar Saïd « Ajax » (Ligue régionale de handball de Mayotte)
Mourthadoi Gaba (Ligue régionale de basket-ball de Mayotte)
Ambdoul Madjidi (Comité territorial de rugby de Mayotte)
Alain Descatoire (Comité départemental de karaté et disciplines associées)
La dernière catégorie, celle des arbitres, a été définie par les différents comités sportifs et ligues sportives, contrairement aux huit autres catégories composées par le jury des trophées Mayotte Hebdo. Cela porte ainsi le nombre de nominés à 45.
A partir de ce jour, les internautes ont deux mois pour se rendre sur le site www.mayottehebdo.com et voter leur sportif, sportive, entraîneur, dirigeant, mahopolitain, mahopolitaine, équipe masculine, équipe féminine et arbitre favoris. La clôture des votes est programmée au vendredi 16 février 2018. La cérémonie de remises des trophées Mayotte Hebdo du sportif de l’année 2017 se déroulera la semaine suivante, le samedi 24 février 2018 au cinéma Alpa Joe, en direct sur Mayotte 1ère télé, radio et sur le compte Facebook du média.
Bonne lecture et bon vote !







































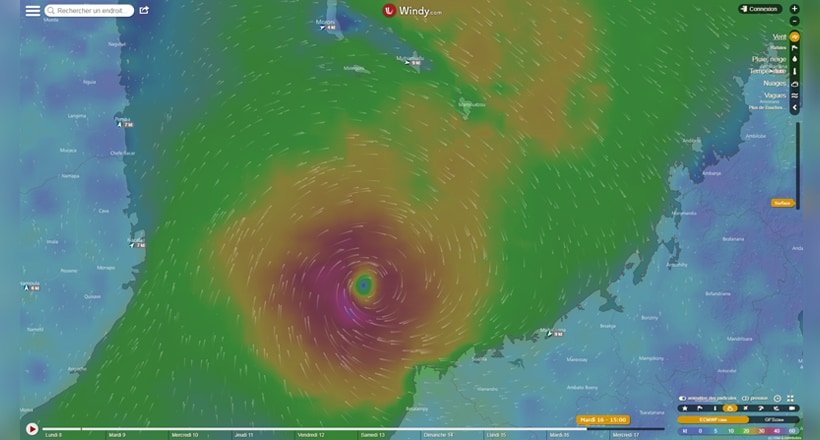





.jpg)
















.jpg)






