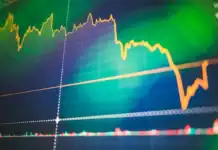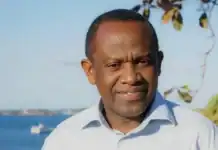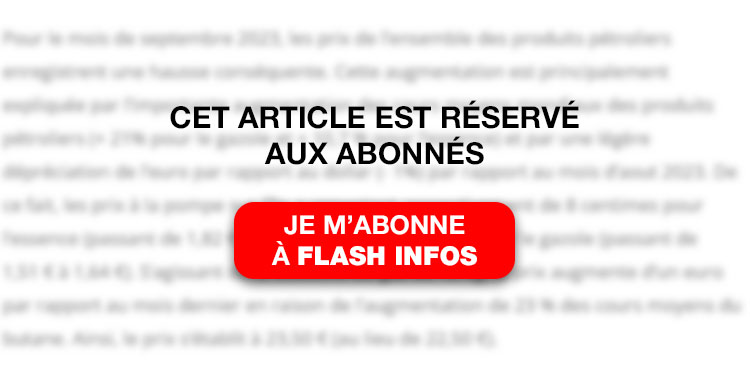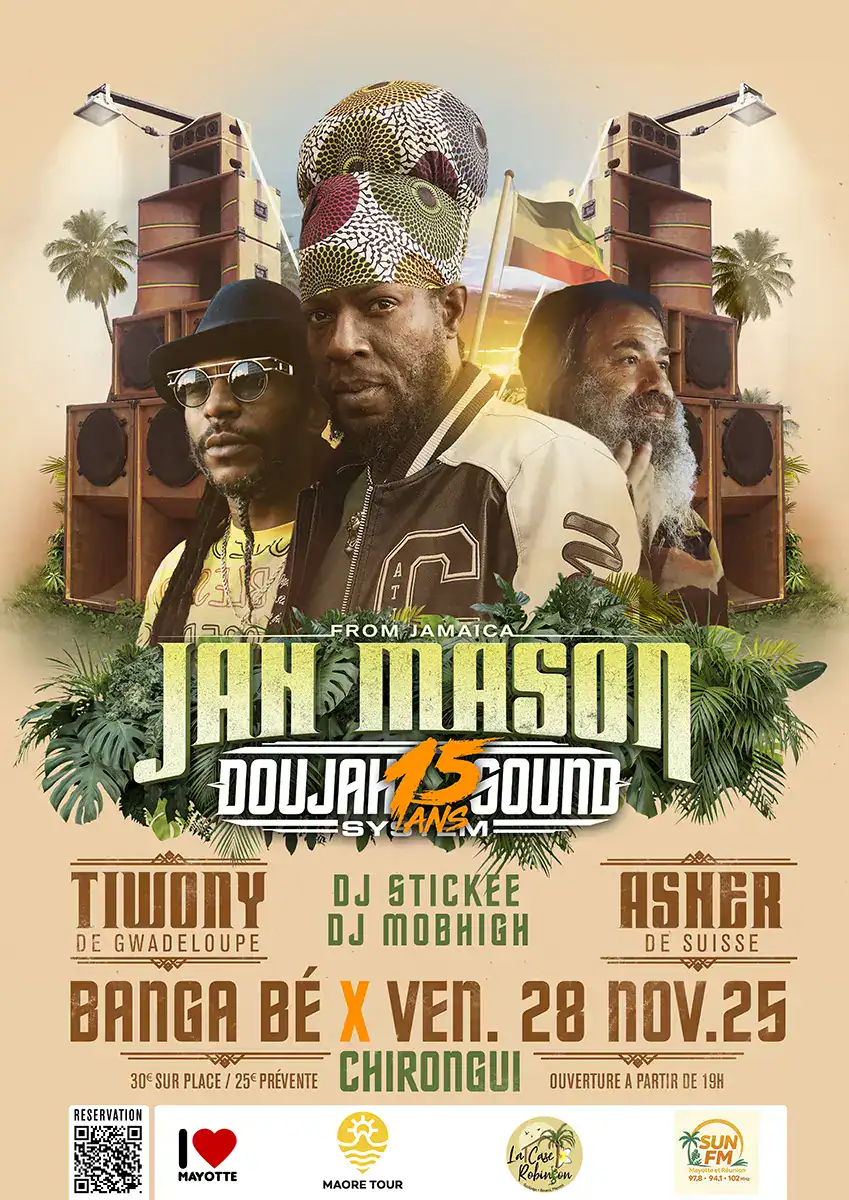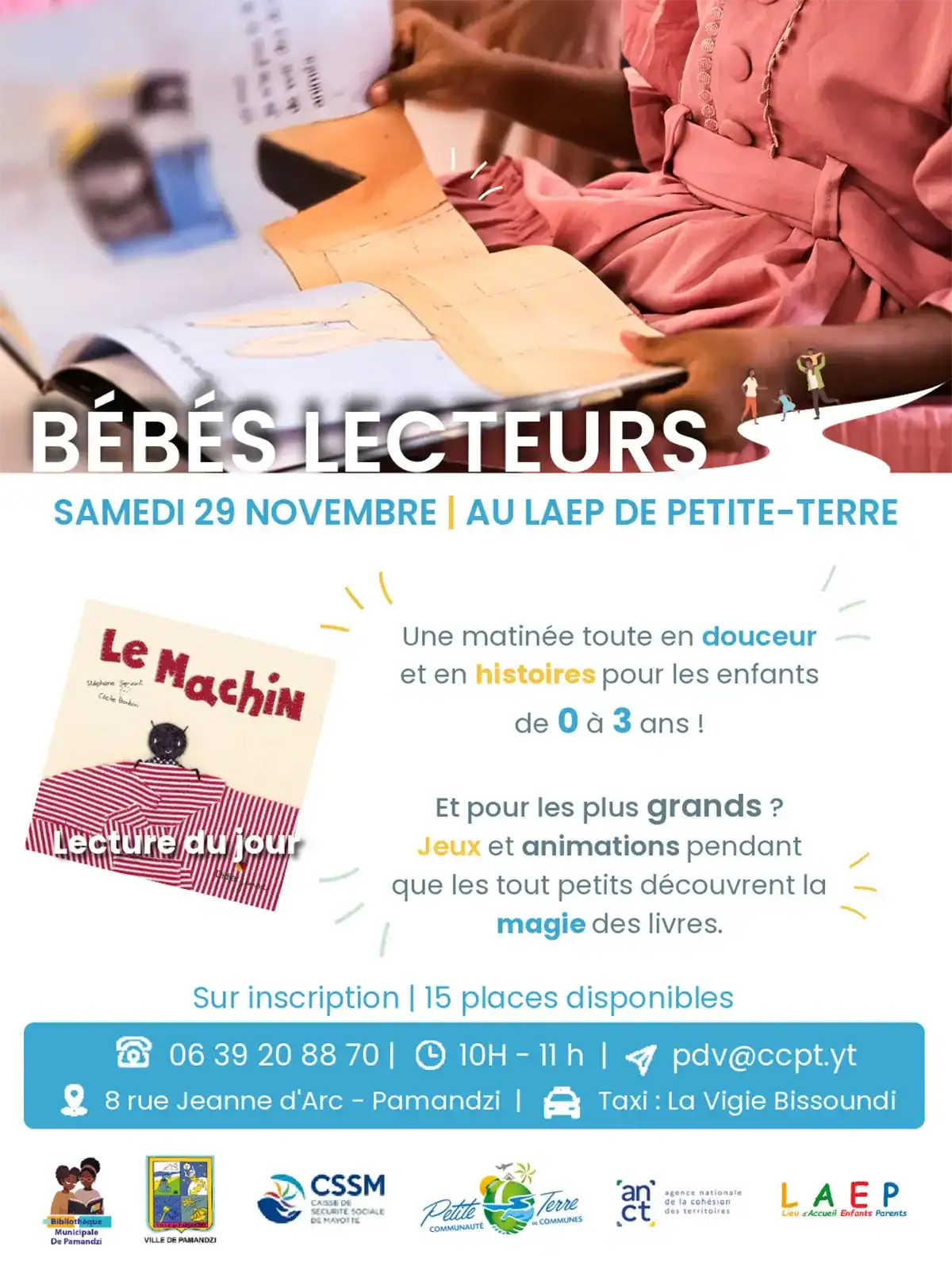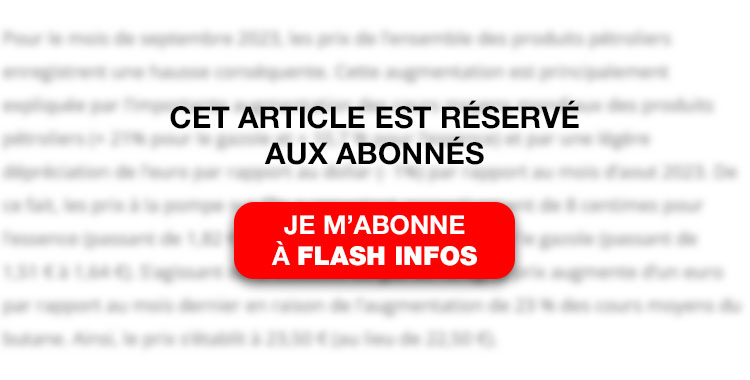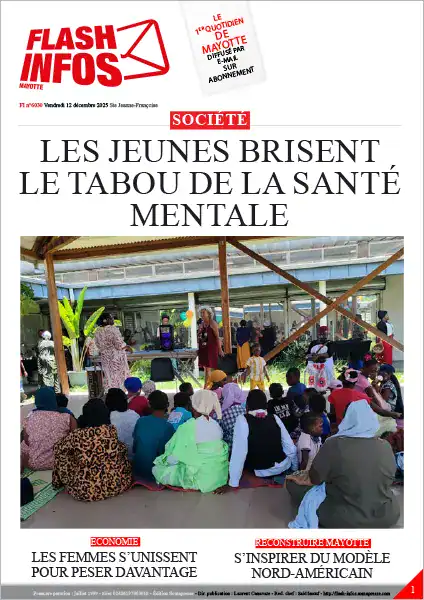Invitée sur la chaîne Youtube Omerta, connue pour la couverture de nombreux conflits internationaux, la députée RN, Anchya Bamana a profité de ce micro tendu pour dénoncer la situation sécuritaire de Mayotte et alerter sur la situation locale. Interrogée par le journaliste Régis Le Sommier, elle a appelé à prendre des mesures pour aider Mayotte.
Situation sécuritaire
La députée Anchya Bamana dresse un constat amer de la situation sur place et alerte régulièrement l’Assemblée nationale à ce sujet. « Mayotte est complètement par terre. Le cyclone est passé et la reconstruction n’a absolument pas recommencé. Ces derniers jours les villages vivent des agressions, la violence est revenue, comme si de rien n’était, ce week-end des voitures ont été brûlées à Vahibé/Tzounzou. Il y a trois jours à Sada, des voitures ont été brûlées, des bandes de délinquants s’affrontent pratiquement dans tous les villages. Hier, un jeune homme a été poignardé dans le sud de l’île et les pompiers n’ont pas pu aller le secourir car les voitures sont « caillassées » en pleine circulation. Voilà la situation sécuritaire de Mayotte, une île complètement abandonnée », souligne-t-elle.
Immigration
La situation sécuritaire est intimement liée à l’immigration mais « les moyens de protection des frontières maritimes ne sont pas mis en place. Depuis 2018 et la crise sociale à Mayotte, la population demandait à déployer plus de moyens en haute-mer pour que l’arrivée des barques clandestines cesse. Ce qui n’a jamais été le cas », indique-t-elle. « A la suite du cyclone, il avait été promis un « Uhura Wa Shaba », un mur de fer, pour lutter contre l’immigration illégale qui gangrène ce territoire. C’est une véritable invasion migratoire qui s’abat sur Mayotte. Les radars, les drones, les intercepteurs, tous ces moyens promis pour sécuriser nos frontières maritimes, n’ont pas été mis en place. C’est la réalité que nous vivons actuellement. »
Elle considère que les responsables publics ne jouent pas leur rôle. « Un camp de migrant a été démantelé il y a un mois, les personnes ont été laissées dans la nature, ce qui engendre des affrontements en bande rivale, notamment à Vahibé et à Tzounzou. Tous les week-ends, ces scènes de violence gangrènent la vie des riverains », dénonce la députée. « C’est vrai que les personnes qui viennent des Comores cherchent à avoir des papiers français, mais en réalité le fond du problème, c’est que ces gens viennent pour avoir une vie meilleure, une éducation, des établissements de santé et en réalité ne peut pas les obtenir puisque les infrastructures ne suivent pas l’évolution démographique et c’est le problème que vit Mayotte. »
L’eau, ressource fondamentale
La députée du Rassemblement national tente de défendre les droits fondamentaux des mahorais et de la population en général. « Il n’est pas normal que le gouvernement donne comme réponse des coupures de d’eau, des tours d’eau pour répondre à une pénurie qui asphyxie la vie des gens. L’eau est un droit fondamental selon l’ONU », explique-t-elle. Le manque d’eau accentue le risque de développement de maladies.
Autre mission fondamentale bafouée, Anchya Bamana déplore le fait que les écoles ne peuvent pas ouvrir normalement, avec « 2 heures de cours par jour pour les 50% d’écoles qui fonctionnent actuellement, quand les écoles fonctionnent », dénonce-t-elle.
Même si d’autres solutions arriveront à l’horizon 2027, notamment la deuxième usine de dessalement, elle annonce avoir écrit au ministre de l’Intérieur et des Outre-mer pour demander « la mise en place d’un plan ORSEC eau, Mayotte est le seul département français qui n’est dispose pas ».
Vers une refondation de Mayotte ?
« Les mêmes causes produisant les mêmes effets, ce que nous avions dit pendant les discussions pour le vote de la loi de refondation pour Mayotte. En réalité, on n’a rien refondé puisque ce que nous nous vivions avant Chido, c’est accentué », déplore-t-elle. « Les gouvernements successifs font des promesses qu’ils ne tiennent pas. Donc la situation est actuellement chaotique », conclut-elle.