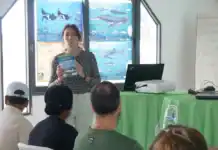Six ans après la parution du roman, Tropique de la violence sort cette semaine en avant-première sur le territoire mahorais. Une production d’envergure, entièrement tournée sur le terrain, qui met en lumière la violence au travers de ceux qui en sont à la fois victimes et acteurs : les mineurs isolés. Portrait d’une œuvre honnête, bienveillante, mais limitée.
C’est l’histoire d’un choc entre deux mondes. Celui de Moïse : céréales au petit-déjeuner, dessins animés et vêtements propres. Celui de Bruce : chef de gang impitoyable à Kaweni. Catapulté de sa tour d’ivoire après le décès de sa mère adoptive, le premier plonge dans ce « nouveau monde » dominé par le second. De quoi inaugurer une rencontre aux allures de tragédie grecque, dans un décor plus semblable à la Cité de Dieu qu’aux colonnes de l’Acropole.
Filmer sans stigmatiser
Tropique de la violence permet d’entendre le quotidien d’une jeunesse via sa propre voix. Injustice, mépris, déclassement… Le portrait est rude, presque cruel. Difficile d’imaginer qu’il s’agit pourtant d’une version « light » du roman de Nathacha Appanah. « Quand j’ai lu le livre, je me suis dit : « C’est trop violent. Presque impossible à adapter en film » », confie le réalisateur Manuel Schapira. Pour pouvoir être distribué à un large public, le scénario a naturellement subi une certaine réécriture. Que le spectateur se rassure donc, Tropique de la violence est loin d’une production trash aux relents voyeuristes. Bien souvent, cette violence est d’ailleurs plus sociale que physique. Elle se lit dans le regard de Moïse lorsqu’il fait les poubelles des restaurants des wazungus. Elle s’entend dans la voix de Bruce lorsqu’il raconte l’humiliation endurée pendant son conseil de classe. Elle se voit dans l’impuissance des associatifs censés aider ces jeunes. Dans tous les cas, elle reste étroitement liée à la misère qui structure cette jeunesse, jusque dans son absence de perspectives.
Pour coller au plus près de la réalité locale, des jeunes amateurs de plusieurs quartiers ont ainsi découvert le métier d’acteur. Un pari risqué, mais incontestablement remporté. Dès le premier regard, la sincérité de ces jeunes plantés dans ce décor pique le cœur. Chacun interprète son rôle avec humilité, sérieux et conviction. Au-delà des quartiers précaires, Mayotte est filmée dans toute sa beauté et sa diversité. À cela s’ajoutent une BO locale et un rythme soutenu. À l’arrivée, le spectateur ne peut qu’apprécier un film de qualité. Presque une première, dans une île pas vraiment habituée à se voir sur grand écran. De quoi se réjouir, même si la réorientation du scénario limite la capacité du spectateur à comprendre les maux du territoire.
Civilisation contre barbarie ?
Entre le livre et le film, plusieurs personnages et intrigues ont naturellement été coupés. « Des choix de simplifications sont obligatoires dans une adaptation. Ne serait-ce qu’en raison du budget », justifie le réalisateur. Premier personnage à en payer les frais : l’homme politique. Celui qui distribue des cartons de mabawas en période d’élection, achète la confiance de Bruce et entretient la violence à défaut de l’endiguer. Par sa présence, le lecteur devine un vaste système d’injustices aux responsabilités partagées. Une sorte de machine infernale où chaque personnage constitue un engrenage : personnalités politiques, travailleurs sociaux, parents défaillants, jeunes désœuvrés, etc.
Sur grand écran, cette nuance disparaît au profit d’un monde bipolaire. D’une part, la barbarie causée par une misère dont on se garde de pointer les responsables. De l’autre, la civilisation épargnée par la pauvreté. Cette dernière rassemble des humanitaires sympas mais impuissants. On peut également y croiser la mère adoptive de Moïse : une Française qui, malgré son implication, ne parvient pas à le préserver des « mauvaises fréquentations ». Dans l’ouvrage, son geste égoïste est pourtant le péché originel de cette tragédie. C’est elle qui s’accapare un enfant pour l’éduquer loin de ses repères. C’est aussi Stéphane l’humanitaire qui, dans son impétueux besoin de success story exotique, va provoquer des drames. Autant d’éléments qui permettent de comprendre un point central occulté par le film : même les plus (à priori) bienveillants ne sont pas étrangers aux injustices du département.
Un film de qualité malgré ses limites
Tropique de la violence est le genre de film dont on se retiendra presque d’émettre une critique négative tant Mayotte a besoin d’œuvres culturelles pour débattre et se raconter à elle-même. Grâce à cette réalisation, la jeunesse possède enfin un film digne de ce nom pour témoigner de son quotidien. Devant certaines réactions qui évoquent déjà une « mauvaise pub » pour le territoire, Manuel Schapira se défend : « Ils n’ont pas vu le film et se contentent de juger à l’affiche. Les retours sont jusqu’à présent unanimes. Particulièrement les jeunes. Ils sont fiers de voir leur île filmée avec de beaux moyens. Ils sont également fiers de voir des mecs d’ici raconter leur vécu. » Si les jugements négatifs sont incontournables, le réalisateur semble davantage concentré sur ses convictions « Sortir Mayotte de l’indifférence et montrer les jeunes au-delà des raccourcis habituels ». Sage intention.
Néanmoins, impossible de ne pas relever certains travers du cinéma français dans le traitement de la misère en général, et de celle de Mayotte en particulier. Bien que nuancée par son impuissance en terre mahoraise, l’eternelle figure du « sauveur blanc » est encore présente. La pauvreté demeure un spectacle que l’on regarde avec fatalisme, sans en chercher les causes ni les portes de sortie. Les Comoriens sont majoritairement miséreux ou violents (quand ils ne sont pas élevés par une blanche, comme Moïse). Les Mahorais sont dépassés, parfois haineux, mais rarement (voire jamais) animés par une solidarité sociale ou familiale. Quant à la parole des femmes, elle se limite quasiment à deux expressions : celle d’une Comorienne qui abandonne son enfant, et celle d’une Française qui l’éduque.
Alors certes, une production ne peut pas tout montrer en une heure et demie. Certes, il est impossible de résumer en un film toutes les nuances d’un livre. Certes, on ne peut synthétiser en une œuvre toutes les subtilités d’une île aussi complexe. Critiquer est facile. Réaliser un film à Mayotte l’est nettement moins. Que celui-ci soit débattu, contesté ou examiné dans ses limites est une bonne chose. Dans tous les cas, il libère la parole et permet à chacun de projeter sa conception du territoire. C’est toujours mieux que de projeter des cailloux.