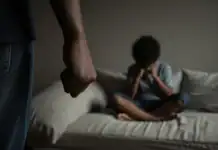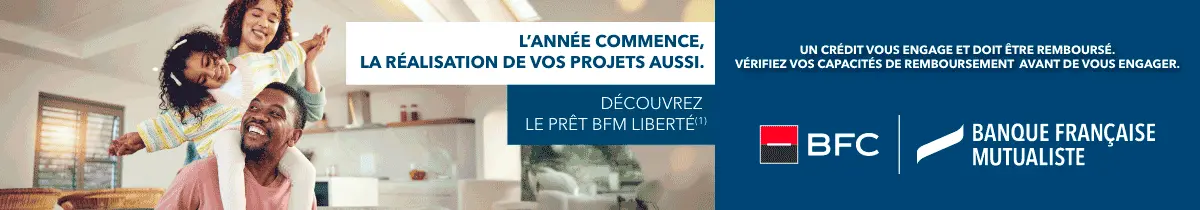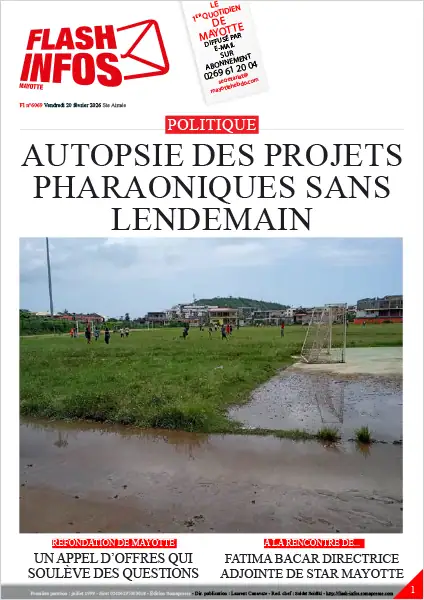Alors que la seconde vague s’estompe doucement, la directrice de l’agence régionale de santé aimerait accélérer le rythme de vaccination. Un enjeu de santé publique, avec l’approche du ramadan, et au vu de la situation dégradée à La Réunion.
C’est une première et cela se passera à Mayotte. Samedi 3 avril, les quatre centres de vaccination du 101ème département accueilleront toutes les personnes âgées de plus de 18 ans qui souhaitent se faire vacciner contre le Covid-19, sans critère de profession ou de comorbidité. Une stratégie qui va au devant de celle impulsée au niveau national, toujours ciblée sur les publics prioritaires, par tranches d’âge et facteurs de risques.

Trop peu de candidats à la vaccination
Le but de la manœuvre est clair : écouler les doses de Pfizer/BioNTech, qui reste le seul vaccin utilisé sur l’île. “Nous avons beaucoup de vaccins en stock, et si nous ne les consommons pas, on ne nous en enverra plus”, prévient Dominique Voynet, qui reconnaît un résultat moins satisfaisant qu’espéré, depuis l’arrivée du super-congélateur et le lancement de la campagne le 25 janvier dernier. Et ce, alors même que Mayotte a déjà bénéficié de règles assouplies par rapport aux autres départements français, compte tenu des spécificités locales. Ainsi depuis déjà plusieurs semaines, les plus de 60 ans avec ou sans comorbidité peuvent prétendre à la vaccination, contre 70 ans au niveau national ; et certains professionnels indispensables du fait de l’isolement du territoire, comme les agents de l’aéroport, du port, ou ceux en charge de la gestion de l’eau, ont été intégrés aux populations cibles, dans le cas de Mayotte.
Malgré cela, moins de 10% de la population à vacciner a reçu la première injection. Dans le détail, 13.533 personnes ont reçu la première dose, et 4.234 la seconde. “Il faudrait arriver à 30.000 dans les meilleurs délais.” Une lenteur qui s’explique notamment par les rumeurs qui circulent et que l’ARS tente constamment de démentir. Comme cette idée que le vaccin provoque la maladie. À ce sujet, la directrice de l’autorité sanitaire rappelle que si une suspicion d’incident survient, un dossier de pharmacovigilance est immédiatement transmis. À ce jour, seuls deux cas ont fait l’objet d’un tel rapport. “Le bénéfice est très supérieur au risque”, résume Dominique Voynet.
Atteindre l’immunité collective ?

De son côté, le centre hospitalier retrouve aussi progressivement son organisation classique. Un tiers des effectifs du service de santé des armées s’est envolé, de même que l’Élément de sécurité civile rapide d’intervention médicale (ESCRIM), qui laisse derrière lui l’hôpital de Pamandzi, partiellement en service. Pour l’instant, seule reste ouverte la permanence de soins au rez-de-chaussée, le temps de finir les travaux et d’inaugurer officiellement l’établissement, entièrement équipé cette fois-ci, au mois de mai.