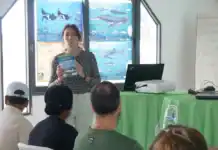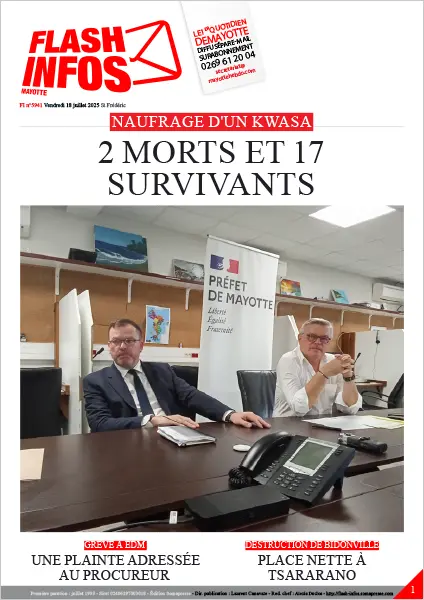Sociologue, Faissoil Soilihi, l’affirme : il n’est pas indispensable de partager le même mode de vie pour se comprendre et échanger, mais seulement d’identifier un sens commun, un objectif à partager, pour apprendre à se connaître. Entretien.
Mayotte Hebdo : Selon-vous, les métropolitains sont-ils porteurs, eux aussi, de stéréotypes ?
Faissoil Soilihi : Aucune personne ne peut se détacher de ses propres a priori. Cela voudrait dire qu’elle n’a pas de culture. Le fait d’avoir une trajectoire sociale qui a été nourrie d’une forme d’acculturation et de socialisation implique qu’il y ait des a priori, des prises de position, et parfois de l’idéologie lorsque cela va plus loin. Mais il faut voir les choses de façons claires : si l’on porte un jugement sur les wazungus, alors on tombe nous-mêmes dans le piège.
MH : Ils ont pourtant parfois l’image de personnes ne s’intéressant que trop peu en profondeur au territoire, de par le peu de temps que beaucoup y passent. Le turn-over est bien connu…
FS : Qu’est-ce qui amènerait une personne à quitter sa terre, les siens, son histoire, sa trajectoire, pour aller à l’autre bout du monde, quand bien même s’agit-il d’un territoire français ? Là, on peut avoir plein de justifications possibles. Tout se résume donc autour de l’objectif que chaque personne se donne : « Je vais à Mayotte parce que j’ai un emploi », « Je vais à Mayotte parce que j’ai besoin de changer d’air », « Je vais à Mayotte parce que j’aime apprendre des autres », etc. Ce qui veut dire que l’on ne peut pas obliger un mzungu à vouloir apprendre des Mahorais. Il faudrait que lui-même se dise que parce qu’il veut apprendre des autres, son expérience sociale sera meilleure. Mais c’est aussi à nous de travailler là-dessus.
La question ici, et pour tout le monde, est surtout « Comment faire pour quitter son champ de socialisation ? » Par exemple, aller voir ce qui se fait sur le plan culinaire, artistique, et dans bien des domaines. Il y a des wazungus qui, parce qu’ils ne veulent pas mal vivre leur expérience sociale sur le territoire et rester sur des a priori, repartir avec les mêmes schémas construits en partant de Paris-Charles de Gaulle, vont aller voir les autres et faire avec eux. Lorsqu’on quitte sa zone de confort et que l’on va à la rencontre d’une autre culture, on se met en danger pour s’enrichir, pour aller rechercher d’autres valeurs alternatives ou contradictoires avec la façon dont on se représente le monde. C’est là que l’on peut parler d’intelligence. L’intelligence, ce n’est pas le fait de tout savoir, mais la capacité à pouvoir mettre en lien des éléments qui, au départ, étaient des éléments distincts.
MH : Diriez-vous que ces deux communautés se comprennent ? Ou bien qu’elles ne se sont pas encore rencontrées ?
FS : Oui, elles se comprennent, mais selon les espaces qu’elles partagent, selon les besoins dont chacun se revendique. Il y a des endroits où Mahorais et wazungu se retrouvent, que ce soit dans le milieu professionnel, que ce soit dans un bar, dans un restaurant, etc. Ils peuvent ne pas manger ensemble, mais ils partagent le même espace.
Toujours est-il que, de plus en plus, le temps joue aussi un rôle important, au-delà des espaces. Le temps, c’est la manière dont les générations de Mahorais qui reviennent sur le territoire reprennent un certain nombre d’aptitudes culturelles qu’ils ont eu à pratiquer ailleurs. Ce qui veut dire qu’ils se rejoignent avec les wazungu sur des habitudes culturelles que ces derniers essayent de revivre ici. Il y a des pratiques, des habitudes, qui font que les wazungus et certaines franges de la population mahoraise se retrouvent. Elles permettent à ces deux populations de se retrouver.
MH : Doit-on comprendre que la rencontre est en train de se faire ?
FS : Bien évidemment. Mayotte est en train d’évoluer. Avec les crises que l’on connait aujourd’hui et leur nombre dans un laps de temps si court, il faut comprendre une chose : le besoin en matière d’infrastructures, de politiques culturelles, de politiques éducatives, sanitaires, économiques, etc. est réel. Cette rencontre entre les deux communautés se fait sur la base de ces revendications. Elles constituent des espaces qui permettent de dire « À Mayotte nous avons besoin de plus de santé, d’économie, d’être libre, de nous exprimer, d’avoir des dirigeants qui soient des visionnaires, etc. » In fine, cela veut dire qu’il y a un besoin de sécurité. On dit la chose suivante : « On ne veut plus seulement de la protection donnée depuis 1841, mais aussi de la sécurité. » Ce sont deux choses différentes. Dans la sécurité, il y a cette recherche du vivre-ensemble. Que ce soit entre les cultures, les populations, il y a cette recherche de mouvement qui permet de nous sécuriser. C’est ce qui fait la différence avec la notion de protection, qui s’apparenterait à quelqu’un qui construirait un fort pour se protéger. La sécurité, elle, est une recherche d’équilibre, comme une personne pédalant sur un vélo : à un moment donné le pied droit est en haut, mais à un autre le pied gauche reprend le dessus, et ainsi de suite. C’est ce que l’on recherche ici.
« IL Y A UNE RECHERCHE DE VIVRE ENSEMBLE »
MH : Finalement, même si on a l’impression qu’il n’y a pas tant de partage que cela, nous serions donc déjà dans ce mouvement, dans cette recherche de but commun ?
FS : Exactement. Il faut rechercher l’équilibre, et on ne peut pas l’avoir tant qu’on ne nous dit pas quelle ligne suivre. Ce n’est pas une loi, ce n’est pas quelque chose de répréhensible ou d’interdit, c’est quelque chose qui doit s’inscrire dans la dynamique collective. À Mayotte, on parle de stratégie, mais le but n’est pas encore connu. Qu’est-ce qui serait le mieux pour ce territoire de par sa position géographique, géologique, sa culture, son passé, etc. ? C’est cela que l’on doit déterminer : un but commun, pour mettre tout le monde dans cette dynamique là. Les Mahorais et les wazungus apprendront alors à mieux se connaître. Dès lors, chaque fois qu’il y aura des désaccords, on pourra se rattacher au but commun, la démarche initiale.
MH : Vous parliez de désaccords et de crise. Justement, si les rapports entre les deux communautés sont globalement bons, on sent parfois des crispations lors des crises sociales. Les a priori des uns et des autres ressortent plus facilement. Le métropolitain est celui qui a l’argent d’un côté, le Mahorais est celui qui fait toujours grève de l’autre, etc. C’est l’absence de but commun qui provoque ces réactions ?
FS : Imaginez que l’on identifie clairement ce but commun, et que l’on distribue les tâches à chacun sur la base de ce qu’il sait faire. À partir de là, toutes les justifications qui émaneraient d’une forme d’idéologie préconçue sur l’autre n’auront pas de place. Lorsqu’on reste sur des revendications qui consistent à dire qu’on aime plus Mayotte que les autres, on ne va rechercher que des critères qui émanent de la nature de l’autre. Et là forcément, on ne peut voir que des formes de désaccords, soumises à une forme de jugement. Des traits au niveau des personnes identifiées vont être utilisés comme des éléments justifiant le fait que telle ou telle personne doit être jugée comme ci ou comme ça. En revanche, lorsque les tâches ont été distribuées, quel que soit le comportement ou le jugement moral que l’on porte sur untel ou untel, la seule chose exigée, c’est le résultat. C’est le savoir-faire et le savoir de chacun qui intéresse. Le jugement qui émanerait des valeurs culturelles ou identitaires n’a plus lieu d’être. Chacun dépend de l’autre. C’est ce à quoi il faut parvenir.
Cela dit, identifier un objectif ne fera pas tout. Il faudra aussi distribuer les tâches selon les compétences des uns et des autres pour éviter les frustrations. Une fois d’accord là-dessus, il restera juste à réguler. Il pourra y avoir des conflits, oui, mais celui qui tient la manette pourra dire « Stop » aux conflits subjectifs – qui consistent à avoir des jugements interpersonnels – dans un champ où l’on demande plutôt d’avoir des conflits dits objectifs, des conflits sur la manière de réaliser les choses. La manière de faire plutôt que la manière d’être. Il faudrait qu’on y arrive.
MH : Vous défendez en ce sens la notion de management interculturel. De quoi s’agit-il ?
FS : C’est un instrument utilisé par beaucoup, inspiré des anthropologues, pour travailler sur un certain nombre de territoires comme Mayotte, à 8 000 kilomètres de Paris sur le plan géographique, mais aussi culturel. Aujourd’hui, avec les évolutions que l’on connait et les crispations dont nous avons parlé, on ne peut pas avoir une approche consistant à appliquer les mêmes mécanismes de management qu’en métropole. Personne n’est gagnant dans cette affaire-là. Celui qui fait ainsi aura plus de travail au final et il devra être en permanence derrière ses employés, car il n’aura pas leur confiance, et ils n’auront pas gagné la sienne. Cela ne peut pas fonctionner ainsi, cela ne peut que ramer. Par exemple, il y a des gens qui travaillent dans une entreprise à des postes de petits subordonnés, alors qu’ils sont des chefs dans leur village, et ont la mentalité qui va avec. Parce qu’on n’a pas demandé à la personne qui elle était chez elle, on s’empêche de développer des capacités humaines que l’on pourrait exploiter pour le bien de l’entreprise. Le salarié qui est dans ce cas ne peut pas se sentir concerné. In fine donc, il se dit que ce qui l’importe, c’est son équilibre familial, et donc de percevoir un salaire.
Un savant sénégalais, Cheikh Amadou Bamba, disait que l’équilibre de la société pouvait se retrouver autour de trois niveaux liés au concept du travail, qui est un concept universel. La première définition qu’il donne du travail est le salaire, la rétribution, le khasbou – hisabou en maoré, le décompte. On oblige ces gens à s’arrêter à ce sens-là du travail, au niveau de la contribution-rétribution, alors que si l’on connait la valeur du collaborateur dans d’autres espaces que celui du travail, on peut le mobiliser sur d’autres choses. On peut l’amener vers le sens dans le travail à mener, au-delà la rétribution. Cheick Amadou Bamba parle de l’enseignement que l’on donne en retour de l’action qui a été accomplie. Lorsqu’on amène cette même personne vers le sens du travail, on l’incite lui-même à faire des heures supplémentaires sans qu’il demande quoi que ce soit en échange. C’est la deuxième définition.
À Mayotte, il a rupture sur le plan culturel et sur le sens à donner au travail commun à réaliser, donc on s’arrête au premier niveau, le khasbou, alors qu’il faut arriver au sens donné au travail, au-delà de la rétribution.
Une fois qu’on sera parvenu à donner du sens à l’action du travail, le troisième niveau arrivera : khadima, avoir de la bienveillance, travailler pour l’intérêt général, dépasser ses propres besoins personnels imminents et travailler pour le collectif. C’est à cela que les managers ou les personnes qui viennent à Mayotte pour diriger doivent être sensibilisés. La question à se poser est « Comment partir de la notion d’individualisme pour arriver à celle de collectivisme ? » La manière de se représenter ce processus est différente en France métropolitaine, à Mayotte, en Angleterre, en Espagne, etc. Il faut donc s’approprier celle qui convient pour parvenir à mobiliser les personnes dans l’intérêt du collectif. De la même manière qu’à l’échelle de la société tout entière, il s’agit de dépasser ses propres besoins pour trouver un but commun.
« ON NE PEUT PAS DEMANDER À UN MZUNGU DE DEVENIR MAHORAIS »
MH : Revenons-en donc à la question des communautés. Finalement, wazungus et Mahorais n’ont pas nécessairement à confondre leurs modes de vie, mais simplement à se retrouver autour d’un objectif commun clair ?
FS : Oui, on ne peut pas demander à un mzungu de devenir Mahorais, et réciproquement. Il ne faut pas chercher la petite bête, la façon dont chacun se représente l’autre, mais aller sur des choses simples et objectives. Comme ont dit, la meilleure façon d’identifier un traitre c’est de le mettre à l’oeuvre. Alors, distribuons les tâches à tout le monde et on verra qui s’engagera ou pas, qui est de bonne volonté ou pas, mais uniquement sur la base de la contribution. Toutes les sociétés qui ont réussi à vivre avec plusieurs cultures, sur un temps très long parfois, ont compris cela. Il n’y aura plus de crispations entre wazungu et mahorais en situation de crise si, au préalable, un objectif commun a été trouvé et que les tâches ont été distribuées, tout simplement parce qu’il n’y aura plus de crise.
Mayotte Hebdo vise à contribuer au développement harmonieux de Mayotte en informant la population et en créant du lien social. Mayotte Hebdo valorise les acteurs locaux et les initiatives positives dans les domaines culturel, sportif, social et économique et donne la parole à toutes les sensibilités, permettant à chacun de s'exprimer et d'enrichir la compréhension collective. Cette philosophie constitue la raison d'être de Mayotte Hebdo.