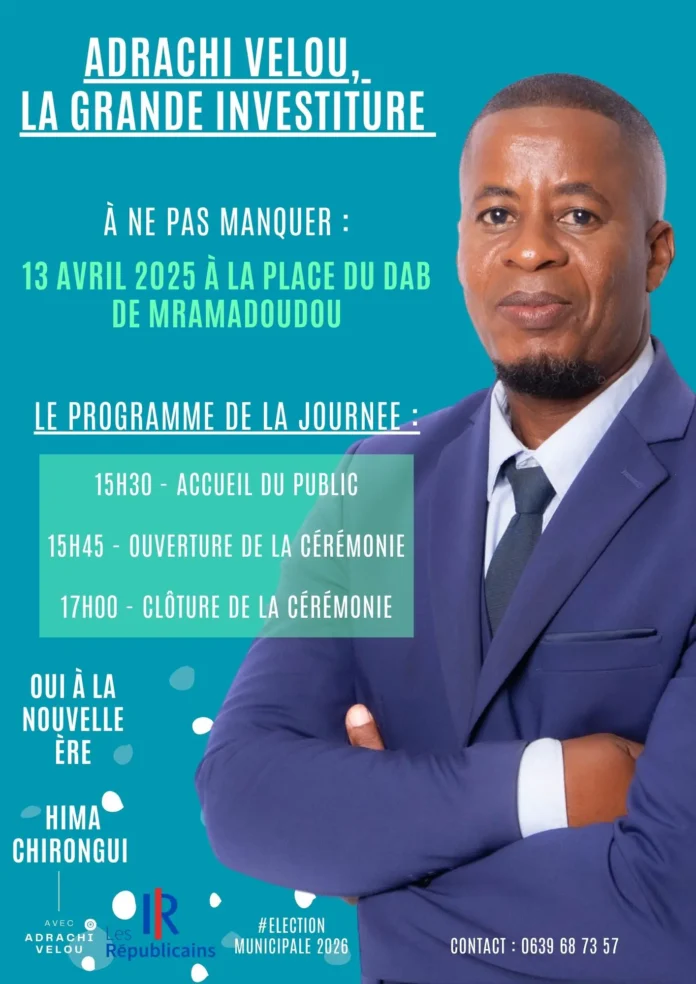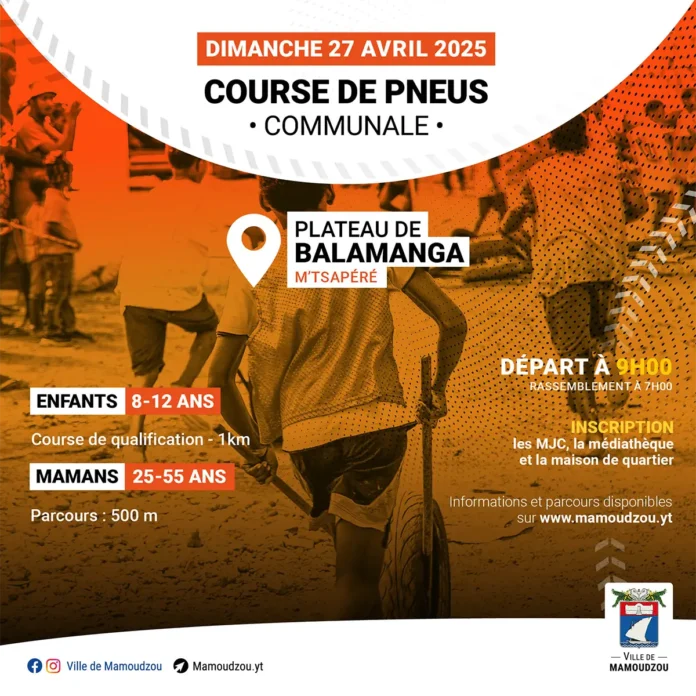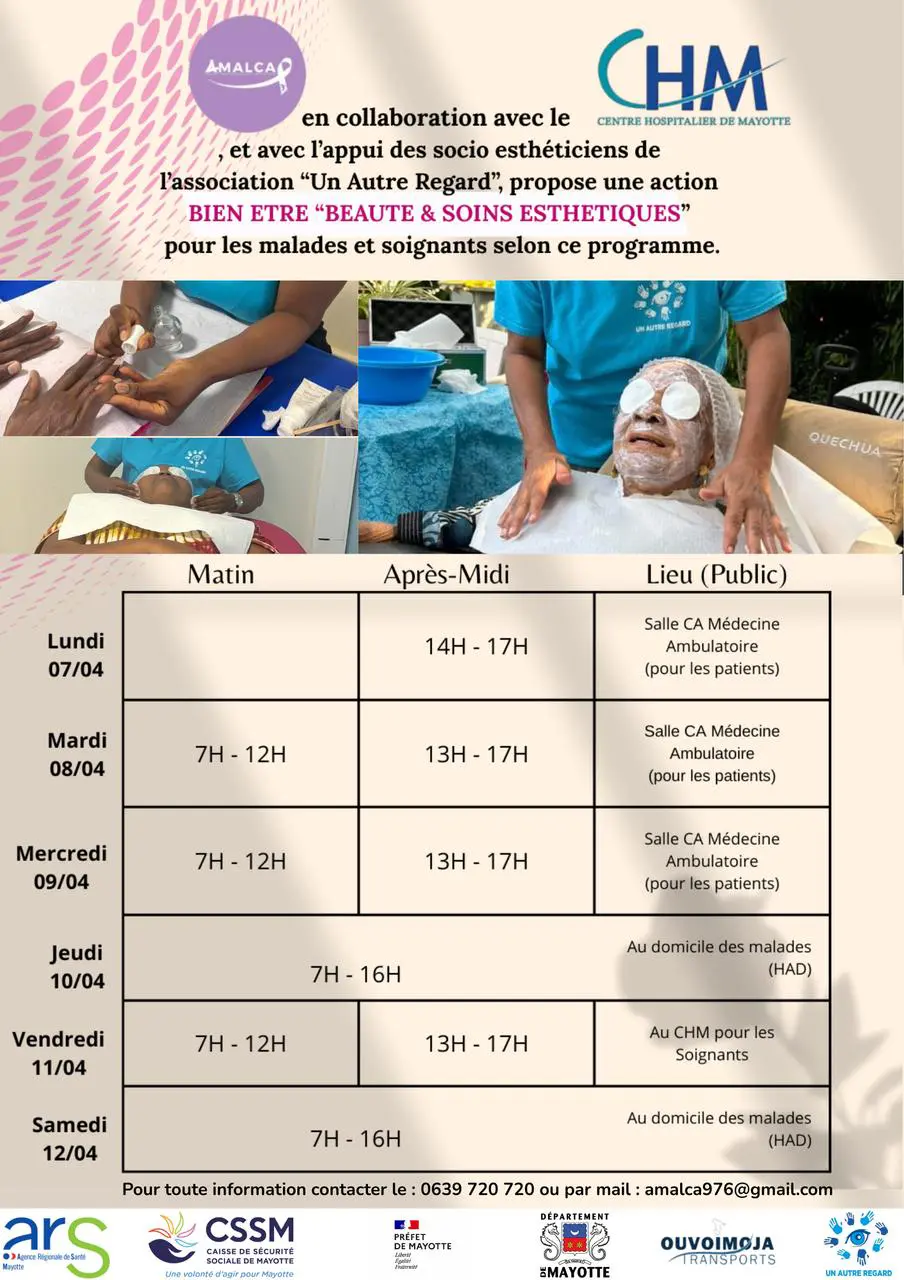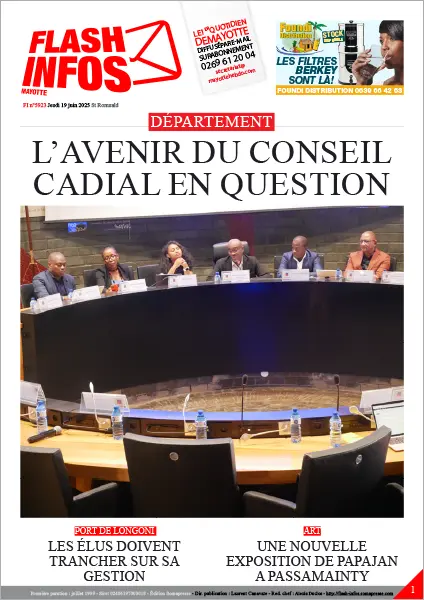Le collectif des artistes de Mayotte s’est fendu d’une lettre ouverte à l’attention de Ben Issa Ousseni, le président du conseil départemental de Mayotte, ce mardi. Ils y font part notamment de leurs divergences avec la politique culturelle de la collectivité et de désaccords profonds avec Zouhourya Mouayad Ben, l’élue en charge de la culture.
« Monsieur le Président,
Le 15 mars dernier, soit trois mois après le cyclone Chido, le Département de Mayotte a organisé une rencontre avec les acteurs culturels locaux pour réfléchir ensemble à la mise en place d’actions concrètes pour soutenir le secteur culturel. Comme vous avez pu le constater, ces acteurs culturels, en particulier les musiciens (pourtant les plus nombreux sur ce territoire) n’ont pas massivement répondu à votre appel et cela, pour une raison simple : nous sommes convaincus que le conseil départemental de Mayotte s’est placé aujourd’hui dans l’incapacité de créer la dynamique nécessaire car c’est lui-même qui a mis à terre la culture mahoraise. Actuellement, comme il n’a aucune vision en matière culturelle, le Département se contente d’improviser des actions au coup par coup, avec des moyens énormes et qui ne profitent même pas aux artistes locaux ni à la population.
Comme l’a dit très justement l’artiste Bedja sur Mayotte La 1ère, les artistes et opérateurs culturels mahorais attendent impatiemment une vraie politique culturelle du Département, c’est ce qui manque gravement à notre territoire. Nous regrettons qu’au lieu de rassurer la population et les acteurs culturels sur ses intentions en faveur de la culture à Mayotte, au lieu d’appeler au dialogue et à l’esprit de coopération, le Département a choisi de fuir ses responsabilités, en cherchant à rejeter la faute aux les autres. C’est ce qu’a fait votre vice-présidente et présidente de l’office culturel du Département, à l’occasion de l’émission Zakwéli du 20 mars dernier. Plutôt que d’assumer les conséquences très préjudiciables de ses actes et de sa gestion sur la vie culturelle à Mayotte qu’elle a réussi à démanteler en peu de temps, elle a choisi d’accabler et d’humilier Bedja, sur qui elle rejette la faute devant tout Mayotte. Rappelons que Bedja avait été invité et a participé en tant qu’artiste à la réunion des acteurs. En aucun cas son statut d’agent exerçant au sein de la collectivité départementale de Mayotte n’était concerné.
Solidarité avec Bedja
Cette façon de faire du Département de Mayotte à l’égard de cet artiste est irresponsable, puérile et indigne d’une élue locale, surtout quand elle est chargée de la Culture et de la Jeunesse. Nous dénonçons et protestons vigoureusement contre ces méthodes et manifestons notre solidarité à l’égard de notre ami artiste comme nous, qui paye d’avoir été sincère en disant tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Nous estimons qu’un sujet aussi important que celui de la politique culturelle d’un territoire ne peut pas être réduit aux états d’âmes et à l’esprit revanchard de certains. Le fait que la présidente de l’OCD ne supporte pas la contradiction comme c’est notoirement connu, tout comme elle est bien connue pour avoir la rancune tenace, ne l’excuse en rien. Elle a, dès le début de la mandature, démontré sa toute-puissance car pour se plier aux caprices de son protégé, l’actuel directeur de l’OCD, elle n’a pas hésité à sacrifier les meilleurs techniciens son de l’office. Vous les retrouvez aujourd’hui comme agent de sécurité au port, chauffeur à la bibliothèque ou encore ouvreur de salle à l’hémicycle Younoussa Bamana, sans que cela ne dérange aucun élu de cette institution. Quel gâchis pour des jeunes qui se sont engagés depuis plus de vingt ans au service de la culture mahoraise et qui ont accumulé plusieurs années d’expériences et reçu des formations financées par la collectivité pour bien exercer leur métier ! Le pire est que l’office culturel du département de Mayotte est aujourd’hui obligé de payer très cher pour faire venir des techniciens de La Réunion pour les quelques événements du Département.
Demande de bilans
Pour nous, c’est désormais clair : en balayant d’un revers de main dédaigneux toute critique à l’encontre de la gestion de la culture ou par rapport à l’absence d’une politique culturelle départementale identifiable, le Département de Mayotte considère qu’il n’a finalement rien à se reprocher et qu’il mène des actions irréprochables en faveur de la culture. Soit, nous voulons bien le croire. C’est pourquoi, nous vous prenons aux mots et vous prions par la présente, de bien vouloir publier un bilan précis et détaillé de toutes les réalisations de l’OCD de Mayotte, au vu des importantes subventions attribuées à cet organisme tous les ans, depuis sa création ; ce bilan, nous l’espérons accessible au grand public et aux acteurs culturels.
Enfin, ayant appris l’arrivée prochaine à Mayotte de Rachida Dati (N.D.L.R. selon nos informations, la visite a été reportée à une date ultérieure), ministre de la Culture, nous allons demander à la direction des affaires culturelles, chargée de conduire la politique culturelle de l’Etat à Mayotte, de communiquer aussi son bilan. Également, nous cherchons à comprendre comment l’action de l’Etat à Mayotte contribue réellement à l’aménagement culturel du territoire, au renforcement de la vie culturelle et à la construction d’une identité territoriale positive ? Nous pensons que la déclinaison sur notre territoire, de la politique culturelle de l’Etat devrait aider à la reconnaissance de la juste valeur des expressions culturelles locales et de l’identité de notre territoire, notamment en matière de soutien aux spectacles vivants, à la création artistique ou encore aux métiers des arts et du spectacle, etc…
Or, aujourd’hui, nous constatons que cette direction des affaires culturelles mobilise beaucoup plus ses moyens financiers et l’arsenal administratif qui va avec pour façonner et imposer la culture qui doit prédominer sur le paysage culturel local : en effet, en choisissant de soutenir certains projets culturels et en éliminant les autres, cette direction décide de fait, quelle culture doit vivre et se diffuser sur notre territoire. Pour toutes ces raisons, nous envisageons de solliciter une audience avec la ministre de la Culture afin d’aborder toutes ces questions.
Nous restons également disponibles pour approfondir avec vous tous ces sujets et pour contribuer à construire un aménagement culturel équilibré et durable de notre territoire. Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre très haute considération. »
Le Collectif des artistes de Mayotte