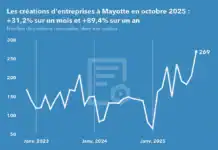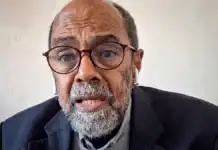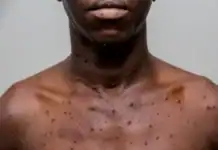Le docteur Abdelaziz Riziki Mohamed délivre sa réflexion sur la revendication d e l’Union des Comores sur Mayotte. Revendication qui selon lui, se fait au mépris du droit international.
Au mépris du Droit international public, au nom de la contiguïté ou voisinage ou proximité géographique, les Comores réclament avec acharnement, obsession et obstination ce qu’elles appellent illégalement « l’île comorienne “sœurˮ de Mayotte », une appellation qui ne concerne jamais Mohéli, la Grande-Comore et Anjouan, mais une île qui ne veut pas devenir comorienne. Or, la contiguïté est rejetée par le Droit international public car elle constitue un grave danger même pour les pays qui s’en prévalent pour réclamer des territoires étrangers.
Rejet de la contiguïté par la doctrine
Source reconnue du Droit, la doctrine représente les opinions exprimées dans des ouvrages de Droit international public par des experts juridiques reconnus. Ces auteurs hautement qualifiés notent qu’il est interdit en Droit de revendiquer un territoire en se basant uniquement sur le voisinage. Deux opinions vont nous éclairer ici.
Première opinion : La contiguïté est la « position d’un territoire ou d’une partie de territoire proche d’un espace appartenant à un État et revendiqué par ce dernier. En droit international public, ce seul argument a rarement été considéré comme valable pour donner satisfaction à l’État considéré, bien qu’il continue à être la source de multiples tensions à travers le monde. À l’heure actuelle, l’argument de contiguïté est essentiellement évoqué à propos des territoires polaires, développés au-delà des limites de l’œkoumène. Notons à ce propos l’argumentation originale de l’Argentine, fondant son droit à l’appropriation d’une portion de l’Antarctique sur la contiguïté justifiée par l’analogie géologique…, argument réfuté par l’Organisation des Nations Unies » : Jacques Soppelsa, Michèle Battesti et Jean-Christophe Romer : Lexique de géopolitique, Les Éditions Dalloz, Paris, 1988, p. 75. Cela signifie qu’il est interdit, en Droit international public, de revendiquer un territoire sous prétexte de proximité géographique. Donc, les Comores n’ont juridiquement pas le droit de revendiquer Mayotte en se basant sur le voisinage géographique.
Deuxième opinion : « Les juges et arbitres internationaux se refusent à considérer la contiguïté ou la “continuité” du territoire comme un titre autonome d’appropriation de territoire terrestre. Tout au plus en tiendront-ils compte lorsque d’autres instruments juridiques renvoient à l’adjacence comme l’un des critères d’attribution territoriale (Cf. CIJ, 8 octobre 2007, Nicaragua contre Honduras, § 164). L’adjacence pourrait par ailleurs être utilisée pour déterminer le degré souhaitable d’effectivité et de l’acceptation. Cette réserve clairement exprimée par la jurisprudence est tout à fait légitime, tant pour des raisons théoriques que pour des raisons pratiques qui ont été très bien formulées par la sentence de Max Huber de 1928 (4 avril 1928, Île de Palmas, RSA II, pp. 854-855). Il existe bien une doctrine diplomatique de la contiguïté, mais elle n’a pas donné naissance à une règle coutumière, comme l’atteste la situation actuelle dans les régions polaires » : Nguyen Quoc Dinh, Patrick Daillier, Mathias Forteau, Alina Miron et Alain Pellet : Droit international public, 9ème édition, LGDJ, Lextenso, Paris, La Défense, 2022, p. 758.
Rejet de la contiguïté par la jurisprudence internationale, au moins depuis le 4 avril 1928
La Justice internationale rejette la contiguïté depuis au moins la sentence arbitrale rendue par la Cour permanente d’Arbitrage le 4 avril 1928, sous l’arbitrage du Suisse Max Huber. Cette sentence est d’autant plus édifiante qu’elle constitue l’exemple le plus achevé de l’intemporalité (tempus regit actum) en Droit international public. Elle a été rendue au sujet de la souveraineté sur l’île de Palmas ou Miangas, une souveraineté revendiquée par les États-Unis et les Pays-Bas. Mais, on a le sentiment qu’elle a été rendue par anticipation au sujet de Mayotte.
De cette décision de Justice internationale, nous retenons la conclusion principale qui suit : « Le titre de la contiguïté, envisagé comme base de la souveraineté territoriale, n’a aucun fondement en droit international » : « Bien que des États aient soutenu, dans certaines circonstances que les îles relativement proches de leurs côtes leur appartenaient en vertu de leur situation géographique, il est impossible de démontrer l’existence d’une règle de droit international positif portant que les îles situées en dehors des eaux territoriales appartiendraient à un État à raison du seul fait que son territoire forme pour elle la terra firma (le plus proche continent ou la plus proche île d’étendue considérable).
Non seulement il semblerait qu’il n’existe pas de précédents suffisamment nombreux et d’une valeur suffisamment précise pour établir une telle règle de droit international, mais le principe invoqué est lui-même de nature si incertaine et si controversée que même les gouvernements d’un même État ont en diverses circonstances émis des opinions contradictoires quant à son bien-fondé. Le principe de la contiguïté, en ce qui concerne les îles, peut avoir sa valeur lorsqu’il s’agit de leur attribution à un État plutôt qu’à un autre, soit par un arrangement entre les parties, soit par une décision qui n’est pas nécessairement fondée sur le droit ; mais comme règle établissant ipso jure une présomption de souveraineté en faveur d’un État déterminé, ce principe viendrait contredire ce qui a été exposé en ce qui concerne la souveraineté territoriale et en ce qui concerne le rapport nécessaire entre le droit d’exclure les autres États d’une région donnée et le devoir d’y exercer les activités étatiques.
Ce principe de la contiguïté n’est pas non plus admissible comme méthode juridique pour le règlement des questions de souveraineté territoriale ; car il manque totalement de précision et conduirait, dans son application, à des résultats arbitraires. Cela serait particulièrement vrai dans un cas tel que celui de l’île en cause, qui n’est pas relativement proche d’un continent isolé, mais qui fait partie d’un grand archipel dans lequel des délimitations strictes entre les différentes parties ne sont pas naturellement évidentes » : Max Huber : Affaire de l’île de Palmas (Miangas). Les États-Unis contre les Pays-Bas. Sentence arbitrale, Cour permanente d’Arbitrage, La Haye, le 8 avril 1928, p. 25.
Deux idées émergent ici : d’une part, la contiguïté ne vaut pas droit de possession du territoire voisin, d’autre part, le règlement des problèmes territoriaux n’a jamais eu pour base le voisinage. Par conséquent, les Comores ne sauraient considérer Mayotte comme une île comorienne au seul prétexte qu’elle est dans leur voisinage. De ce fait, toutes leurs revendications dans ce sens violent profondément le Droit international public.
De Mayotte à Gibraltar : le droit à l’autodétermination terrasse la contiguïté
Mayotte et Gibraltar rejettent la contiguïté. Mayotte rejette les Comores et refuse d’être comorienne par simple contiguïté, préférant être française au nom du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, par le « plébiscite de tous les jours », cher à Ernest Renan. Il en est de même pour Gibraltar, situé à l’extrême Sud de l’Espagne, dans une continuité territoriale totale, mais préférant se placer sous la souveraineté de la Grande-Bretagne.
À ce sujet, le juriste Jean Charpentier a écrit : « Ajoutons enfin que ce principe de l’intégrité territoriale est si cher aux États souverains qu’ils en arrivent à l’assimiler à la décolonisation dans des hypothèses où elle n’a rien à y voir. C’est le cas de Gibraltar. Qu’on veuille, à la rigueur, au nom de la décolonisation, arracher Gibraltar au Royaume-Uni, passe encore ; après tout, Gibraltar était, il n’y a pas si longtemps, une colonie de la Couronne ; mais qu’au nom de la même décolonisation on veuille la rattacher à l’Espagne, c’est faire croire qu’elle en a été arrachée au cours de l’épopée coloniale comme un quelconque “territoire sans maître…” ; si l’on remettait en cause, au nom de la décolonisation, toutes les cessions territoriales intervenues entre États souverains depuis le XVIIIème siècle ou au-delà, où irons-nous ?… […]. Mais même ces déformations montrent bien à quel point le prestige de la décolonisation, mis au service de revendications territoriales, est capable de jeter sous des dominations qu’ils détestent des peuples à qui l’on refuse le droit de s’exprimer » : Jean Charpentier : Autodétermination et décolonisation, in Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Méthodes d’analyse du Droit international, Mélanges offerts à Charles Chaumont, Ouvrage publié avec le concours du Centre national des Lettres, Éditions A. Pedone, Paris, 1984, p. 129.
Jean Charpentier s’insurge contre la confusion faite délibérément entre droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et indépendance par création d’un nouvel État, au nom de la contiguïté, critiquant « l’Assemblée générale, méprisant totalement l’autodétermination des Mahorais » : « Cette assimilation repose, en effet, sur l’idée – on dirait presque le postulat – que tous les peuples colonisés veulent l’indépendance ; dès lors, parler de décolonisation ou parler d’autodétermination revient au même. Mais ce n’est pas vrai dans tous les cas et la valeur d’une construction juridique s’apprécie à son aptitude à s’appliquer aux cas marginaux ; ce n’est pas vrai notamment dans le cas de certains petits territoires, où la population peut préférer conserver des liens avec une métropole lointaine et riche plutôt que de s’en séparer et tomber sous la domination d’un voisin moins riche et moins libéral.
On citera à cet égard deux exemples particulièrement révélateurs : le premier est celui de Gibraltar où la volonté clairement exprimée par la population de rester liée à la Grande-Bretagne s’est heurtée aux exigences de la décolonisation qui postulait, dans les milieux de l’ONU, son rattachement à l’Espagne, de sorte que l’Assemblée générale, loin de rendre hommage à cet exercice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, a “déploré l’organisation par la puissance administrante d’un référendum contraire aux résolutions de l’Assemblée générale et du Comité des 24ˮ.
Le deuxième exemple est celui de Mayotte où la population, forçant la main au gouvernement français, a exprimé clairement et à trois reprises sa volonté de se désolidariser des autres îles de l’Archipel des Comores qui avaient proclamé leur indépendance le 6 juillet 1975, et de rester intégrée à la République Française. L’Assemblée générale des Nations Unies, méprisant totalement l’autodétermination des Mahorais l’a violemment condamnée comme “une violation de l’unité nationale, de l’intégrité territoriale et de la souveraineté de la République indépendante des Comoresˮ. Ainsi, l’autodétermination n’est prise en compte par l’ONU que dans la mesure où elle constitue un instrument de la décolonisation. C’est bien le signe de l’indifférence du droit international à l’égard d’un droit des peuples à l’indépendance » : Jean Charpentier : Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et le Droit international positif, Revue québécoise de Droit international, Québec, 1985, p. 203.
La contiguïté, un danger même pour les pays qui s’en prévalent
Est-ce Madagascar peut posséder Mayotte, située à 350 km de ses côtes ? Est-ce que le Mozambique peut réclamer la Grande-Comore située à 350 km de ses côtes ? Est-ce que Madagascar peut posséder Mayotte et Mohéli au prétexte que des Malgaches y avaient été des sultans emblématiques, Tsi Levalou dit Andriantsoly, à Mayotte, et Ramanetaka, devenu Abderemane, à Mohéli ? Non, non et non. La contiguïté est un danger parce qu’elle est source de confusions et d’injustices.
À cet égard, Gibraltar est un cas très édifiant en ceci que l’Espagne, veut posséder, au nom de la contiguïté, cette péninsule très stratégique à son extrême Sud. Mais, pendant qu’elle revendique Gibraltar du fait de la contiguïté, elle occupe deux villes (présides) qui sont marocaines par la contiguïté, Melilla (depuis 1497) et Sebta ou Ceuta (depuis 1580), qui sont sur la côte méditerranéenne du Maroc. Si elle obtient un jour Gibraltar, elle aura un contrôle complet des deux rives du Détroit de Gibraltar. Mais, peut-elle se prévaloir de la contiguïté face à la Grande-Bretagne et nier « le bien-fondé » de celle-ci devant le Maroc ?
Le Roi Hassan II du Maroc avait écrit en 1976 : « J’ai bonne espérance qu’un jour on reconnaîtra de même que Sebta, Melilla, les îles du Rif sont territoires marocains. […]. Que nos amis espagnols estiment les clauses du Traité d’Utrecht de 1713 peu conformes aux réalités de 1976 est compréhensible ; qu’ils désirent que “Gibraltar, territoire usurpé et colonisé”, fasse retour à la couronne espagnole parce que ce territoire se trouve en Espagne, rien, de leur point de vue, ne nous semble plus logique. Il est naturel que l’Espagne en appelle aux plus hautes autorités qui garantissent le droit international. Reconnaîtrait-on qu’il n’en est pas moins logique et compréhensible que nous considérions Sebta et Melilla, qui se trouvent au Maroc, comme marocains ? […]. Mais, il nous appartient de répéter qu’aucun de nos souverains n’a jamais signé un traité reconnaissant que les territoires marocains susnommés ne faisaient plus partie intégrante de son royaume » : Hassan II : Le défi, Les Éditions Albin Michel, Collection « Mémoires », Paris, 1976, pp. 88-89.
Il est à noter que, déjà, en septembre 1974, il avait déclaré au cours d’une conférence de presse, devant des journalistes espagnols et britanniques : « J’espère personnellement que ces revendications seront très fortes, car si les Britanniques remettent Gibraltar à l’Espagne, les Espagnols nous remettront Ceuta et Melilla. J’espère, avec mes excuses à nos amis britanniques ici présents, que le dossier espagnol soit solide, car si l’Espagne récupère Gibraltar, il ne fait aucun doute que nous récupérerons Ceuta et Melilla ».
Mieux encore, à la même année 1974, le journaliste et écrivain espagnol Juan Goytisolo avait expliqué avec exactitude : « Gibraltar est sans doute un morceau du sol péninsulaire et, comme tel, devra être abandonné tôt ou tard par ses occupants anglais. Mais, pour soutenir efficacement cette revendication, l’Espagne doit donner l’exemple. Si nous voulons qu’on nous rende ce qui nous a été usurpé, nous devons rendre d’abord ce que nous avons usurpé. Si nous voulons que la communauté internationale appuie nos justes demandes, nous devons satisfaire d’abord les justes demandes du Maroc. La restitution de Gibraltar, si chère au régime espagnol, ne pourra être obtenue qu’au moyen de la restitution préalable de Ceuta, Melilla et les îlots rifains. Quant au Sahara occidental, seul un référendum sous garantie internationale, accessible à tous les natifs et surtout sans la présence de l’armée d’occupation espagnole, permettra à ses habitants de dire s’ils désirent ou non l’union avec le Maroc. Le gouvernement espagnol qui le comprendrait et qui achèverait le processus de décolonisation nécessaire disposerait d’un moyen de pression politique et moral à l’égard de Gibraltar et pourrait compter sur le soutien de l’opinion publique de tous les pays » : Juan Goytisolo : Sahara occidental. Pour une authentique indépendance, Le Monde diplomatique, Paris, décembre 1974 (CD-ROM, Archives, 1954-2011).
En d’autres termes, non seulement la contiguïté n’est pas une solution juridique et pratique en matière de souveraineté territoriale, mais en plus, elle représente un grave danger même pour le pays qui revendique son voisin en son nom.
Par Abdelaziz RIZIKI MOHAMED
Mayotte Hebdo vise à contribuer au développement harmonieux de Mayotte en informant la population et en créant du lien social. Mayotte Hebdo valorise les acteurs locaux et les initiatives positives dans les domaines culturel, sportif, social et économique et donne la parole à toutes les sensibilités, permettant à chacun de s'exprimer et d'enrichir la compréhension collective. Cette philosophie constitue la raison d'être de Mayotte Hebdo.