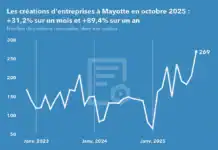l’État vend ses stocks d’eau alors que la crise continue
Le 2 juin 2025, l’État a organisé à Mayotte une vente aux enchères publiques d’eau potable. L’opération portait sur un lot de dix palettes de 84 packs d’eau chacune, vendu à un prix de départ de 1 400 euros. Une vente réservée aux entreprises, principalement aux supermarchés, alors que l’île connaît toujours de graves difficultés d’approvisionnement.
Une deuxième vente devait suivre en octobre, mais elle a été suspendue à la dernière minute, au moment même où les tours d’eau atteignaient jusqu’à 96 heures consécutives dans certaines communes, en raison des travaux à l’usine d’Ourovéni. Le contenu de douze conteneurs a finalement été redistribué dans les communes du Sud et de l’Ouest.
Selon plusieurs sources locales, ces bouteilles proviennent du stock d’eau constitué après le passage du cyclone Chido, en janvier dernier.
Elles avaient été destinées à la distribution humanitaire, mais les cargaisons sont arrivées trop tard pour être utilisées. “Pendant Chido, on n’a pas reçu d’eau. Elle est arrivée trop tard. Puis les élus, accusés de voler de l’eau, ont refusé de continuer la distribution. C’est arrivé en retard et au moment de distribuer, les communes ont lâché l’État. Ça pourrait expliquer ces ventes aux enchères”, résume une personne qui souhaite rester anonyme.
Pour une population encore soumise à des restrictions massives, l’image est désastreuse : celle d’un territoire en soif, où même les réserves humanitaires deviennent un bien marchand. La crise de l’eau à Mayotte ne se limite pas à des épisodes ponctuels, elle est permanente, structurelle et désormais reconnue comme telle par les textes officiels.
La loi du 11 août 2025 sur la programmation pour la refondation de Mayotte reconnaît noir sur blanc l’existence d’une “crise récurrente de l’eau” sur l’île. Elle ajoute : “L’accès à l’eau potable constitue une priorité pour éviter la précarisation chronique des Mahorais déjà soumis à de fortes carences. Les épisodes récurrents de stress hydrique affectent directement la qualité de vie des habitants et freinent le développement économique.”
Le plan d’eau 2024-2027 prévoit 730 millions d’euros d’investissements entre 2024 et 2027 et promet la fin des tours d’eau d’ici 2026. Mais la situation reste alarmante. Près de 30 % des Mahorais n’ont toujours pas accès à l’eau potable dans leur logement, selon les chiffres les plus récents, et dans certaines communes les robinets restent à sec plusieurs jours par semaine.
Un arrêté préfectoral du 13 octobre 2025 fixe d’ailleurs les prix maximums de vente d’eau en bouteille jusqu’au 31 décembre 2025 — 1,45 € pour une bouteille d’1,5 l et 0,75 € pour 50 cl — en raison des conséquences du cyclone Chido et “des effets des travaux réalisés à l’usine d’Ourovéni sur l’approvisionnement en eau potable à Mayotte.”
Cette prolongation jusqu’à la fin de l’année est, à elle seule, la preuve que la crise n’est pas conjoncturelle mais bien récurrente.
Dès lors, comment expliquer la vente du stock d’eau de l’État, alors que la loi et les arrêtés reconnaissent une situation de pénurie chronique ? Et surtout, comment concilier cette décision avec le droit fondamental à l’eau ?
Ce droit ne relève pas d’une simple revendication morale. La résolution 64/292 de l’Assemblée générale des Nations unies, adoptée le 28 juillet 2010 avec le soutien de la France, reconnaît explicitement “le droit à une eau potable salubre et propre comme un droit fondamental, essentiel à la pleine jouissance de la vie et de tous les droits de l’homme.” Le Code de l’environnement français, dans son article L210-1, précise lui aussi que “l’eau fait partie du patrimoine commun de la Nation”.
Vendre des palettes d’eau dans un département où des milliers de personnes n’ont pas accès à l’eau courante interroge profondément. À Mayotte, l’État répète que l’eau est une priorité nationale. Mais sur le terrain, la population a le sentiment d’un double discours : d’un côté, l’eau est déclarée “bien commun et vital” ; de l’autre, elle se vend aux enchères.
Cette contradiction, plus qu’un symbole, illustre la fracture entre la promesse républicaine d’égalité et la réalité quotidienne des Mahorais : celle d’un territoire français où, en 2025, l’eau potable reste un privilège.
Passionnée par la petite et la grande histoire d'hier et d'aujourd'hui j'aime raconter le quotidien des personnes qui fondent un territoire.