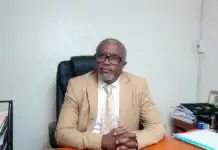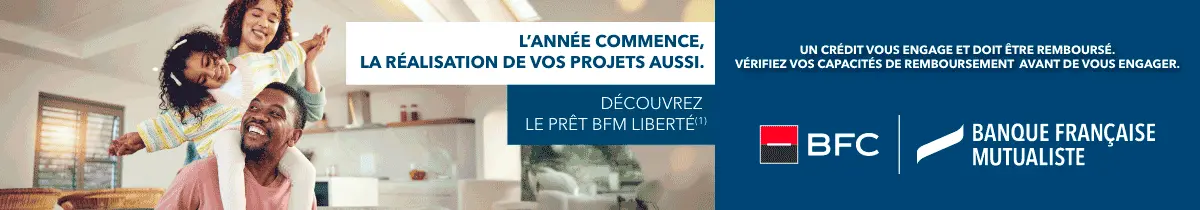Le Service des Transports Maritimes (STM) constitue depuis près d’un demi-siècle l’un des piliers de la vie quotidienne à Mayotte, garantissant la continuité entre Petite-Terre et Grande-Terre. Pourtant, sa gestion, récurrente source de débats et de tensions sociales, interroge toujours la place et le rôle du Département dans l’organisation de ce service public essentiel. À la lumière de l’histoire et des principes fondateurs des services publics, l’ancien député Mansour Kamardine appelle à une réflexion claire : aux syndicats de défendre les droits des agents, et au Conseil départemental de prendre ses responsabilités pour assurer, avec efficacité et modernité, la pérennité du transport maritime.
La question de savoir que faire du Service des Transports (STM) est tel un serpent de mer et se pose à intervalles réguliers au Département de Mayotte depuis ces 30 dernières années.
L’actualité sociale récente liée à la grève des barges nous la rappelle et me conduit à des précisions qui me paraissent utiles avant de suggérer des pistes de solution.
Ainsi, dois-je rappeler que sur un plan historique, le service public des transports maritimes de Mayotte est probablement l’un des plus vieux services publics locaux que le Département ait eu à gérer et à développer car il est destiné à assurer sans discontinuer la liaison entre les deux principales îles habitées du département Mayotte.
Pour rappel, il faut savoir qu’il a existé depuis le Territoire des Comores et a été utilisé par les autorités comoriennes dans leur politique de représailles comme moyen de pression à l’égard de Mahorais. Aussi, la lecture des archives du Haut-commissaire de la République aux Comores nous apprend-elle que le Conseil du Gouvernement des Comores avait refusé son financement. Il a fallu un certain nombre d’artifices et d’acrobaties à caractère administratif du Haut-commissariat pour obtenir une prise en charge directe depuis Paris d’une ligne de financement pour l’acquisition du Tritonis, un bateau chargé d’assurer la liaison entre ces deux îles, avant l’arrivée en 1976 des embarcations appelées « Kalboiboi »dès le lendemain de notre séparation politique.
Au lendemain de cette séparation entre Mayotte et les Comores, la Collectivité territoriale de Mayotte, ancêtre de la Collectivité départementale a eu entre autres services publics à développer, la ligne reliant les deux îles ; d’où la création depuis près de 50 ans du désormais Service des Transports maritimes qui a pu sans doute, à travers le temps, se transformer et se développer jusqu’à la situation présente.
En effet, en 1976, Mayotte est abandonnée par la France, tout en restant française. La Collectivité de Mayotte s’est trouvée, en fait, en charge d’organiser plusieurs services publics qui jadis étaient assurés par le Territoire et se sont trouvés de fait relever de la compétence de la Collectivité territoriale de Mayotte et qui, en Droit commun hexagonale ne relèvent pas forcément d’une collectivité à compétence comme celle de Mayotte. Parmi ceux-ci naturellement, il y a l’actuel Service des Transports maritimes, qui demeure une survivance de l’ancien régime des services publics gérés par la puissance publique locale. Il y a eu également, pour mémoire, entre autres, le service public des hydrocarbures, la distribution de l’eau, le service public des transports scolaires, la distribution de l’électricité (…).
Avec la modernisation de l’appareil juridico-administratif de l’île, le Conseil général puis départemental a dû, étape après étape, procéder à une mise à niveau de ses services publics dans le respect des principes généraux qui irriguent l’administration des services publics, et notamment dans le respect des lois dites de Rolland du nom du Commissaire du Gouvernement devant le Conseil d’Etat : égalité, continuité, et mutabilité. Je ne m’étendrai pas davantage sur la signification desdites lois, pour éviter un alourdissement inutile de mon exposé. Ce qu’il faut retenir ici, c’est que ces principes sont connus également sous le nom de « lois du service public », qui sont une série d’exigences s’appliquant à l’ensemble des activités du service public.
En considération de ces exigences, le Conseil départemental a développé depuis plusieurs décennies (plus de 30 ans), une politique de gestion de ces services publics, plus proche des modes standards de gestion desdits services à savoir : confier à la gestion privée tout service public à caractère industriel et commercial, ce qu’on appelle couramment, les SPIC et garder en gestion directe, les SPA (services publics administratifs). C’est ce qui explique que de la fin des années 1990 au début des années 2000, les débats au conseil général ont été vifs. Deux visions politiques différentes s’affrontaient, entre ceux qui dénonçaient la destruction du service public, notamment de l’emploi et ceux comme Younoussa Bamana et moi-même qui y voyaient une meilleure prise en compte des enjeux économiques et sociaux de l’île. Ainsi, avons-nous décidé entre autres alternatives, l’externalisation de la gestion de trois services publics majeurs du Territoire : l’éléctricité de Mayotte, les transports scolaires et les hydrocarbures, sous l’égide du président Younoussa Bamana.
À l’époque les débats étaient vifs et animés. Nous avons tenu bon car nous étions convaincus que ces orientations s’inscrivaient bien dans l’intérêt même du bon fonctionnement des services et donc de leurs usagers. En effet, nous nous étions rendu compte que le Conseil général au travers de son budget n’avait plus les moyens financiers pour accompagner le développement économique et social de l’île. Nous étions confrontés fréquemment à des pénuries de carburant et à une volatilité importante du produit de vente du carburant. Nous connaissions également la même situation au sein d’Électricité de Mayotte (EDM). Aujourd’hui, il ne vient plus à l’idée de quiconque d’imaginer une reprise en direct par le Conseil départemental de la gestion des services publics des hydrocarbures ou d’Électricité de Mayotte. Ces services sont assurés par des structures privées dont c’est le métier, avec un savoir-faire éprouvé. En un mot, le service reste toujours public sous l’autorité et le contrôle de la collectivité, mais sa gestion est privée, pour mieux épouser les règles régissant les lois du marché et de la concurrence.
Il en va de même de la gestion du service public des transports scolaires, assuré de bout en bout par des unités économiques privées, à charge pour le Département d’en supporter le coût à 100%. C’est ainsi que c’est le privé qui gère le service de ramassage des élèves dans nos communes et villages ; c’est le Département qui paye le service à hauteur de 45 millions d’euros. Ce fut la grande époque de la restructuration de l’activité économique de l’île, l’idée maîtresse étant de faire en sorte que le Département se concentre sur ce qui relève de son métier d’origine et principal : la gestion des services administratifs.
Fort de cette culture et de cette certitude, il a, sans hésité, confié en 2014, la gestion du service public du port dans le cadre d’une DSP (délégation du service public) qui est également une autre forme de gestion de service public ; l’idée de base restant inchangée à savoir que le département ne peut assurer en direct la gestion d’un service public industriel commercial, autrement, relevant de la concurrence . C’est cette même logique qui prévaut avec les initiatives annoncées par le Département de confier la gestion de la billetterie de la gare maritime dans un premier temps, et dans une seconde la gestion des bâtiments (barges) du STM à une unité économique privée.
L’idée sous-jacente ici n’est guère différente de ce qui avait motivé le Conseil général sous la présidence de Younoussa Bamana à la fin des années 1990 et au début des années 2000, pour externaliser la gestion de ces activités industrielles et commerciales que j’ai rappelées et dont, une fois encore, les plus emblématiques restent : le transport scolaire, EDM, le port de Longoni (1994). Il faut savoir à titre purement anecdotique que la Collectivité fournissait également la téléphonie et la poste. Toutes ces activités ont été transférées à la gestion privée. Le Département s’en trouve mieux garanti dans leur gestion au service de leurs usagers respectifs.
C’est la même logique qui prévaut pour le transfert de la gestion du service maritime à un opérateur privé avec, en filigrane, les mêmes objectifs d’accompagner le développement économique et social du service public du transport maritime et mettre un terme à la porosité connue de notoriété publique du produit de la vente des tickets.
En effet, si des interrogations légitimes devaient se poser sur l’opportunité de ce transfert de gestion, la réponse, la plus évidente vient des évènements liés au cyclone Chido du 14 décembre 2024, avec la destruction de deux navires les plus importants. En effet, au lendemain de la catastrophe, et à l’issue de laquelle toutes nos structures se sont retrouvées à terre, tous nos yeux se sont rivés sur les initiatives des opérateurs économiques privés de nos différents services publics pour exiger des réponses urgentes et immédiates. Ce fut le cas pour l’électricité, pour la téléphonie fixe et mobile, pour Internet, pour l’eau etc. Ce ne fut pas le cas du côté du STM, à l’égard duquel nous avions tous les yeux baissés, car nous n’avions personne sur qui déverser notre dévolu et exiger des réponses rapides et immédiates sauf sur nous-mêmes. On a vu là les limites d’être juge et partie dans une affaire pour assurer le fonctionnement ou la reprise du service des transports entre les deux îles. J’appelle donc à une responsabilité courageuse de nos élus départementaux pour conduire la dernière remise à niveau du département par rapport à ce qui se fait ailleurs par les autres collectivités locales en la matière.
Pour ce faire, il faudra sans doute expliquer d’abord aux élus eux-mêmes pour les convaincre de la différence de conception à avoir entre les différentes notions de gestion des services publics, entre privatisation et externalisation des services publics, et bien expliquer qu’aucune collectivité locale ne peut privatiser un service public, mais ce qui est possible de privatiser, c’est sa gestion. Et cela, nous le faisons avec efficience dans les transports scolaires et dans les hydrocarbures, dans les services publics de l’eau et même dans le cadre de la DSP du port de Longoni (même ici, il y a plus à dire en terme d’efficience). Au fond, dans cette affaire, notre marge de manœuvre est relativement faible, au-delà des recommandations pertinentes de la Chambre régionale des Comptes (CRC). Sur le plan budgétaire, la question posée est relativement simple : avons-nous encore les moyens pour financer à hauteur de 45 millions d’euros le fonctionnement de ce service, alors que nous n’avons pas été à même de financer à hauteur du même montant le RSA (revenu de solidarité active), et nous avons été contraints de proposer et obtenir de l’État sa renationalisation ? La difficulté ici, c’est que l’État ne nous viendra pas en aide comme il l’a fait pour le RSA, le Conseil départemental avait dans le cadre du RSA, reçu délégation pour agir au nom et pour le compte du même État. Il était donc plus facile à l’Etat de reprendre sa compétence. Dans le cas du STM, il s’agit d’un service public local par essence, qui doit fonctionner avec, avant tout et principalement, les moyens du Département.
La deuxième initiative urgente à avoir avec les syndicats des agents et dans le respect du rôle de chacun et des textes, c’est d’obtenir de chaque partenaire qu’il joue sa partition dans la limite du champ de compétences de l’autre, à charge pour les syndicats de défendre les intérêts de leurs membres, en évitant qu’il leur soit imposé d’etre soumis à un mode de gestion qui ne leur convienne pas et en ayant des garanties que ceux qui voudront partir le pourront sans difficulté dans un autre service ; et à charge pour le Département de décider sur la meilleure façon pour assurer de manière efficiente et régulière au regard des lois de Rolland : égalité, continuité, mutabilité du service public des transports maritimes. Cela veut dire que le Conseil départemental doit permettre aux agents qui ne souhaitent pas poursuivre leur carrière dans le cadre d’une organisation privée de réintégrer d’autres services publics du Conseil départemental. C’est ce que nous avions imaginé par le passé et qui a bien fonctionné aux hydrocarbures et à EDM.
Oui, je pense qu’il n’est pas de la responsabilité des syndicats d’imposer à l’Autorité publique telle ou telle mode de gestion du service public entre la kyrielle de modes de gestion que la loi lui met à disposition. L’intérêt des agents doit être porté par les syndicats. L’efficience des services publics, c’est de la responsabilité sans partage de la collectivité publique.